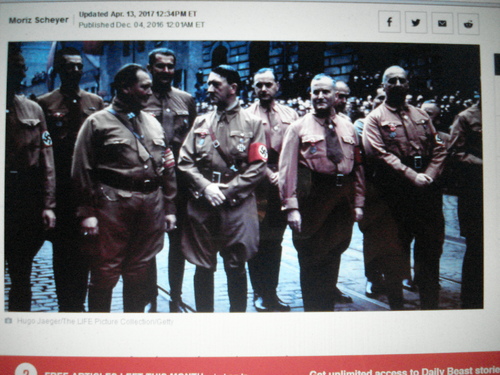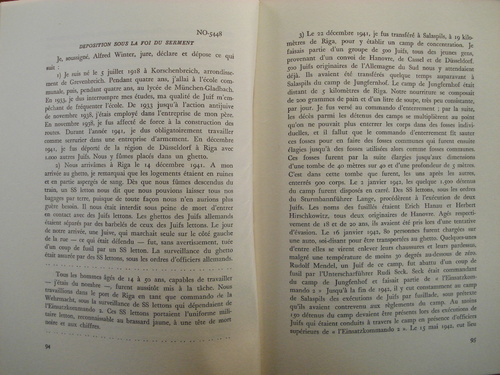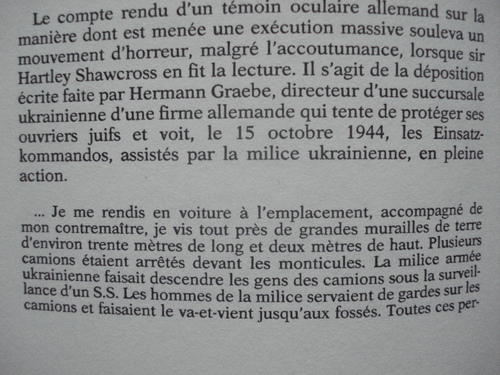-
Par fjf le 28 Avril 2021 à 08:44
Séance 5
LE NAZISME ET LES NAZIS COMME « GROUPEMENT AGONISTIQUE »
J’ai préalablement défini le nazisme comme une pratique criminelle. Je me propose donc de décrire le nazisme et l’histoire du nazisme sous l’angle, non pas unique mais principal, de son projet d’assassiner un peuple entier et, en outre, je le rappelle, de tenter de faire disparaître toutes les traces de l’existence antérieure de ce peuple. Non seulement exterminer les personnes, mais parvenir à les exclure de l’histoire passée, les rayer de la mémoire collective afin que tout se passe comme si elles n’avaient jamais existé. C’est pourquoi le crime nazi est le plus monstrueux jamais imaginé et jamais commis. Cela étant, ce qui est difficile à saisir, comme je l’ai expliqué lors de la précédente séance, c’est la manière et les raisons pour lesquelles la pratique criminelle nazie a évolué entre 1930-33 et 1945 dans le sens d’une « radicalisation » au terme de laquelle a été mis en œuvre cette inflexible volonté de tuer (les Juifs avant tout mais pas seulement eux, ne l’oublions pas), ce qu’on peut considérer comme l’aboutissement de ce qui avait toujours été un désir de mort.
I LE GROUPEMENT AGONISTIQUE NAZI
Ceci me conduit aujourd’hui à fixer le fil conducteur de ma présentation : je pense qu’il est plausible, pour suivre l’activité des nazis avant et après leur accès au pouvoir d’État, d’observer le groupe et les institutions constitués par et autour du parti, le NSDAP comme un groupe de combat qui s’est donné le but de mener une véritable guerre contre plusieurs fractions de la population allemande. Or ces « fractions » dessinent un ensemble dont les contours ne sont pas fixés a priori, si bien que, en réalité, toute la population est ou peut être inquiétée, et qu’elle est de fait menacée. C’est ce qu’on appelle communément un régime de terreur. Je préfère parler d’une « guerre interne » ; et je choisis cette dernière expression de préférence à « guerre civile », ou même « terreur » qui sont toutefois assez proches de ce que je suggère maintenant. En réalité, la guerre interne dont je parle, qui peut utiliser des armes (armes à feu ou armes blanches), n’ a pas pour premier objectif de tuer tout le monde ; son objectif est de tuer certaines personnes (y compris de les tuer socialement, en les enfermant et les soumettant à des mauvais traitements répétés), tandis que les autres, tous les autres, subiront une domination absolue, au sens où leurs actes et même leurs pensées, donc leur expression, ne sont admis que s’ils sont conformes à la doctrine officielle, donc ne peuvent jamais s’opposer - faute de quoi ces personnes tombent dans la catégorie des ennemis purs et simples, qui seront un jour ou l’autre éliminés..
Remarque
Je précise que ce groupe nazi, animé par une volonté essentiellement agressive et mortifère dans sa double visée (des parias et des bons citoyens), c’est ce que j’appelle un « groupement agonistique » c’est-à-dire un rassemblement de personnes spécialement constitué et organisé en vue d’abattre des ennemis, surtout si l’on estime dans ses rangs qu’il s’agit d’ennemis mortels. C‘est pourquoi je parle davantage de « guerre interne » que de terreur. Le mot « terreur » suggère que le groupement se défend contre une menace. Ceci est en partie vrai, mais en partie seulement, car l’essentiel c’est le fait que ce groupe se met en position non pas de défense mais d’attaque contre des personnes ou des collectifs dont il est persuadé (sur un mode délirant, paranoïaque) qu’ils sont des ennemis mortels, comme je le disais, et donc qu’il doit, pour assurer sa propre survie, engager contre eux une lutte à mort.
De même que je n’utilise pas beaucoup le terme de « terreur », je me dispense de recourir à la théorie de l’État ou du régime « totalitaire », qui laisse entendre que la répression est seulement destinée aux éléments déviants ou réfractaires, alors qu’elle est, dans la réalité pratique, je le répète, une guerre dont toute la population peut faire les frais.
Je vais donc décrire d’abord les pratiques violentes du nazisme, c’est-à-dire les fins et les moyens de cette guerre contre la population allemande. Ce que je cherche à saisir, en effet, c’est l’engagement essentiel et existentiel dans la violence que réclament et qu’effectuent les nazis comme groupe politico-milicien (un « groupement agonistique » ai-je dit) qui n’occupe le pouvoir d’État qu’en vue de mener, par le truchement de sa police et de ses milices ou d’autres instances de répression, un combat armé contre les fractions désarmées que sont les Juifs, les socio-démocrates, les communistes, les homosexuels, les handicapés, et toute personne, éventuellement dénoncée, qui dévie un tant soit peu de l’image de l’Allemand idéal, ou bien de de la doctrine national-socialiste officielle. Franz Neumann rappelle du reste que les Juifs ne furent pas les seuls à être envoyés dans les camps de concentration, car avec eux, notamment après le déclenchement de la guerre, il y a eu « des pacifistes, des conservateurs, des socialistes, des catholiques, des protestants, des libres penseurs et des habitants des pays occupés » (Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme, 1933-1944, Paris, Payot, 1987 [1944], p. 513).
On verra peut-être un paradoxe dans cette idée que les nazis font la guerre, par des moyens policiers et paramilitaires divers, à une population allemande qu’ils ne cessent par ailleurs de porter au pinacle. Car ils célèbrent la « communauté raciale » allemande (laVolksgemeinschaft ), en clamant qu’ils veulent la préserver de toute influence néfaste – et d’ailleurs Hitler souhaitait étendre cette population jusqu’à 200 millions de personnes (au lieu des de 65 millions que comportait l’Allemagne dans ses frontières traditionnelles) afin d’asseoir pour « mille ans » la domination mondiale dont il pensait qu’elle lui revenait de droit et de fait. Mais ce paradoxe n’en est pas un, justement parce que cette valorisation de l’Allemagne repose sur l’illusion (paranoïaque) d’une âme germanique (déposée dans la Volksgemeinschaft) dont Hitler et les nazis pensent qu’elle doit être cultivée et affermie grâce à des dispositifs de contrôle et de répression. Voilà ce qui, par définition, oblige tout citoyen allemand à adopter une stricte discipline pour réfléchir ses actes, ses propos, voire ses pensées.
Je précise ce point. Le fait est que le groupe nazi, tel que je le qualifie (« groupement agonistique » ), une fois parvenu au sommet de l’État - qu’il va détruire, d’une part déclenche des guerres de conquête à l’extérieur de ses frontières, et d’autre part fait à l’intérieur une guerre systématique à l’encontre de sa propre population. C’est bien pour mener cette guerre interne que les nazis ont instauré en 1933 une police politique, la Gestapo (« police secrète d’État », Geheimme Staatspolizei), ou bien qu’en 1936 Hitler a remis toutes les polices de l’Allemagne entre les mains de sa milice personnelle, la SS et son chef le Reichsführer-SS Heinrich Himmler secondé par le redoutable et venimeux Reinhard Heydrich. Même sorte de démarche avec la création en septembre 1939 de l’Office central de la sûreté du Reich, le Reichssicherheitshauptamt, RSHA, autrement nommé par ses opposants le « ministère de la terreur », qui réunissait sous domination SS toutes les polices et les services de renseignement issus du Parti, afin de lutter plus efficacement contre les « ennemis de l’État et du peuple ». Plus concrètement encore, il faudrait ranger dans la même rubrique l’ensemble des mesures permettant à partir de 1938 que le droit criminel dispose de nombreuses possibilités de condamnation à mort. Voir sur ce point (et sur bien d’autres) le très important livre de Martin Broszat, que j’ai plusieurs fois cité, L’État hitlérien. L’origine et l’évolution des structures du Troisième Reich, Paris, Fayard/Pluriel, 2012 [1970], p. 488 et suiv. C’est aussi dans cet cet esprit que sont sans cesse mobilisés les adultes, les hommes, les femmes, les jeunes gens, les garçons et les filles, tous étant obligés de participer à diverses associations, présentes dans tous les domaines de la vie sociale, le travail, les loisirs, l’éducation, les relations publiques et privées, etc.
On peut dire qu’Hannah. Arendt (et d’autres après elle), a une juste intuition d’un tel engagement des nazis dans une guerre sans fin contre l’Allemagne et les Allemands, lorsqu’elle parle du « mouvement »incessant que les régimes totalitaires impriment à la population et à la société toute entière (ce qu’on peut éventuellement rapprocher de l’idée trotskiste de « révolution permanente »), dans le but de dresser cette population à combattre toutes les personnes et les groupes inassimilables par la dite communauté allemande (voir H. Arendt, Le système totalitaire, op. cit., chapitre II : « Le mouvement totalitaire ». Voir aussi Emilio Gentile, Les religions de la politique. Entre démocraties et totalitarismes, Paris, Seuil, 2005).
Rien ne montre mieux l’entreprise guerrière dirigée contre l’Allemagne que la volonté exprimée par de Hitler à ses généraux juste avant de s’avouer militairement vaincu à l’Est par l’Armée rouge et à l’Ouest par les alliés, de punir le peuple allemand qui, selon lui, n’a pas été à la hauteur du grand dessein du « Reich de mille ans ».
De plus, sans la prise en compte de ce phénomène de guerre interne, de cet appétit de violence destructrice, on ne comprendrait pas l’élément irrationnel de la politique « totalitaire », qui poursuit à toute force ses buts d’anéantissement (en premier, l’’extermination des Juifs ), alors que cette pratique impose des dépenses de forces mentales et matérielles qui obèrent la guerre par ailleurs menée contre des armées étrangère (Un fait commenté par R. Aron, in Démocratie et totalitarisme, Paris, Gallimard, 1965, p. 297-298).
En conséquence d’un principe d’explication qui attire l’attention sur la guerre que les nazis dans l’État (ou du moins les organes du NSDAP qui y sont substitués (pour saisir la dissolution de l’appareil d’État au profit d’organismes parallèles, voir - Hans Mommsen, Le national-socialisme et la société allemande. Dix essais d’histoire politique et sociale..., op. cit., p. 76 et suiv.) poursuivent contre le peuple Allemand dans sa diversité, on concevra, qu’il n’est plus possible de retenir comme critère d’analyse l’insistance sur l’unité du peuple – que les nazis espéraient ranger en bon ordre derrière le drapeau à croix gammée. Car en fait, au-delà du projet d’une fusion identitaire raciale des individus dans leur ensemble national, la totalité indivise qui se nomme « communauté populaire » (Volksgemeinschaft), au-delà de ce fantasme d’une masse heureusement unanime dans son enthousiasme collectif, la pratique nazie réelle est au contraire celle de la division, de la soustraction, de l’amputation, bref de la destruction du commun des villes, des rues et des quartiers, des villages ou des assemblées de toutes sortes, politiques, syndicales, etc., une « diminution » a dit Himmler (cité par Alain Besançon, Le malheur du siècle. Communisme, nazisme, Shoah, Paris, Perrin, , 2005 [1ére édition, 1998], p. 46). Fions-nous à l’excellente formule de cet auteur qui parle aussi d’une : « vocation à exterminer tranche après tranche toute l’humanité » (A. Besançon, idem, p. 8). Si on observe la réalité des pratiques violentes, dont la création des camps de concentration dès 1933 n’est pas la plus anodine, alors, on est bien contraint de considérer comme une cause seconde, voire seulement comme une justification après coup, une « rationalisation » au sens freudien, la recherche d’une totalité fermée et sereine nommée Allemagne. Ne basons pas nos explications sur l’image, tant appréciée par les nazis, d’un peuple allemand qui ne serait fait que personnes semblables dans leur fidélité à une Église sacro-sainte et à son prophète nommé Adolf Hitler. L’apparence religieuse de ce genre de régime « totalitaire » ne doit donc pas nous inciter à en accréditer l’illusion. Nous devrions prendre avec précaution une expression comme « religion politique » qu’on a parfois été tenté d’utiliser pour qualifier la pratique et la politique nazies. Je pense à l’usage (discutable selon moi) de cette expression par Raymond Aron (Démocratie et totalitarisme, Paris Gallimard, 1965). Sur cette notion, je renvoie à la belle étude d’Yves Bizeul, « Le statut de la sainteté dans les ‘religions politiques’ », in Conserveries mémorielles, : http : // journals.openedition.org/cm/1643. Marcel Gauchet a spécialement exploré le point de vue de l’unité comme point de vue religieux (ce que je ne crois pas indispensable, donc). Voir notamment L’avènement de la démocratie..., op. cit., p. 521 et suiv... Voir aussi les analyses de Claude Lefort, et les commentaires publiés sur cet auteur par la revue Esprit, dans son n° 451, janvier-février 2019.
H. Arendt, dans Le système totalitaire (op. cit., p. 87), perçoit bien que le principe de la Volksgemeinschaft voue « à leur perte tous les peuples, y compris les Allemands ».
II TOTALITARISME et VIOLENCE
Pour conclure sur ce qui précède, je résume en quelques mots le point de vue que je me propose d’adopter pour décrire le nazisme non pas tant comme système de gouvernement (« totalitaire »), mais comme une pratique à orientation fondamentalement agonistique et criminelle. Je dirai que les nazis ont fait effort pour construire une sorte d’ersatz d’État qui, au contraire de l’État normalement défensif par rapport à une menace extérieure et normalement protecteur de sa population (comme les paysans du Moyen Age se réfugiaient dans le château fort de leur seigneur - qui cependant les saignait à blanc), s’organise de façon à mener une guerre sans fin à la propre population de son ressort, quels que soient les avantages par ailleurs concédés à cette population par rapport à d’autres, promises à l’esclavage ou à l’anéantissement pur et simple.
Remarque : pour préciser les objections que j’adresse à l’approche communément admise du nazisme.
Je constate d’entrée de jeu une difficulté de cette approche qui est celle de la philosophie politique dans sa tentative pour rendre compte du phénomène nazi, dès lors que, pensé comme phénomène « totalitaire », il est avant tout compris dans un processus de destruction de la démocratie libérale autrement dit de destruction, d’une part de la représentation politique en général (donc le suffrage et le pluralisme), et d’autre part de ce qui est la finalité de cette représentation, à savoir le fait de suspendre l’élaboration et la décision des lois à un échange d’arguments, à la confrontation des opinions, des doctrines, au fait qui consiste à parlementer en vue de dégager une majorité, comme on le fait dans différentes instances comme... des parlements, précisément. Voilà donc ce que le nazisme a détruit afin d’établir une emprise mentale et physique sur les masses. Ceci est tout à fait exact, je n’en disconviens pas. D’autant moins que c’est très évident. Mais si on s’arrête à cela, et si on n’a que cela pour critère d’analyse, alors on se contente de situer le nazisme dans un cadre politique, et c’est là ce qui me semble insuffisant parce que, selon moi, ce qui caractérise le nazisme est hors de la politique. Le nazisme, ce n’est pas seulement et, dirai-je même, ce n’est pas d’abord une politique en ce sens. C’est bien plutôt, j’y ai assez insisté, une production spécifique de violence, avec des moyens eux-mêmes spécifiques, inédits, donc une violence mise en circuit et qui s’écoule à la place du « jeu » politique » moderne, le jeu représentatif et parlementaire dont je viens de parler, et aussi, en arrière-pan, le jeu des juridictions, des organismes de conseil, des administrations, avec des centres de pouvoir autonomes, etc.
Il faut comprendre que ce jeu complexe, tel qu’il s’exerce dans l’État démocratique, est destiné à mettre fin, disons au moins à endiguer et limiter... la violence, les meurtres, la destruction physique d’adversaires considérés comme des ennemis : c’est donc pourquoi ce jeu normal a été systématiquement empêché et supprimé par les nazis. De ce point de vue, le nazisme renoue avec de très vielles pratiques de violence, et on peut y voir une formidable régression, un retour à une sorte de tribalisme anté-historique...
De ce fait, ce n’est pas non plus une religion de substitution, même s’il a tenté de se faire passer pour une nouvelle Église, porteuse dune culture sacrée (la culture raciste dont j’ai déjà traité l’an passé séance 8).
Je propose donc de décrire le nazisme :
a) comme une activité de lutte, de guerre contre la population allemande (avec un courant de répression fondamental et permanent, sous forme d’arrestations, détention, assassinats, etc.), donc une activité qui fragmente infiniment la société réelle dans l’espoir de n’avoir un jour plus affaire à rien d’autre qu’à une sorte de groupe ethnique représentant l’âme éternelle de la race (la race des « seigneurs » en l’occurrence), que refléterait l’unité du peuple . Ceci pourrait se déduire de l’étude fort intéressante de Wolfgang Sofsky, même si cette étude se donne pour objet la « terreur », notion, je l’ai dit plus haut, que je trouve limitative (L’organisation de la terreur. Le camp de concentration, Paris, calmann-lévy, 1995 [1993]. J’apprécie cependant beaucoup certains passages (et le livre entier, bien sûr) , exemple la p. 37 qui définit le camp comme un « laboratoire de la violence » qui « supprime les frontières de la cruauté ».
b) cette activité s’appuyait sur la création et l’accroissement (vertigineux en réalité) des succursales militarisées qui, au total, composèrent une impressionnante soldatesque (que je décrirai donc en premier). Je pense aux SA (décapités, il est vrai, lors de la « nuit des longs couteaux » fin juin et début juillet 1934, pour des raisons que je dirai), puis aux SS, avec Himmler à leur tête, bientôt distribués en différentes branches, dont la branche strictement militaire de la Waffen SS… Ces organismes de terreur finirent par comporter des effectifs qui se chiffraient en millions d’hommes ! En plus de cela, les nazis parvinrent à ériger et à maîtriser plusieurs autres institutions de répression et de guerre, parfois créés à l’intérieur des organes policiers existants. J’en parlerai précisément plus loin également…
c) en même temps, cette activité cherchait à agréger le plus possible d’individus au groupement agonistique, le groupe militaro-sectaire du Parti et des ses organes hors et dans l’État (quand les nazis occupent le pouvoir).
d) de façon très logique puisqu’il est question de guerre (si l’on accepte mon hypothèse), la population allemande non enrôlée au (aux) groupement(s) agonistique(s) de base était systématiquement mobilisée. J’ai bien dit toute la population allemande : les travailleurs, les jeunes adultes, les enfants et les adolescents, le femmes et les jeunes filles, toutes les catégories étaient invitées à rejoindre des organismes spéciaux, dont le plus connu, qui devint même obligatoire en 1936 pour tous les enfants au dessus de 10 ans (garçons et filles dans des sections différentes), se nommait la Jeunesse hitlériennes (Hitlerjugend).
Je tiens cette forme douce de mobilisation pour un élément essentiel du projet des nazis, qui était bien le projet de mener une guerre interne tous azimuts… Parmi les autres faits allant dans le même sens, j’ai évoqué les appareils policiers nazis (comme la Gestapo), ainsi que la formation et l’utilisation de la gigantesque soldatesque paramilitaire des S.A. puis des S.S. (que je décrirai plus loin).
Sur un plan plus général, il faut en outre mesurer l’extraordinaire présence des soldats et la prégnance de l’instance militaire ou para-militaire dans la pratique politique des nazis (une présence très sensible pour les Allemands entre les deux guerres). Certes, ne confondons pas la soldatesque dont je parle avec l’armée régulière que furent la Reichswehr puis la Wehrmacht (créée le 16 mars 1935). Mais il n’en demeure pas moins que l’élément militant-militaire, les milices du parti nazi (S.A. puis SS), comme celles des autres partis d’ailleurs, sont des piliers de la société allemande de l’entre deux guerres, comme on le constate en regardant les images de cette époque, les archives photographiques ou cinématographiques. Associée au - et dépendante du - parti nazi, créée par lui, sollicitée par lui, cette soldatesque est en effet une figure spectaculaire omniprésente dans des réunions, des défilés et des parades diurnes ou nocturnes (qu’on multiplie comme des démonstrations de force dans un but d’emprise et de propagande à la fois).
Le défilé est une activité centrale de la S.A. - qui est aussi spécialisée dans les bagarres avec les partis adverses, dans les rues et les salles de réunion. Les milices sont donc très visibles dans de telles images de propagande, la plupart du temps sous la forme d’une multitude ordonnée qui défile en rangs serrés, au pas cadencé, toujours en uniforme, casquée, poignard à la ceinture, avec des participants qui brandissent fanions, drapeaux, oriflammes, derrière des fanfares éclatates…, tandis que sur des estrades ornées elles aussi des même fanions et drapeaux, trônent des chefs radieux, tirés à quatre épingles dans ces mêmes uniformes sur lesquels sont arborés des insignes bien visibles, et qui contemplent leurs féaux dévoués en les saluant bras tendu... Ceci pourrait même nous faire oublier qu’il y avait en de ça, en Allemagne, une société « normale », avec de nombreux groupes constitués dans les contextes du travail ou des loisirs (entre autres), bref, une vie habituelle dans ces cadres sociétaux au sein desquels, par conséquent, pouvaient encore se faire entendre des voix dissonantes, des réactions de doute, d’hostilité, etc. (comme on le voit dans le journal de Viktor Klemperer, lui qui s’étonne du crédit dont jouit ce chef du parti nazi, Adolf Hitler, lorsque, devant ces foules compactes rassemblées dans d’immenses esplanades, il s’agite en hurlant comme un « ouvrier ivre »).
Certes, les images dont le parle, très nombreuses, très prégnantes, révèlent surtout la stratégie d’influence conçue par Goebbels, le ministre de la propagande (« Ministre de l’éducation du peuple et de la propagande du Reich »), et l’effort des dirigeants nazis pour séduire le public en lui offrant une image de leur puissance et de leur capacité à créer un ordre social nouveau, solide, protecteur, assez fort pour défier le monde entier. Hitler a d’ailleurs clairement énoncé l’intérêt, fondamental pour lui, de ces démonstrations au terme desquelles il haranguait la foule. Il pensait en effet que « tous les grands événements qui retournent le monde entier, ont été provoqués par la parole et non par des écrits » (Mein Kampf, op. cit., p. 467). Disons par conséquent que si la soldatesque est montrée, et montrée de façon récurrente, c’est pour instiller l’idée d’une sorte de triomphe militaire à venir et... prochain.
Là se fait jour l’Allemagne que les nazis appellent de leurs vœux et dont ils s’efforcent de faire accepter le projet… à savoir une Allemagne et des Allemands qui combattent, qui réunissent leur force, et qui donnent libre cours à leur agressivité contre ceux qu’on a désignés comme des ennemis irréductibles : les Juifs et de larges fractions de la population, je l’ai dit : les sociaux-démocrates et les personnes organisées par leur parti, le SPD, ses syndicats, et au-delà tous les soutiens de la République de Weimar. La marche résolue et triomphale de la soldatesque fait donc tenir ensemble et fusionne le plan de l’amour du « nous, Allemands » et celui de la haine du « eux », les ennemis, à combattre coûte que croûte .
On peut considérer comme une autre confirmation typique de la volonté guerrière essentielle des nazis l’entrée au Reichstag de leurs députés après les élections du 14 septembre 1930 , où ils ont obtenu 18,25 % des suffrages (6 379 672 voix), et 107 sièges (au lieu de 12 auparavant, tandis que le parti social démocrate reste en tête avec 24,53% et 143 sièges). Car cette entrée tonitruante fut effectuée, afin de frapper l’opinion, par des députés qui avaient pris le soin de revêtir l’uniforme à chemise brune des S.A., ce qui pouvait faire de leur entrée massive au Reichstag un événement annonciateur de leur volonté.
Cet événement eut en outre des répliques dans l’Allemagne profonde. À Northeim, une petite ville de Basse-Saxe (étudiée par William Sheridan Allen dans Une petite ville nazie (1930-1935), Paris, Robert Laffont, 1967 [1965] - Northeim est rebaptisée Thalburg dans le livre), lorsque les nazis deviennent majoritaires au Conseil municipal, après la nomination d’Hitler comme Chancelier, le 30 janvier 1933, et après les succès nazis aux différentes élections, générales ou locales, à Northeim donc, les nazis font une première réunion publique le 28 mars dans une grande salle de bal, et leurs quinze élus, membres d’une liste dite d’« union nationale », ont eu bien soin eux aussi de revêtir la chemise brune et d’arriver ensemble sur les lieux de la réunion, où de nombreux hommes de la SA locale ont déjà investi le hall, tandis que les SS, également locaux, aident la police à maintenir l’ordre à l’extérieur...
Ainsi, grâce à leur nombre et à l’uniforme, la chemise brune qui signale leur esprit militaro-militant, les nazis espèrent-ils impressionner l’opinion en exposant aux yeux de tous un mouvement décidé et harmonieux de troupe unifiée et disciplinée, comme un régiment, prêt à déclencher la lutte en vue de posséder le monde.
Dans cet ordre d’idées, on ne peut pas tenir pour rien le fait que la plus puissante des associations d’anciens combattants après la guerre de 1914, la Ligue des soldats du front (Bund der Frontsoldaten), proche sinon affiliée au Parti national du peule allemand, le DNVP, ait abrégé sa nomination en « Casque d’acier » (Stahlhelm), une référence au casque militaire bien connu, destinée en l’occurrence à troubler, et peut-être à faire peur... (sur l’histoire du casque militaire, voir Robert Muchembled, Une histoire de la violence, Paris, Seuil, 2008, p. 125 ). Cette organisation sera en grande partie intégrée à la S.A. en 1935.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par fjf le 19 Mai 2021 à 10:24
Séance 6
LE NAZISME ET LES NAZIS COMME « GROUPEMENT AGONISTIQUE »
(suite)
Pour prolonger mes remarques de la séance précédente, je vais aborder les principales pratiques de violence ayant secoué la société allemande de l’entre-deux-guerres, et sur lesquelles les nazis se sont appuyés pour préparer puis mener cette « guerre interne » dont j’ai parlé – je dirai plus volontiers et plus précisément : pour instaurer un état de guerre propice à la réalisation de leurs projets agonistiques. Mon hypothèse de traitement consiste en ce sens à inverser la fameuse formule de Clausewitz ; donc à parler non pas de la poursuite de la politique par la guerre avec les moyens de la guerre, mais de la poursuite de la guerre par la politique. En l’occurrence, la guerre est celle qu’un État ou qu’un groupement avant et après qu’il se soit emparé des rouages de l’État, mène contre des fractions plus ou moins étendues et définies de la propre population de son ressort. Ceci survient lorsque l’enjeu très simple est d’abattre physiquement des ennemis, plutôt que de tenter de l’emporter sur des adversaires par le suffrage, après confrontation et débat des programmes et des opinions...
Reste que, dans un premier temps, avant d’accéder au pouvoir pour ensuite se livrer à l’exercice agonistique à visage découvert, les nazis ont donné le change. Après l’échec du putsch de 1923 à Munich, ils ont compris qu’ils ne pourraient parvenir à leurs fins que par des voies légales, et ils ont mis en œuvre ce que nous pouvons considérer comme une ruse : pendant un temps (mais un temps seulement) ils ont joué le jeu électoral dans le cadre fixé par la République de Weimar après la Grande Guerre, et ils ont plus ou moins modéré leurs intentions et leurs capacités de violence (mais non pas leur agressivité). Ce genre de dissimulation a été renouvelé plus tard, et s’est révélé très efficace pendant les jeux olympiques de Berlin, en 1936. Il fallait berner les étrangers, venus nombreux. Rares sont ceux qui ne s’y sont pas laissé prendre. J’en citerai un seul : André François-Poncet, diplomate, ambassadeur de France en Allemagne à cette époque, dont les rapports montrent qu’il avait compris bien des choses (ils ont été republiés récemment : A. François-Poncet, Les rapports de Berlin, Paris, Fayard, 2016).
Remarque
A propos des troubles (le mot est faible) de 1919, je précise que les « Corps francs », Freikorps, étaient des associations de volontaires issu de l’armée combattante en 1914, qui constituaient des sortes d’armées privées. Et que ces armées, en janvier 1919, furent mises au service de l’État afin de réprimer le soulèvement communiste (spartakiste), qui avait tenté d’instaurer la Räterepublik, la République des conseils. Celle-ci fut écrasée dans le sang, et comme on sait, ses dirigeants, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, exécutés. C’est un membre d’un Corps franc de Berlin qui, le 15 janvier 1919, probablement sur ordre d’un social-démocrate, se chargea de l’exécution. Ian Kershaw a raison de signaler que la population allemande de cette époque a accepté ou du moins s’est accommodée d’« un haut niveau de violence politique » (Hitler, t .1, op. cit ., p. 261), ce qui serait dû à l’impact de la guerre de 14, puis de la quasi guerre civile et des troubles révolutionnaires de 1919 (explication juste mais limitée, me semble-t-il).
III MILITARISATION ET VIOLENCE DANS LA SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE L’ENTRE-DEUX- GUERRES
Je considère que la tendance guerrière des nazis et d’autres groupes politiques à la même époque, a eu une conséquence très visible, quoique pas vraiment analysée : la militarisation de ces groupes politiques, et la militarisation des moyens utilisés par ces groupes pour conquérir l’État. En première approche, ce processus passe par l’appui très fort de ces partis, et notamment du parti nazi, le NSDAP, sur des milices créées comme des organismes para-militaires, dotées d’uniformes et surtout d’un armement (après la guerre, l’armée n’ayant pas été détruite, un grand nombre d’armes étaient disséminées et en circulation dans la société). Très puissantes, certaines de ces milices devinrent comme une armée de substitution - la Reichswehr étant réduite à la portion congrue par le traité de Versailles (limitée à 100 000 hommes). Ernst Röhm, chef des S.A. (Sturmabteilung) la redoutable milice paramilitaire au service du parti nazi, était persuadé que ses hommes devaient être purement et simplement intégrés à l’armée officielle (rétablie ensuite, en mai 1935, sous l’intitulé de la Wehrmacht).
Or si on est attentif à la manière d’agir des nazis, on se rendra compte que, cédant, avec enthousiasme sans doute, à leur désir de violence, ils n’ont pas toujours pu ou voulu cacher leurs tendances agonistiques réelles et, au contraire, ils les ont fait apparaître, les mettant au niveau d’un véritable idéal de vie militaire c’est-à-dire de vie de combat. C’est ce que montre l’événement (déjà évoqué lors de la séance précédente), de l’entrée au Reichstag en octobre 1930, des 107 députés nazis groupés et portant tous l’ uniforme à chemise brune des S.A. Les S.A., c’est la milice qui, depuis les années 1920, est chargée de toutes les basses besogne que commande le parti nazi (encore groupusculaires)..., à commencer par les bagarres et les agressions lors des réunions électorales des adversaires.
1)
Hitler lui-même, à la tête depuis juillet 1921 du parti refondé par lui comme NSDAP, participa avec ses sbires à des interventions d’une grande brutalité dans des rassemblements d’adversaires politiques. Il n’hésitait pas à faire le coup de poing. C’est ainsi que le 14 septembre 1921, le chef de la Ligue bavaroise (une ligue séparatiste), Otto Ballerstedt, fut jeté en bas de la tribune où il avait pris place, et, durement frappé, il demeura sur le sol, inanimé et sanglant… A la suite de cela, en janvier 1922, Hitler fut condamné à trois mois de prison dont deux avec sursis pour attentat à la liberté de réunion et coups et blessures .
Pour les élections du 5 mars 1933, dernières élections libres après l’accès de Hitler à la Chancellerie fin janvier, les grandes villes allemandes furent le théâtre de nombreuses échauffourées opposant les milices d’extrême droite aux milices de gauche et d’extrême gauche. Chaque jour, la presse se faisait l’écho de bagarres mortelles. Au 22 février 1933, au moins 62 personnes, dont la moitié de militants communistes, avaient trouvé la mort dans ces pugilats (ce chiffre est donné par François Delpla, Une histoire du IIIe Reich, Paris, Perrin, 2014, p. 57). Dans les années 1930 et avant cela, les agressions commises par des militants ou des nervis, notamment à l’occasion des campagnes électorales, connurent un tel essor que le Chancelier Franz von Papen, prit, le 29 juillet 1932, une loi martiale interdisant les réunions publiques. Il pensait mettre un terme aux bagarres qui éclataient entre communistes et nazis. Il n’en fut rien.
Les années suivantes, la destruction de l’État démocratique par les nazis va s’accompagner de meurtres dans les camps de concentration nouvellement créés. Et en juin 1934, incité par sa garde rapprochée, Göring, Himmler et Heydrich, le Führer va lui-même ordonner l’assassinat des chefs des S.A. et de son ancien ami Ernst Röhm, déclenchant ainsi une vague de plusieurs dizaines voire de plusieurs centaines d’exécutions à travers l’Allemagne.
Dans ce contexte, il y eut aussi des assassinats de personnalités officielles. En fut victime le 24 juin 1922 Walther Rathenau, le ministre des affaires étrangères de la République de Weimar. Dans l’Allemagne de l’entre-deux-guerres, la violence finit donc par faire partie du paysage familier des habitants des grandes et des petites villes. (ce que montrerait un autre chiffre, celui qui établit que près de 400 attentats ont été perpétrés entre 1919 et 1922 - à cela correspond aussi l’augmentation du nombre d’homicides commis par des personnes sans antécédents judiciaires après la guerre de 14 .(d’après George L. Mosse, De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes…, Paris, Hachette, 1999 [1990], p. 194).
Cependant, il faut voir que dans cette période, la violence et notamment celle organisée par les nazis, s’est manifestée en Allemagne de bien des manières. En voici un exemple. Une jeune fille de Berlin, Melita Maschmann, relate dans un texte postérieur à la guerre le grand défilé organisé par Goebbels le soir du 30 janvier 1933, alors qu’Hitler venait d’être nommé Chancelier. M. Maschmann, qui était dans la période nazie responsable de la section féminine des Jeunesses hitlériennes, décrit la marée de drapeaux rouges et noirs agités par des garçons et des filles, adolescents comme elle. Puis elle raconte que lors de cette parade triomphale elle vit « soudain », quelqu’un sortir de la colonne et frapper un homme qui se trouvait dans le public, à quelques pas. Peut-être cet homme avait-il fait entendre des quolibets ou lancé des injures… Quoi qu’il en soit, poursuit la jeune fille, « Je le vis tomber, le visage en sang, et je l’entendis crier. […] Son image me poursuivit, des jours durant »1. (Texte cité par Richard J. Evans, Le Troisième Reich, t. 1, L’avènement, Paris, Flammarion, 2009 [2003], p. 384). Il est vrai qu’au centre du défilé, les « chemises brunes » font régner la force brutale.
Les défilés furent très prisés des nazis, comme des démonstrations de force, certes, mais aussi parce qu’ils étaient conçus sur le modèle d’une marche militaire, la marche d’une troupe disciplinée, si possible massive, qui avance en bon ordre vers sa victoire et sa conquête. Un rapport d’André François-Poncet, ambassadeur de France en Allemagne (A. François-Poncet, Les rapports de Berlin, op. cit., rapport du 13 septembre 1936, p. 148) traite du 7ème Congrès de Nuremberg et il parle d’un
« Spectacle grandiose (…) ». Une « succession hallucinante de tableaux vivants aux proportions gigantesques, déroulement ininterrompu de réunions monstres, de défilés qui sont de véritables fleuves humains, de parades qui mettent sur pied les effectifs d’armées entières ». Le rapport décrit aussi (p. 149) « des centaines de milliers d’hommes (…) une véritable migration (…) des foules innombrables, mues par un même sentiment et un même désir, voir et entendre l’homme prodigieux qui exerce sur son pays une action magique (…) , une sorte de Messie de la race germanique ».
Et encore, ceci, qui s’accorde bien à l’idée d’un grand fantasme militaire-violent :« L’apothéose de l’armée s’est confondue avec celle du Führer, restaurateur de la puissance militaire allemande ».
A. François-Poncet ajoute (ce qu’il souligne en italiques ):
i
« Afin d’assurer la formation de la jeunesse, toute une série d’écoles permettront d’assurer, de compléter et de parfaire l’éducation physique et politique du citoyen : escouades ‘Jeune Peuple’, compagnies d’éclaireurs, Jeunesse hitlérienne, service du travail et service militaire. ». Conséquence sur la jeunesse allemande (p. 150) . « Elle est avide de servir. Elle se réjouit de porter l’uniforme, d’appartenir à une formation, de répondre à des convocations, de prendre part à des défilés. Elle y acquiert le sentiment de son importance » - ce qui ne calme pas l’inquiétude de certains parents, qui se désolent de la brutalité, qui déplorent l’irréligion. Une mère, note A. François-Poncet, lui raconte qu’un chef de groupe a imaginé un concours dans lequel les enfants devaient s’allonger sur une voie de chemin de fer et ne se lever que le plus tard possible à l’approche du train.
2)
Dans cette période, les pratiques violentes sur fond d’idéal de vie militaire (j’insiste sur mon hypothèse) sont surtout le fait les milices associées aux partis politiques de droite ou de gauche et qui suivent leur orientation agonistique. Dans la petite ville de Northeim étudiée par W.S. Allen, une cité pareille à beaucoup d’autres dans sa morphologie et sa sociologie, et qui a eu vent, quoique de loin, des mêmes agitations sociales et politiques, on observe une grande présence des groupes paramilitaires : les S.A. des nazis, le Stalhelm, et la Reichsbanner, la milice de gauche, liée au SPD - qui sera dissoute en mars et avril 1933, dès l’arrivée au pouvoir des nazis (les syndicats connaîtront d’ailleurs le même sort). Ces groupes sont très désireux de se montrer et ils défilent en uniforme et, souvent, commettent souvent des agression ou participent à des bagarres. Défilés, réunions, discours sont toutefois l’essentiel de leurs activités.
La liste des organisations présentes dans cette ville est très impressionnante. - ce qui n’est pas une singularité par rapport aux autres villes de ce type. Il y a des groupements plus ou moins rattachés à l’armée, à une arme précise, à une formation militaire quelconque. C’est par exemple l’« Association des anciens du 91e de réserve », ou bien l’« Association de cavalerie » ; ou encore la « Ligue des combattants », la « Ligue des blessés de guerre »… Ensuite, du côté plus explicitement nationaliste, on a l’« Association pour le rayonnement de l’Allemagne à l’étranger ». On a aussi des spécialisations comme l’« Association des femmes national-socialistes », ou bien encore, pour les femmes toujours, l’ « Association d ela reine Louise ». A quoi il faut ajouter, comme je l’ai déjà suggéré, les organisations de jeunesse, liées aux différents partis ou bien à des groupements comme le Stahlhelm. Toutes ces associations sont très influentes dans les classes moyennes, et elles comportent beaucoup de membres. A Northeim toujours, la plus petite association (sur un total de 167 dans la ville ), est celle des Anciens artilleurs, qui compte 30 membres. La Ligue des combattants en a 400 en 1930. Il existe, d’après l’auteur, 27 autres sociétés de ce genre. Car il y a en outre 8 chorales dont une pour les ouvriers, qui compte entre 25 et 65 membres. A Northeim, 400 personnes chantent. Il y a aussi 5 associations de tir (qui maintiennent une très vieille tradition de défense des murs de la ville). Il y a enfin des clubs divers, pour l’horticulture, pour les buveurs de bière (qui peuvent aussi jouer aux cartes), des Stammlische, des hommes qui déjeunent ensemble chaque semaine à la même table (d’où le nom)… La sociabilité est donc particulièrement développée, et c’est bien sur cette tendance lourde que vont se greffer les processus de militarisation de la société civile.
A Northeim, les nazis apparaissent au début de 1930. Rapidement ils font connaître leurs membres, leurs chefs, et surtout leurs propositions et leurs slogans (notons que c’est le moment où les conséquences économiques de la crise de 1929, en particulier le chômage, deviennent sensibles). Jusqu’alors, Northeim est une ville peu réceptive aux grandes agitations du temps. Il y règne, dit W.S. Allen, une sorte de placidité petite bourgeoise, avec des chemins de promenade dominicale et des rues calmes qui serpentent entre des maisons médiévales. Or en mars 1930, le camp socialiste commence à s’inquiéter de la présence de ces nazis, un acteur nouveau mais énergique et apparemment sûr de lui. En conséquence, la milice liée au SPD, la Reichsbanner, tente d’alerter l’opinion publique lors d’une de ses assemblées. Un mois plus tard, le 27 avril, la même organisation, s’associe aux syndicats, au SPD et à un petit parti démocrate avec lesquels elle prépare une grande manifestation destinée à affirmer son opposition au NSDA. Il est prévu que cette manifestation débouche sur la place du marché, où un discours sur le thème Dictature ou démocratie ? serait prononcé, dans une grande salle attenante, le Tivoli. De leur côté, les nazis entendent faire face ; ils relèvent le défit et prévoient pour le même jour une autre grande manifestation, qui déboucherait elle aussi sur la place du marché, et se solderait elle aussi par un grand discours mais cette fois dans la salle du Marché aux bestiaux (c’est juste avant le premier grand succès électoral national des nazis, en septembre 1930, qui les fera passer à 107 députés, avec 18% des voix). Alors les esprits s’échauffent. La tension montre. Plusieurs bagarres éclatent. Avant cela, en Prusse pendant trois mois, jusque fin mars, les rassemblements de ce type avaient été interdits à cause des risques de violence. Finalement les nazis prévoient leur réunion en dehors de la ville. Mais c’est pour y amener 800 S.A. et un public de 2000 personnes, qui terminent la journée par un défilé dans les rues de la ville, défilé qui, de l’aveu général, impressionna fortement les habitants.
A nouveau, je remarque que le défilé dans l’ordre et la discipline (militaires), procure aux habitants une impression spéciale, de contrôle et de sécurité à la fois. W.S. Allen souligne l’alliance du patriotisme et du militarisme qui sont, dit-il, un gage de respectabilité au yeux de la population. L’efficacité de la recette se vérifie d’ailleurs le 17 mai, lors de la visite du maréchal von Mackensen, à l’invitation de « Club de la milice et des réservistes » (une association non nazie). Ce jour-là, le maréchal est accueilli en grande pompe à la gare par mille personnes, il a droit à une offrande de fleurs par une petite fille, puis il passe en revue un groupe d’anciens combattants en uniforme, bien alignés, en présence de leurs associations ; enfin tout le monde s’adonne à une marche triomphale derrière le maréchal qui parade sur un cheval blanc dans la ville, par les rues et les maisons pavoisées aux couleurs de l’ancien Reich. En conclusion le maréchal prononce un discours sur la nécessité pour l’Allemagne d’avoir une armée forte, après quoi tout le monde se quitte en chantant Deutschland über alles. Trois jours de festivités à la suite ! Même genre d’enthousiasme en août à l’occasion du passage d’un régiment dans la ville, le 17ème régiment d’infanterie, unité d’élite (je suis l’évocation de W.S. Allen).
3)
Le processus de « militarisation » de la société et donc de la sphère politique est encore plus clair quand on observe la diffusion de certains symboles forts de la vie militaire ou paramilitaire. Voici un exemple des plus significatifs, celui d’une société d’anciens combattants, la Ligue des vétérans du Front, proche du Parti national du peuple allemand (le DNVP). Très puissante dans l’entre-deux-guerres, elle fut plus connue sous l’intitulé du « Casque d’acier » (Stahlhelm), en référence au casque bien connu (il y a une histoire du casque, comme instrument destiné à la foi à protéger la tête et à effrayer l’ennemi) .
Dans le même ordre d’idées, il est certain qu’ une véritable « mystique de l’uniforme » (comme a pu dire W. S. Allen), s’est emparé aussi bien des nazis que des autres partis, notamment les partis nationalistes, dans l’Allemagne de cette époque. Même les garçons et les filles de la Jeunesse hitlérienne (dans des organismes séparés, non mixtes) recevaient un uniforme, ainsi qu’un couteau sur lequel était gravé un slogan nazi. De nombreux récits révèlent (voir aussi A. François-Poncet), le plaisir que les garçons retiraient de ces moments spéciaux. Un témoin raconte du reste qu’en 1936, on pouvait apercevoir dans chaque ville : « les uniformes gris de la Wehrmacht, les uniformes noirs de la SS, les uniformes bruns de la SA et les culottes courtes des Jeunesses hitlériennes » (Peter Fritzsche, Vivre et mourir sous le IIIe Reich. Dans l’intimité des Allemands, Paris, André Versaille éditeur, 2012, p. 72). Et lorsqu’en 1930 le ministre de l’Intérieur de la Prusse tenta de proscrire le port de l’uniforme, notamment les fameuses chemises brunes des S.A., estimant que la dite chemise avait pour effet d’enhardir ceux qui la revêtaient, qui pouvaient ensuite se livrer à toutes sortes d’agressions, il y eut en juin, dans les rues de nombreuses villes, une grande protestation. Dans la ville plus modeste de Northeim étudiée par William S. Allen, 400 S.A. de la région, se rassemblèrent et défilèrent, tous revêtus d’une chemise blanche. (W. S. Allen, Une petite ville nazie, op. cit., p. 54-55).
Cette photo vient du musée situé à Munich sur l'emplacement de la maison du Parti nazi, détruit. Derrière Hitler, on reconnaît son grand ami Ernst Röhm, le fondateur de la S.A. - ami que Hitler fera néanmoins assassiner lors de la "nuit des longs couteaux", en 1934. Mais que voyons-nous d'abord dans cette photo? Des uniformes... CQFD
Je m’arrête sur la Jeunesse hitlérienne, la Hitlerjugend, car cette organisation, qui finit par être obligatoire en 1939 (mais il était difficile d’y échapper avant cela) pour tous les garçons et les filles de 10 à 18 ans, marque au mieux la volonté nazie d’embrigader la jeunesse – et c’est un aspect essentiel de ce que j’essaye de saisir sous le terme de militarisation.
Pour les filles, il y avait la Ligue des jeunes filles allemandes (Bund deutscher Mädel, BDM) et, pour les plus jeunes, de 10 à 14 ans, la Ligue des jeunes filles. De même la section des garçons accueillait les enfants de 10 à 14 ans dans une sous-section particulière, le « Jeune peuple allemand ». En 1938, une autre sous-section fut créé à destination des filles de 17 à 21 ans, intitulée « Glaube und Schönheit », Foi et beauté. Et, pour couronner le tout, les nazis publièrent des journaux adaptés à ces différents publics. Tous les membres de la Hitlerjugend devaient s’abonner au mensuel Sturmjugend und Kopferblätter. Il y avait aussi le Deutsches Jungvolk, un mensuel pour le Jeune peuple allemand comme son nom l’indique. Quant à la feuille réservée à la correspondance officielle de la jeunesse hitlérienne, elle était intitulée le Nachrichten und Artikeldienst der N.S. Jugend.
Le côté militaire était donc particulièrement insistant. Il allait jusqu’à imposer aux jeunes de prononcer un serment de fidélité. Un film de David Korn-Brzoza sur les Jeunesses hitlériennes (2017), cite ce serment qui énonce : « Devant cet étendard qui représente notre Führer, je jure de consacrer toute mon énergie et toute ma force au service de notre Führer Adolf Hitler. Je suis fier de donner ma vie pour lui. Et que Dieu me vienne en aide. ».
Dans la Hitlerjugend, sans aucun doute en rapport avec le serment, était admis le principe de l’obéissance absolue aux décrets du Führer (Führerprinzip) et aux ordres de ceux chargés de transmettre ces décrets.
Remarque
Je précise en passant que le serment, qui suscite l’activation d’un honneur personnel, était couramment pratiqué dans les organes nazis, et que les nazis convaincus y attachaient une très grande importance . Lors de son procès à Jérusalem en 1961, Adolf Eichmann, qui tentait de se défiler en prétextant qu’il n’avait fait qu’obéir à des ordres supérieurs, assure cependant que trahir un serment (comme celui qu’il avait prononcé à son entrée dans la SS) lui eut été quasiment impossible.
J’ai parlé de l’uniforme revêtu dans la Jeunesse hitlérienne, et avec un très grand plaisir pour la plupart d’entre les jeunes gens concernés. Pour les garçons, c’était un uniforme comparable à celui des S.A. avec la fameuse chemise brune . La tenue reprenait même les insignes et les grades de la S.A. Mais il faut savoir que l’uniforme était payé par les parents, qui recevaient un ordre écrit leur enjoignant d’acheter l’équipement complet, y compris le poignard, muni d’une lame de 20 cm… Un poignard dit « poignard d’honneur » était aussi attribué aux élèves des écoles spéciales destinées à la formation des futurs cadres nazis (les « écoles Adolf Hitler » et les « Napola » – dont je traiterai une autre fois)... Sur ce poignard était gravée la devise : « Plutôt être que paraître » ; et en plus une devise plus personnelle, spécialement adressée à celui à qui l’arme était remise, par exemple : « Seuls les vrais hommes ont la force de se dresser contre un monde hostile » (ce qui était en l’occurrence une sentence de Göbbels).
Uniforme, insignes, grades, poignards, culture de l’obéissance et du sacrifice… Voilà donc en fin de compte ce qui caractérisait la Hitlerjugend, donc tout ce qui entre dans le contenu de ce que je propose de nommer « militarisation ».
Sur le fond, les jeunesses hitlériennes se présentaient comme un mouvement de jeunesse du genre des scouts, qui proposait à des enfants et des adolescents une série d’activités de plein air, marches, voyages, sports divers, campements, etc., ce qui fournissait aussi l’occasion d’une préparation militaire qui ne disait pas son nom, et qui d’ailleurs n’était pas perçue comme telle, bien que les activités ordinaires des jeunes gens réunis comportaient des exercices comme marcher au pas, apprendre à lire des cartes, transmettre des messages, etc. Évidemment, en étaient exclus les Juifs et les socialistes, d’autant qu’aux enfants et aux adolescents était chaque semaine exposée la doctrine de la hiérarchie des races.
Du même A. François-Poncet, un autre rapport, du 24 juillet 1935, évoque les camps de vacances de la Jeunesse hitlérienne (p. 137-141 ) et décrit la vie du camp, son régime indépendant de toute influence familiale ou religieuse, la grande place accordée aux exercices physiques, les marches, les sports, notamment nautiques . A. François-Poncet en déduit judicieusement la constitution d’une véritable mystique de la nature appelée à se substituer au christianisme, et adéquate au héros aryen, façonné au grand air sous le soleil. A. François-Poncet n’oublie pas la dimension autoritaire de ce militarisme, la prégnance de la forme de la caserne et d’une hiérarchie de chefs dont certains étaient recrutés parmi les enfants eux-mêmes.
A ce titre, il faut avoir une idée des liens avec les forces militaires et paramilitaires proprement dites, grâce à quoi les nazis pouvaient recruter dans la Hitlerjugend des membres de la S.A. et de la SS, et même de futurs officiers de l’armée. Par exemple une partie de la Hitlerjugend, la plus courue, fournissait à la Kriegsmarine des auxiliaires pour les secours en mer. Pendant la guerre, les garçons de la Jeunesse hitlérienne devinrent de même une force auxiliaire appréciable pour les pompiers, les chemins de fer, le service postal . En 1943 fut même créée dans la Hitlerjugend une réserve militaire, la 12ème Panzerdivision SS Hitlerjugend . Commandée par Fritz Witt, on la vit active lors du débarquement en Normandie ; elle était composée de jeunes garçons de 16 à 18 ans (les américains parlèrent d’une « baby division ») qui se signala par sa grande férocité et son engagement fanatique dans les combats (idem lors de la prise de Berlin par les Russes, en avril 1945). De Normandie, ne revint que la moitié des 20 000 soldats de cette division. 10 000 morts… Tel est le bilan.
Sans aucun doute, c’est le sentiment d’appartenance au groupe, et qui plus est à un groupe valorisé comme tel, un groupe qui se voulait l’élite de l’Allemagne et de l’humanité, qui explique l’enthousiasme des garçons (des filles aussi, dans leur section spéciale). D’autant que l’appartenance à un milieu humain solidaire procurait une impression de sécurité... en dehors du cerce familial. Rien de tout cela n’était nouveau, mais les nazis surent l’exploiter au profit de leur projet agonistique et de leur doctrine raciale.
Baldur von Schirach fut nommé chef (Führer) de la jeunesse du Reich le 17 juin 33. Il conservera sa fonction à la tête de la Hitlerjugend jusqu’en 1940, date à laquelle, il sera envoyé en Autriche, et sera remplacé par Artur Axmann, ce dernier demeurant à ce poste jusqu’à la fin de la guerre. C’est von Schirach qui organisa la fusion des autres groupes avec les Jeunesse Hitlériennes, absorbant du même coup les auberges de jeunesse, tandis que les scouts étaient dissous. Baldur von Schirach, comme « autorité suprême du Reich », était directement subordonné au Führer, mais il était seulement titulaire d’une « agence gouvernementale suprême »… financée par le trésorier du parti - indication intéressante qui donne l’idée de la manière dont les nazis détruisent l’État en créant des organes de décision entièrement dépendants du Parti.
Baldur von Schirach, qui est l’auteur de la célèbre formule « Quand j’entends le mot culture, je sors mon revolver », sera condamné après la guerre à 20 ans de prison (après avoir assuré qu’il avait protesté contre le sort infligé aux Juifs). Il sera libéré en 1966 et mourra un an après. Artur Axmann a été jugé plus tard, condamné à une peine bien plus légère (3 ans de prison, plus, ultérieurement, à une forte amende), et il mourra en 1996.
Pour connaître la formation de la Jeunesse hitlérienne, qui finit, pendant la guerre, par intégrer une dizaine de millions de garçons, on peut consulter un article de Lisa Pline, « Une jeunesse pour la guerre : la Hitlerjugend (1922-1945) », in Le mouvement social, 2017/4, n° 261 (traduit de l’anglais). Il y a aussi un petit article dans le livre de Mathilde Aycard et Pierre Vallaud Allemagne IIIe Reich (Paris, Perrin/Tempus, 2008 (c’est un très bon et très utile dictionnaire). Je renvoie aussi à A. François-Poncet, que j’ai déjà cité, Les rapports de Berlin, op. cit., et d’abord le rapport du 18 novembre 1931, sur l’organisation du NSDAP (p. 47-48) : le point III, consacré à la jeunesse hitlérienne.
En 1930 : la Hitlerjugend ne comprenait pas plus de 25 000 membres, mais en 1933, après fusion avec les autres mouvement de jeunesse, les effectifs dépassaient les deux millions. Ensuite le nombre ne cessa de croître. En décembre 1936, quand la Hitlerjugend est devenue la seule organisation de jeunesse autorisée, les autres devant s’y joindre, elle compte plus de 5 millions de membres. Le décret qui unifie la Hitlerjugend (« Gesetz über die Hitlerjugend ») est du 1er décembre 1936 exactement. L’article 2 stipule : « Tous les jeunes allemands, en plus d’être éduqués chez eux et à l’école, seront éduqués au sein des Jeunesses hitlériennes...»). C’est ce qui fait du mouvement un passage nécessaire pour tous les jeunes allemands, garçons et filles, de 10 à 18 ans, tandis que l’obligation d’adhérer sera décidée par une ordonnance le 25 mars 1939 donc dans le contexte annonciateur de la guerre. Le décret de 1936 peut être considéré comme un moment ou un effet de la politique dite de Gleichschaltung (plus précoce), terme qui signifie « synchronisation » ou « coordination » et qu’on traduit généralement par « mise au pas », ce qui a l’avantage de suggérer, à nouveau, un idéal militaire !
En 1939, un accord avec la Wehrmacht officialise le rôle préparatoire de la Hitlerjugend pour la guerre , et ce même contre l’avis des parents. En 1944 les jeunesses hitlériennes deviennent, sous l’action de leur chef, Axmann, le « Mouvement des volontaires ».
Lorsque le service militaire fut rétabli, en 1935, puis, la même année, instauré le Service du Travail (six mois obligatoires de travail notamment à la campagne, pour les jeunes gens entre 18 et 25 ans), Baldur von Schirach intégre officiellement une formation paramilitaire aux activités de la Hitlerjugend.
Remarque
Pour suivre plus concrètement la manière dont les nazis utilisèrent les jeunesses hitlérienne pendant la guerre, je voudrais maintenant présenter le regard de ceux qui eurent toutes les raisons de craindre cette soldatesque fanatisée. Je lis donc le récit (que je recommande chaudement) de Sam Pivnik (Rescapé. Auschwitz, la marche de la mort et mon combat pour la liberté, Paris Fleuve noir, 2013 [2012, en anglais).
Sam Pivnik, était un jeune Juif polonais âgé de seulement 14 ans quand les Allemands envahirent la Pologne. Je ne prends que le récit du moment où, deux ans plus tard, dans leur ville de Bedzin, Sam Pivnik et sa famille sont déplacés de leur maison dans un ghetto, constitué par les nazis sur une colline dite Kamionka, qui est une carrière avec des galeries, des bidonvilles… où ils occupent une masure. L’ordre règne, assuré par les SS et la police juive du Judenrat (vaste problème, car ces Conseils juifs étaient à la fois complices et contraints...!). Avant cela, les déportations ont commencé suite à l’invasion de l’URSS, le 22 juin 1941. Dès l’automne 1939, les Allemands tuaient des gens et en envoyaient d’autres dans des camps de travail. Mais en 1942, des trains de marchandise sont affrétés, qui ne servent plus aux transports d’animaux, car ils emportent les personnes vers des sites d’extermination, Belzen, Treblinka, Sobibor. Les wagons sont munis de cadenas pour fermer les portes et de fil de fer barbelé devant les trous d’aération. Ensuite, le moment crucial est le 12 août 1942, quand l’Aktion annoncée par le Judenrat est déclenchée : tous les Juifs de Bedzin et des villages alentours, 20 000 personnes, sont réunis sur l’un des deux stades de football de la ville…. Et c’est la sélection (Sam Pivnik, Rescapé, op. cit., p. 80 ; l’épisode est aussi raconté par une jeune fille du même âge à ce moment, Rutka Laskier, dans son journal, publié en français sous le titre Le journal de Rutka, Janvier-avril 1943, Paris, Editions Pocket, p. 18-19 : un petit livre bouleversant qu’il faut lire et relire). Pivnik voit son jeune frère Nathan embarqué. Quand les Allemands créent le ghetto, à Kamionka, 7 mois se sont encore écoulés. Or un jour, quelques semaines après, en été, a lieu la liquidation du ghetto. Les Juifs sont contraints de quitter leurs habitations de fortune et ils doivent monter dans les trains pour Auschwitz, qui n’est pas très loin. A ce moment, Pivnik et sa famille, pour ne pas être pris, se cachent dans le grenier, sous le toit en pente de la maison qu’ils occupent, mais sans avoir bien sûr le temps d’emporter des provisions suffisantes, pur plusieurs jours. La chaleur est exténuante, et ils boivent leur urine avec un peu de sucre (génialement prévu par la mère). Au bout de 4 jours, le mercredi 6 août 1943 [dit Sam Pivnik, mais ce doit être le 3 août], épuisés, affamés, ils sortent enfin… Hélas, les nazis sont toujours à la recherche des derniers Juifs encore présents, et toute la famille est capturée. Ils ne sont pas tas tués, mais déportés. Avant cela le jeune garçon, qui a alors 16 ans, a vu ce qui se passait dans le quartier.. Il a assisté à une fusillade de policiers allemands qui tiraient sur des gens en fuite… Et puis ceci :
« Les SS, dont les insignes brillaient dans la lumière, étaient plus organisés, moins désordonnés. Je vis même des membres des jeunesses hitlériennes, vêtus de leurs shorts et foulards ridicules, brandir leurs petits couteaux fournis par la Hitlerjugend et scander des slogans nazis enragés. Il s’agissait de garçons de mon âge, voire plus jeunes, qui voulaient notre peau » (Sam Pivnik, idem, p. 93).
Pas besoin d’autres commentaires pour apercevoir la raison nazie d’investir la formation de la jeunesse allemande.
Et puis, ceci, toujours sous la plume de Sam Pivnik, pour saisir complètement le moment crucial de la capture à Bedzin :
« Pendant que nous descendions la colline, les gentils [les polonais catholiques] locaux nous huaient, se moquaient, riaient de nous. Un ou deux sanglotèrent, la tête dans leurs mains, signe symbolique de l’attitude schizophrénique de la Pologne vis à vis du ‘problème juif’. Ces gens étaient nos voisins ; ces hommes commandaient des vêtements à mon père dans son atelier de tailleur ; ces femmes avaient parlé layette et accouchement avec ma mère ; nous faisions nos courses chez ces boutiquiers ; j’avais joué au football avec ces adolescents. Ils étaient maintenant en train de piller nos meubles et nos maigres possessions, comme des hyènes déchiquetant une charogne pour s’emparer des meilleurs morceaux. » (Sam Pivnik, idem, p. 98).
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par fjf le 9 Juin 2021 à 09:18
Séance 7
INSTITUTIONS ET MILICES DE LA GUERRE NAZIE
Dans les séances précédentes, j’ai évoqué le processus de militarisation de la société allemande que les nazis ont déclenché à la fois pour s’identifier comme porteurs d’un idéal soldatesque et, ce faisant, pour réaliser (et annoncer qu’ils réaliseront) leur programme de guerre contre de larges fractions de la population autochtone (Juifs, communistes, sociaux-démocrates, handicapés, etc.), autrement dit leur programme de guerre interne et non pas seulement de guerre à l’extérieur, pour la conquête des terres de l’Est, et pour prendre à l’Ouest leur revanche sur la France après la défaite de 1918. Maintenant, sans oublier mes hypothèses de départ, je voudrais décrire les organes et les institutions créés par les nazis entre 1920 et 1940 .
Avant cela, je crois utile d’apporter la précision suivante. Je fais l’hypothèse du caractère essentiellement destructeur, voire dévastateur de la « politique » nazie (je mets des guillemets devant « politique », car il ne s’agit pas à proprement parler de politique mais de substitution de la guerre à la politique). Mais je n’ignore pas pour autant que les nazis eux-mêmes se sont perçus et présentés à l’inverse par leur inflexible volonté de modifier l’état des choses issu selon eux du judaïsme et du christianisme, donc, finalement, qu’ils s’estimaient en capacité d’avancer sur le chemin d’une reconstruction globale de la société et de l’État. C’est aussi pour cette raison qu’ils se sont définis comme de grands bâtisseurs ! A preuve d’ailleurs le fait qu’Hitler, qui eut un lien très étroit avec l’architecte Albert Speer, se voulut créateur de monuments, gigantesques la plupart du temps, par exemple ceux destinés à accueillir les congrès du Parti à Nuremberg, ou bien ceux destinés à abriter certains organismes officiels à Berlin (voir la Chancellerie du Reich) ; Berlin, au titre de capitale du Reich, devant être totalement modifiée pour devenir Germania. Il y a un grand décalage entre l’image d’eux-mêmes et de leurs projets telle que cultivée par les nazis et l’approche interprétative du nazisme comme force destructrice. Ceci, bien évidemment, ne me dispense pas de faire le constat d’une destruction humaine sans limites (et ce bien avant que les bombardements alliés et l’artillerie russe ne réduisent un certains nombre de villes en cendres!) Disons que pour les nazis la destruction de la société existante était très secondaire, presque un dommage collatéral dirait-on dans le langage d’aujourd’hui, par rapport aux bénéfices attendus de l’édification du « Reich de mille ans » (sur des bases raciales).
1) Les Corps francs de 1918
L’idéal militaire-violent des nazis, nous l’avons vu se manifester à l’occasion de l’irruption au Reichstag des 107 députés en uniforme des S.A. après les élection de l’automne 1930. Mais à vrai dire, pour envisager les choses dans l’ordre chronologique et en parcourant le devenir des principales formations s’étant constituées et ayant agi sur un modèle militaire, il faut commencer par les corps francs (Freikorps), qui sont une troupe parallèle (par rapport à l’armée vaincue et dispersée), et active entre la fin 1918 et le début 1919 (voir une petit article du dictionnaire très utile de Mathilde Aycard et Pierre Vallaud, Allemagne, IIIè Reich, Paris, Perrin/Tempus, 2013 [2008] ; de même qu’un bon article dans Wikipédia). Les Corps francs réunissaient des jeunes déclassés et souvent délinquants, avec d’anciens soldats et sous-officiers et officiers désoeuvrés et souvent désemparés après la Grande Guerre (il ne faut jamais oublier que nombre d’ Allemands et toutes les franges nationalistes n’admettent pas la défaite, qu’ils dénient en la mettant sur le compte d’une traîtrise , un « coup de poignard dans le dos » (la formule est passée à la postérité), asséné par leurs gouvernants.
A l’origine, les Corps francs sont créés par le gouvernement, de la république de Weimar, des politiques républicains et certains sociaux-démocrates qui, en l’absence d’armée régulière, cherchaient le moyen de repousser d’éventuelles incursions étrangères – notamment sur les frontières de la Pologne. Ensuite les Corps Francs seront globalement inspirés par l’extrême droite nationaliste et en 1919 ils seront le fer de lance du combat contre la tentative de révolution communistes, spartakiste, la « République des conseils » (Räterepublik ; qui dura du 7 avril au 3 mai 1919 en Bavière, notamment à Munich). Je l’ai dit dans la séance précédente, c’est un membre d’un Corps franc de Berlin qui a procédé à l’exécution des deux dirigeants communistes Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg en janvier 1919.
Ces éléments paramilitaires étaient armés car un armement était encore en circulation dans la mesure où ce qu’il restait d’armée allemande n’avait pas été anéanti par les Français et leurs alliés (Pourquoi les Français et les américains présents en France n’étaient-ils pas entrés en Allemagne à la poursuite de l’armée allemande vaincue…., c’est un sujet d’interrogation qu’abordent certains historiens de la Guerre de 14) .
Les Corps francs seront dissous au début des années 20, mais une bonne partie se retrouvera plus tard dans la S.A. des nazis et avant cela dans le « Casque d’acier », cette association d’anciens combattants inspirés par un désir de revanche et surtout une idéologie ultranationaliste et anti-communiste. En 1919, les Corps francs comportent 165 unités de diverses tailles, ce qui est énorme. En Bavière par exemple, le général von Epp, un des principaux officiers supérieurs des Corps francs, put mobiliser 30 000 soldats contre la République des Conseils, tandis que d’autres troupes étaient mobilisées aux frontières de l’Est, notamment en Pologne, je l’ai dit, où l’on redoutait des incursions bolcheviques. Dans les « Sudètes », région de Tchécoslovaquie où vivait une population germanophone, d’autres Corps francs, moins officiels si l’on peut dire, agissaient également.
A la fin de l’article de Wikipédia, on trouve une liste d’une cinquantaine de noms ayant été membres de Corps francs, dont plusieurs, bien sûr, on fait ensuite carrière avec les nazis à différents postes élevés.
Corps francs en 1919 (image empruntée à Wikipédia)
2) Le casque d’acier, Stahlhelm (Stahlhelm, Bund der Freisoldaten, « Casque d’acier, Ligue des soldats du front »), nom choisi en référence au casque militaire de forme typique, que nous connaissons trop bien, qui a commencé à remplacer en 1916 le casque à pointe. Le Stahlhelm, issu de la mouvance nationaliste des Corps francs, fut fondé le 25 décembre 1918 à l’initiative d’Alfred Hugenberg. Il aura ensuite pour chef Franz Seldte, futur ministre du travail d’Hitler. Ce fut la plus importante association d’anciens combattants de l’entre-deux-guerres, étant entendu que ce groupement fonctionnait comme une milice, qui se proposait de lutter contre les socialistes et les communistes. Le Stahlhelm revendiqua jusqu’à un million de membres (ce qui était sans doute exagéré : ce pouvait être la moitié, chiffre déjà très significatif). En 1933, il sera en grande partie intégré à la SA ; et c’est justement Seldte qui permettra à Hitler d’accomplir cette opération (voir sur ce point Martin Broszat, L’Etat hitlérien, op. cit., p. 153). C’est donc là encore une organisation de combat, autres professionnels de l’action violente, liée en l’occurrence aux mouvements nationalistes et à l’idéologie dite völkisch (hypervalorisation du peuple allemand, le Volk, en tant que communauté raciale - « communauté raciale populaire », Volksgemeinschaft).
Remarque
Il y a une histoire du casque militaire, qui sert à la fois à protéger la tête et à impressionner l’ennemi. Voir Robert Muchenbled, Une histoire de la violence, De la fin du Moyen Age à nous jours, Paris, Seuil, 2008, p. 124-125.
3) La S. A., milice du parti nazi. Deux compléments qu’il faut avoir en tête avant de traiter ce point...
Remarque 1. Sur l’idéologie nazie et ses racines.
J’ai déjà donné quelques éléments à ce sujet (voir séance 5). Aujourd’hui, je voudrais revenir d’un mot sur la composante « völkisch » de cette idéologie. Ce terme pourrait se traduire par « populaire », mais 1. avec la forte nuance qu’on dirait aujourd’hui, en français, « populiste» ; et 2. au sens de « racial ». C’est ce qu’on retrouve dans une expression qui figure au centre de l’idéologie nazie : Volksgemeinschaft (présentée dans la séance 5) qui ne peut se traduire, si on veut être tout à fait exact, que comme « communauté raciale populaire », qui désigne le peuple allemand idéal, et le désigne en marquant le caractère indissolublement lié des deux connotations que contient le mot Volk, l’une au peuple et l’autre à la race. « Peuple racial », comme le propose Franz Neumann (dans Behemoth, op. cit.), pourrait être la meilleure formule.
En fait, le volkisch est de provenance nationaliste plus ancienne que la nazisme, puisqu’il est déjà un terme courant du vocabulaire conservateur (en particulier « pangermaniste ») avant la guerre de 14. Pour ne pas me lancer dans une analyse qui est faite et bien faite dans de nombreux ouvrages, je me contente de reproduire une définition liminaire de I. Kershaw (Hitler, 1889-1936 : Hubris, Paris, Flammarion, 1999 [1998], p. 214), qui explique que l’idéologie völkisch comporte trois « éléments centraux » qui sont « l’ultranationalisme, l’antisémitisme racial et la notion mystique d’un ordre social proprement allemand, qui s’enracinait dans le passé teutonique et reposait sur l’ordre, l’harmonie et la hiérarchie. ». C’est donc ce qu ’on va retrouver dans le discours nazi le plus insistant, le discours de la Volksgemeinschaft.
Remarque 2
Je rappelle à cette occasion que Hitler lui-même, juste après la guerre, modeste caporal (qui aurait eu de sérieux troubles psychiatriques au moment de la défaite), reste au service de l’armée en Bavière ; et qu’il dépend par conséquent du ministère de la guerre de Munich (la nouvelle armée, la Reichswehr, réduite à 100 000 hommes par le traité de Versailles, est créée en janvier 1921). Hitler a été repéré par un capitaine nommé Mayr (on lui a présenté Hitler après une prise de parole enflammée dans une réunion d’anciens militaires, des officiers - je m’appuie sur Heinz Höhne, L’ordre noir. Histoire la SS, Paris, Casterman, 1968 [1967], p. 19), et Hitler devient donc le collaborateur de ce capitaine, qui le charge d’actions de propagande et bientôt lui demande de surveiller les partis et groupes (groupuscules) qui développent leur action dans ce contexte. C’est à ce titre que Hitler, en 1919, entre en contact avec un petit parti nommé Deutsche Arbeit Partei, DAP, Parti des travailleurs Allemands, auquel il va finalement adhérer et dont il va ensuite prendre la tête en le ré-intitulant Parti national-socialiste des travailleurs allemands, NSDAP, National Socialiste Deutsche Arbeit Partei . Ce groupe comporte à l’origine quelques centaines de membres, mais ce sera ensuite l’immense parti nazi, capable d’agiter des forces matérielles et humaines colossales, et de déclencher une guerre planétaire !
Venons-en à la milice de sinistre mémoire, la S.A.
La S.A., Sturmabteilung, fut créée par Hitler à Munich en 1921, le 8 août. Et c’est en octobre que fut trouvée la nouvelle dénomination, Sturmabteilung, soit division (ou section) d’assaut. C’est également à l’intérieur de la S.A que sera créée la S.S (Schutzstaffel, escadron de protection), et plus tard un service de renseignement dirigé d’abord vers l’intérieur du Parti, le SD (Sicherheitsdienst des Reichsführers SS).
LA S.A. pourrait avoir pris comme modèle les Sturmtruppen, troupes d’attaque (ou d’assaut), qui avaient existé dans l’armée allemande en 1914-18.
Il a aussi existé dans la mouvance nazie une « Section de gymnastique et de sport » qui assurait la protection des salles où le Parti tenait des meetings (cf. R. Evans , Le troisième Reich, t. 1, op. cit., p. 237). En fait, un ex membre des Corps francs (qui avait mis sur pied une sorte de brigade ultra violente), le capitaine Hermann Ehrhard, fit adhérer les anciens des corps Francs à la section de gymnastique. Ce fut une sorte de passerelle vers la S.A., puisque ensuite Ehrhardt se mit d’accord avec Röhm… pour rejoindre la milice donc les nazis.
Pour connaître un peu la sociologie du recrutement de la S.A., on peut se reporter à Peter H . Merkl, The making of a Stormtrooper, Princeton University Press, 1980. De manière générale, on peut dire que dès ses débuts, la S.A. attire à elle des hommes jeunes qui cherchent à surmonter le chômage et la misère. W. S. Allen dans Une petite ville nazie.., op. cit., parle lui aussi des dégâts occasionnés par la grave crise économique en province, dans ce qui est encore une société pré-industrielle… Cela étant, il faut surtout savoir qu’à peu près la moitié des membres de la S.A. ont appartenu à des Corps francs ou à des organisations nationalistes comme le Stahlhelm (et 1/10° vient de la gauche, voire du PC). C’est dire à quel point règne sur cette milice, comme on s’y attend, l’état d’esprit soldatesque dont je parle : c’est un esprit de combattant, affirmé surtout suite à la défaite désastreuse de 1918. Je n’ai pas assez souligné ce point, qui est un élément clef pour comprendre le nazisme et la radicalisation de la violence. La « matrice » du nazisme et de la violence nazie ("matrice" est un terme de Marcel Gauchet), en effet, ce n’est pas contrairement à ce que soutient M. Gauchet, la guerre en tant que telle, avec sa brutalité sans nom et la mort de masse dont elle est la cause, c’est bien plutôt la défaite, à laquelle on peut attribuer le statut d’un trauma collectif si l’on songe au deuil qu’endurent presque toutes les familles… mais… tout cela, pour rien !
Ernst Röhm, qui, sur ordre d’Hitler, dirigeait la S.A. (et qui avait aussi pour ami Franz von Epp, fondateur d’un Corps franc auquel Röhm avait appartenu), disposait de 30 000 hommes en 1929, mais 300 000 au début de 1933 et… plus de deux millions à la fin de cette même année, la moitié étant issus du Casque d’acier. On voit la progression fulgurante. En août 1922 il n’y a encore que 800 membres… Mais en décembre 1931, la S.A. compte 170 000 hommes ; qui seront plus de 400 000 à l’été 1932, et 700 000 en 1933 quand Hitler devient chancelier. Puis ils montent jusqu’à 3 millions. Göring, revenu d’Italie après 1923, constate pour son plus grand plaisir que pendant son absence, la SA s’est étendue à toute l’Allemagne (cf. Christian Bernadac, La montée du nazisme. Le glaive et les bourreaux, Chaintreaux, éditions France-Empire Monde, 2013 p. 164). Röhm était lui-même surnommé « le roi de la mitraillette » (d’après R. Evans, La Troisième Reich, op. cit, t. 1, p. 238).
R. Evans parle judicieusement d’une « aile paramilitaire » (Le Troisième Reich, idem, p. 237). Dans le contexte du glissement vers la violence physique à la place des oppositions parlementaires, le fait de s’adjoindre une milice para militaire n’était pas une originalité.
J’indique que, lors lors du premier procès de Nuremberg (je m’appuie sur Christian Bernadac, idem, p. 164 ), Göring a expliqué aux juges qu’Hitler lui avait bien confié la direction de la S.A . en début 23, mais que ceci ne dura que peu, jusqu’au 9 novembre, moment du putsch raté de Munich, après lequel la S.A fut interdite (et Hitler emprisonné). Göring précise qu’à ce moment, les années 1920 et suivantes, toute organisation politique, les grands partis du moins, avaient à leurs côtés des « troupes de combat ». Il cite le « Front rouge », les groupes de combat communistes, qui étaient, ajoute Göring, « notre ennemi le plus acharné », parce qu’elles voulaient toujours empêcher les réunions nazies. Il y avait aussi le Reichsbanner, organisation du parti social-démocrate. Et puis aussi le Stahlhelm, de tendance nationaliste. D’après Göring toujours, les membres de la S.A., venaient « de la masse ». C’étaient de petits employés ou ouvriers arrivés là par idéalisme, qui assuraient leur service le soir et même la nuit, bénévolement, et, qui étaient souvent des blessés de la guerre, souvent abattus parce qu’ils ne pouvaient pas devenir fonctionnaires (de même que les fonctionnaires ne pouvaient pas entrer dans la SA. Bref, si l’on suit Göring, des gens biens… qui n’avaient nullement l’intention de « faire quelque chose de cruel ».
Cette sorte d’armée militaire-militante a été un élément de poids au service du Parti nazi et donc de l’arrivée de Hitler à la Chancellerie. Hitler utilisa la S.A. comme troupe de choc ; mais il voulait surtout qu’elle poursuive ses buts de propagande, donc qu’elle n’apparaissent pas (ou pas trop) comme spécialiste du coup de poing! En tout cas, il n’était pas du tout favorable à ce qu’elle remplace l’armée régulière. C’est pourquoi il sera en désaccord avec Röhm à ce sujet (voir ci-dessous le profondeur de se désaccord).
La S.A., dont les membres arboraient la chemise brune restée dans les mémoires, était donc à l’origine une sorte de service d’ordre, voué à prévenir des attaques ou à écarter des trublions dans les réunions publiques du Parti nazi. Mais elle pouvait aussi fomenter des désordres de ce genre dans les meetings adverses. Disons-le (avec tous les historiens) les membres de la S.A. étaient des brutes qui appréciaient le fait de cogner et de laisser leurs ennemis sur le carreau… C’était, sous la houlette de leur chef Ernst Rôhm, une redoutable et très efficace organisation para-militaire. Les membres de la S.A. , dit R. Evans (Le troisième Reich, t. 1, op. cit., p. 237), semaient la terreur dans les rues de Munich, « où ils passaient leurs opposant à tabac et attaquaient quiconque ressemblait à un Juif » . C’était donc bien « un petit groupe de voyous ». En gros, (cf. Jacques Droz dans la revue L’Histoire, : « Les SA : ses hommes de main », republié in Le nazisme en question, 1933-1939, éditions Pluriel/L’Histoire, 2011, p. 37), la S.A. s’attachait à faire régner dans le pays « une atmosphère de paralysie et de terreur ». Pour ce faire, elle organisait des défilés, des réunions, etc., Mais la violence très habituelle, d’ailleurs, de ces groupes de S.A., inquiétait jusqu’à Röhm lui-même.
Cependant, les S.A. furent rapidement armés et revêtus d’un uniforme avec la casquette très reconnaissable (ne pas oublier l’importance des signes distinctifs dans les groupements agonistiques, depuis toujours et jusqu’aux « gilets jaunes »). Les fameuses chemises brunes furent achetées fin 1924 très peu cher par Gerhard Rossbach : c’était un surplus de chemises militaires tropicales donc devant servir aux troupes de l’Empire colonial allemand. Pour marquer encore plus leur inspiration militaire, les SA, reformés en 1926 après l’interdiction qui fit suite au putsch manqué de 1923, calquèrent sur l’armée une hiérarchie de grades (ce seront aussi ceux des SS). Et à ce moment, Hitler eut lui-même le grade le plus élevé : Oberster SA-Führer.
Le lien entre Hitler et la S.A (que pourtant, nous disent les historiens, Hitler ne chérissait pas) durera jusqu’à 1934. A ce moment en effet, Hitler se sépare radicalement de la S.A. en faisant assassiner ses principaux chefs, à commencer par son ami Ernst Röhm : ce fut la « nuit des longs couteaux ». (Voir J . Droz, « La S.A…. », loc. cit., p. 33-39). Le choix d’éliminer la S.A . s’explique par divergence fondamentale à laquelle j’ai fait allusion entre Hitler et Röhm. Ce dernier, resté toujours indépendant du Parti nazi, et ayant avec Hitler des relations ambiguës, en tout cas des relations exemptes de toute posture de soumission, persistait à défendre une optique plus révolutionnaire qu’Hitler, anti capitaliste même. C’était le point de vue d’une grand partie des membres de la S.A. ce qui se comprend si l’on sait que ces gens cherchaient à endiguer les atteintes sur eux de la défaite et de la crise économique. Et en outre, comme le rappelle aussi J. Droz, Röhm voulant faire des SA une armée parallèle capable de rivaliser avec la Reichswehr tandis que Hitler refusait que les hommes de la S.A. soient armés au sens militaire du terme. Je redis qu’Hitler cherchait surtout le meilleur moyen de développer sa propagande. En tout état de cause ceci le conduisit en 1923 à mettre Röhm sur la touche et à le remplacer par son fidèle Göring. Toutefois, après que la S.A put être reconstituée, Hitler, en 1930, rappela Röhm qui s’était exilé en Bolivie. Et ceci dura jusqu’à la « nuit des longs couteaux », en 1934. A ce moment venaient de la S.A de virulentes critiques contre les chefs nazis, du parti, notamment les SA de Berlin, qui accusaient Hitler, comme je viens aussi de le mentionner, d’abandonner le côté révolutionnaire de l’action anti-républicaine.
Remarque
A l’origine des relations entre Röhm et Hitler, il y eut le fait que Röhm avait remplacé Mayr (le recruteur initial de l’homme Adolf Hitler) après le départ à la retraite de celui-ci. Röhm était commandant dans un régiment d’infanterie et en 1919 il avait accédé à l’état major, en Bavière. C’était un monarchiste, antidémocrate, la république de Weimar lui apparaissant comme le produit d’une décadence approfondie par la défaite et la chute de l’Empereur. Comme beaucoup d’autres officiers, Röhm bénéficia de la tentative de révolution communiste puisque cela lui donna l’occasion de jouer dans les Corps francs un rôle de combattant déterminé pour venir à bout des communistes et des spartakistes. Après cela, Röhm, à 32 ans, devint chef d’état major du commandement de la place de Munich, et il fut chargé de reconstituer une armée en Bavière, alors que le traité de Versailles avait enfermé dans d’étroites limites ce qui restait d’armée allemande. La solution consista à former une sorte armée quasi secrète, mais définie comme armée du peuple. C’est ainsi que Röhm s’activa pour constituer une milice nationale, pour laquelle du reste il trouva ce qu’il fallait d’armes et de munitions (Cf. H. Höhne, L’ordre noir..., op. cit., p. 21) : des mitrailleuses légères et lourdes, des fusils mitrailleurs, des fusils, carabines et pistolets, plus de 21000, des grenades à main (300 000), des millions de cartouches, bref tout un arsenal - qui finira pus tard dans la Wehrmacht.
Hélas pour Röhm, en 1925 la gouvernement bavarois approuva le Traité de Versailles, si bien que cette armée « noire » fut abolie. Mais c’est alors que Röhm, persuadé, comme les ultra nationalistes, qu’il fallait convaincre les masses, se rapprocha d’Hitler, déjà aguerri comme chef du NSDAP. Röhm créa donc pour Hitler des commandos chargés de le protéger, et pour cette tâche, il recruta d’anciens militaires : c’est ce qui sera nommé « section d’assaut », Sturmabteilung, SA…. Qui étaient ces hommes de main ? Certains provenaient d’une compagnie de sapeurs, d’autres du corps des officiers de la deuxième brigade de marine. Parmi ces hommes figurait le capitaine Hermann Ehrhard dont j’ai déjà parlé (pas connu mais qui a joué un rôle important). Ces gens étaient d’abord dubitatifs vis-à-vis d’Hitler, mais ils se laissèrent ensuite convaincre (tandis que Göbbels et Göring furent quant à eux, comme Himmler, tout de suite impressionnés et pris d’une véritable passion pour le Führer)…
(à suivre)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par fjf le 28 Août 2021 à 09:26
Séance 8
INSTITUTIONS ET MILICES DE LA GUERRE NAZIE
(suite)
Je poursuis aujourd’hui la description et l’analyse des groupements nazis miliciens-militaires voués à mener la guerre interne dont j’ai parlé.
4) La jeunesse hitlérienne (Hitlerjugend)
J’en ai traité dans la séance 6, donc je n’y reviens pas. Je rappelle juste que la Jeunesse hitlérienne finit, en 1939, par être obligatoire pour tous les garçons et les filles de 10 à 18 ans.
5) La S.S
Cette question mérite d’être traitée avec suffisamment de précision, tant le rôle que la SS a joué dans l’histoire du nazisme est important ; et tant la SS a contribué à fixer l’image de la violence meurtrière attachée au nazisme, et en conséquence l’image du mal absolu. Richard J. Evans, dans le premier tome de son ouvrage fondamental sur le IIIè Reich (comme celui de I. Kershaw sur Hitler), dit bien que « la création de la SS marque l’achèvement de l’architecture de base du mouvement nazi » (Le troisième Reich, t. 1. L’avènement, op. cit., p. 289).
Pour ce qui est de mon exposé ici même, je commence par dire ou redire que là non plus je ne me suis mis dans le cas de procéder à une exploration archivistique (les SS ont d’ailleurs détruit un grand nombre de leurs archives ; mais certaines sources existent, notamment de nombreux témoignages, par exemple rassemblés lors des procès d’après guerre etc.). Pour ces raisons, je préfère commencer par quelques indications bibliographiques qui communiqueront d’emblée les références, du moins les principales, que j’ai utilisées. Voici donc l’essentiel des ouvrages dans lesquels j’ai puisé mes informations :
- Heinz Höhne, L’ordre noir. Histoire de la S.S, Paris, Castermal, 1968 [1966]. Peut-être le principal ouvrage.
- Edouard Calic, Himmler et l’empire SS, Paris éditions du nouveau monde, 2013. C’est un ouvrage de facture davantage journalistique, comportant donc un aspect de témoignage.
- Mario R. Dederichs, Heydrich. Le visage du mal, Paris, Tallandier/Texto, 2016 [2005].
- Eugène Kogon, L’État SS, Le système des camps de concentration allemands, Paris, Seuil, Points, 1970 [En 1946, ne première édition était intitulée L’enfer organisé] ; livre critiqué par H. Höhne, p. 121. C’est une description des tâches des SS dans les camps de concentration.
- Martin Broszat L’État hitlérien, Paris, Fayard/Pluriel, 2012 [1970]. J’ai déjà recommandé cette étude d’ensemble, très précieuse, qui permet de se faire une idée globale de l’entreprise nazie et de sa manière particulière d’exercer une emprise « totalitaire » sur la société allemande. Sur la SS plus particulièrement, voir certains passages comme les p. 77 et suiv., qui traitent de la lutte de la SS contre les rebelles de la S.A. en avril 1931 ; et comme les p. 399 et suiv… sur l’utilisation des SS par les nazis, après la prise du pouvoir en 1933, notamment pour contrôler la police peu à peu détachée de l’État.
- F. Neumann, Behemoth, Structure et pratique du national-socialisme, 1933-1944, Paris, Payot, 1987 [1944]. Autre ouvrage important (plus ancien). Voir les p. 503 et suiv. sur Himmler et la SS. Et il contient p. 509-512 un paragraphe sur la structure et l’histoire de la SS.
-Saul Friedländer, L’Allemagne nazie et les Juifs. t. 1., Les années de persécution, 1933-1939, Paris, Seuil, 1997,
- Jacques Delarue, Histoire de la Gestapo, Paris, éditions du Nouveau Monde, 2011.
- Claude Quetel, Tout sur Mein Kampf, Paris Perrin, 2017 (contient quelques indications).
Je ne cite pas aujourd’hui les ouvrages généraux sur l’histoire du IIIème Reich, signalés dans les séances précédentes (comme ceux de R. Evans ou I. Kershaw – parmi d’autres que je n’ai pas forcément cités). En revanche, pour ce qui concerne les SS, j’ai consulté, souvent avec profit, des ouvrages « grand public », par exemple certains numéros spéciaux de magasine, dans lesquels on découvre de bonnes reproductions photographiques. Je retiens notamment un recueil d’articles (modestes mais très bien faits) publiés dans la revue L’Histoire. L’intitulé du recueil est Le nazisme en questions, Paris, Arthème-Fayard / Pluriel, 2010. Voir notamment l’article de Marlis G. Steinert, p. 157-174, « Les SS, pilier du régime ? ».
Archives de la seconde guerre mondiale, n° 3, sur Les « chevaliers noirs » du Reich.
Voir aussi plusieurs très bons documents diffusés à la télévision, qu’on retrouvera facilement aux archives de l’INA. Je pense notamment à un document de la BBC, avec une version française de 2008, sur la garde rapprochée d’Hitler (production Nugus-Martin).
Attention : certains des magasines dont je parle ont fait parfois appel à des auteurs assez favorables (quoique dissimulés) aux nazis...
Une photo empruntée au livre de H. Höhne, pour donner l’idée de l’ampleur et de la complexité de l’organigramme du pouvoir dans la SS pendant la guerre
1) Remarques préliminaires
a) Schutzstaffel, abrévié en SS, signifie : escadron (ou escouade, ou section) de protection. En l’occurrence, lors de la création, il s’agissait de protéger la personne d’Hitler, à une époque où les groupes politiques rivaux s’affrontaient physiquement et où, pour les dirigeants, la menace d’être purement et simplement tué était permanente. La SS est donc à l’origine une sorte de garde prétorienne du chef. Avec cette caractéristique, étonnante pour nous, d’une entière dévotion de ses membres à leur groupe et aux chefs de ce groupe – ce qui est d’ailleurs en quelque sorte garanti par un serment de fidélité. Cette garde rapprochée doit - et se plaît à - obéir sans limites, en toutes circonstances, aux ordres du Führer.
En conséquence, la SS a aussi été un soutien essentiel de l’autorité du chef Hitler, le Führer. Cela lui a permis d’exercer une réelle domination sur les autres groupes nazis, y compris les policiers et les militaires.
La constitution de la SS en milice, sur le mode d’une troupe combattante, est sans doute typique de la dynamique de militarisation que je cherche à saisir. La petite troupe va devenir une gigantesque armée (au sens banal et au sens strict, militaire – la SS a du reste adopté des grades très proches de ceux de l’armée officielle…
Il faut en outre comprendre le lien originaire de la SS avec la SA, puisque la SS est créée à l’intérieur de a SA. Je rappelle à ce sujet que la SA apparaît en août 1921, puis qu’elle est supprimée après le Putsch de 1923 (le 9 novembre). Et quand Hitler, après sa détention, put la rétablir, il voulut en faire une milice (permettant d’assumer avant tout les combats de rue, qui pouvaient être sanglants, ainsi que le « travail » militant de propagande - collage d’affiches, etc.), mais non pas, comme le souhaitait Röhm, le chef de la SA, une véritable armée, destinée à remplacer l’armée officielle, et orientée dans un sens anticapitaliste, révolutionnaire et insurrectionnel. Ce désaccord entre Hitler et Röhm est très important. Il a eu de nombreuses conséquences pratiques et on peut y voir un bon révélateur de la stratégie de conquête du pouvoir mise au point par Hitler. Celui-ci pense en l’occurrence à la SA comme un instrument destiné à assurer la sécurité du parti et à promouvoir sa propagande (tout en ménageant les milieux industriels). En conclusion de ce désaccord, Röhm fut sommé de démissionner ou de se conformer, si bien qu’il démissionna en 1928 et s’exila en Bolivie, comme conseiller militaire (il avait aussi des raisons personnelles de le faire, puisqu’en proie, nous dit-on, à une réelle dépression , notamment suite à la révélation publique de son homosexualité…).
b) Pour éclairer le contexte nazi, il faut savoir que le groupe agonistique hitlérien, dès qu’il s’empare des institutions du pouvoir, se donne comme objectif premier d’investir ces institutions, de les transformer pour les asservir à ses fins (par essence anti-démocratiques), et on peut considérer comme un aboutissement de ce plan le fameux décret du 17 juin 1936, au terme duquel Himmler assume la responsabilité de toutes les forces de police allemandes (cf cours 2020, séance 4) , moyennant quoi tous les policiers peuvent intégrer le corps des SS. Avant cela, l’arrivée d’Hitler au pouvoir s’est très vite traduite par un sorte de parasitage (le mot est adéquat) des rouages de l’État par les organes et les hommes du Parti nazi. Cette destruction au moins partielle de l’État a pris plusieurs formes, la plus évidente étant la dictature (Hitler a obtenu les pleins pouvoirs par un vote du parlement, en mars 1933, ce qui signifie qu’il a désormais la capacité de prendre des décrets que le Parlement n’a pas le droit de discuter). Une autre forme, très importante dans sa configuration technique, a consisté, contre les ministères et les administrations, a créer des « agences » dotées de capacités d’organisation et de gestion, et comportant à leur tête des fidèles de Hitler. Exemple : la fonction attribuée à Baldur von Schirach, dirigeant de la Jeunesse hitlérienne, qui est, pour ce faire, mis à la tête d’un organisme doté de grands pouvoirs tandis que lui ne rendra de compte qu’au Führer.
Himmler fut placé par Hitler à la tête des SS en 1929 et il s’efforça d’établir ce groupement sur des bases raciales très affirmatives de la supériorité des aryens sur tous les autres peuples de la terre . Des critères raciaux très stricts sont alors mobilisés pour le recrutement des membres de la SS . Ce sont des critères physiques : le candidat ne doit pas mesurer moins de 1,70m ; et des critères généalogiques : il faut prouver qu’on a des ancêtres aryens donc une ascendance sans Juifs - depuis 1750 pour les officiers, et depuis 1900 pour les grades inférieurs (Heydrich, personnage des plus venimeux, terrible, l’adjoint de Himmler, a été soupçonné un temps de ne pas satisfaire à cette condition ; mais ceci n’a pas dissuadé Himmler de le prendre à ses côtés étant donné ses grands talents d’organisateur).
C’est le RuSHA, Le Rasse und Siedlungshauptamt, autre organe interne à la SS, qui examine et validait - ou pas - les données fournies par le candidat. Le RuSHA, dont Himmler, était l’inspirateur et dirigeait le Conseil d’administration, fut créé en décembre 1931 par Walther Darré (futur ministre de l’agriculture). Les SS étaient tenus de cotiser à l’association ; et s’ils avaient décidé de se marier, c’est logiquement auprès du RuSHA qu’ils devaient fournir les preuves de la pureté de leur liens héréditaires, c’est-à-dire de l’aryanité de leurs ascendants, en remontant jusqu’au début du XVIIIe siècle comme je viens de l’indiquer (ce qui supposait de prendre en charge des recherches spécifiques).
Pour comprendre à quoi les SS étaient exposés dans ce contexte, on peut penser au cas d’une femme nommée Anneliese Hütteman, qui, en 1944, fut presque contrainte de renoncer à son projet d’épouser un Obersturmbannführer SS, Arthur Liebehenschel, qui n’était autre que le commandant d’Auschwitz à ce moment. Pourquoi des difficultés alors que le futur époux avait tous les titres requis si j’ose dire? Tout simplement parce que cette dame, dix ans auparavant, en 1935, avait entretenu une relation avec un juif, relation qui avait été consignée dans un dossier que les dirigeants SS avaient pu consulter (ce qui laisse songeur sur l’efficacité de la bureaucratie prussienne...). Le mariage fut toutefois autorisé par Himmler en personne, parce que Mme Hütteman attendait un enfant… (cf. Saul Friedländer, L’Allemagne nazie et les Juifs. t. 1., Les années de persécution, 1933-1939, Paris, Seuil, 1997, p . 202, qui cite Josef Ackermann, Henrich Himmler als Ideologe, Gottingen, 1970 , p. 159).
En fait la sélection raciale s’appliquait à toute la population allemande, car un contrôle était effectué pour tous les candidats au mariage. Tous les couples allemands en passe de convoler durent bientôt établir leur degré d’aryanité et présenter au RuSHA les pièces en rapport. Après 1939, ce même organisme fut chargé de diagnostiquer l’appartenance raciale de certaines personnes et groupes vivant dans les territoires occupés. C’est lui, également, qui commandita des enlèvements d’enfants dont on était sûr de la « valeur raciale ». Si besoin était, un spécialiste juridique mettait au point la falsification de l’identité des enfants. On a estimé à près de 200 000 le nombre de ces enfants qui furent littéralement enlevés en Pologne puis déplacés dans le Reich où on s’efforçait de les « germaniser ». Les enfants étaient capturés soit chez eux, donc arrachés à leurs parents, soit dans des écoles, des hôpitaux, y compris dans la rue. Himmler justifia ces enlèvements dans son discours de Posen du 6 octobre 1943, où il annonçait : « Nous prendrons les enfants slaves et nous les emmèneront en Allemagne ». Dans le même ordre d’idées, un ordre du 14 juin 1944, signé d’Alfred Rosenberg (le théoricien du racisme et ministre des territoires conquis à l’Est) stipule qu’on va arrêter 40 000 à 50 000 enfants en URSS de plus de 10 ans, pour les envoyer en Allemagne (Didier Lazard Le procès de Nuremberg. Récit d’un témoin. Éditions Nouvelle France, Paris, 1947, p. 240).
2) En suivant la chronologie.
La SS officielle est créée le 9 novembre 1925. En 1929, toujours, lorsque Himmler en prend la tête, la SS, sous le contrôle de la SA, ne comptait que 280 hommes. Pour avoir une idée de son expansion exponentielle rapide, disons que ce chiffre se monte à environ 10 000 en 1931, puis 52 000 en janvier 1933. Ensuite, la croissance est très remarquable, puisque la SS atteindra 2,5 millions de membres (les historiens varient sur ces chiffres, je ne les donne donc qu’avec hésitation).
Le plus important à savoir, c’est qu’en 1929, je l’ai dit, le 6 janvier, Himmler est nommé à leur direction, comme Reichsführer-SS (sorte de Maréchal), raison pour laquelle il devient le personnage le plus puissant d’Allemagne (après Hitler), et donc le principal responsable des crimes de masse. C’est Himmler qui a accompli le génocide des Juifs et a surveillé l’application des plans conçus pour le commettre. Himmler était déjà aux côtés d’Hitler lors du putsch de 1923. En 1929, il a 28 ans. C’est lui aussi qui impose le nouvel uniforme noir en 1932 (dessiné par Hugo Boss). Mais il y a eu d’autres chefs des SS avant lui : en avril 26, Joseph Berchtold, en mars 27 Erhard Heiden. C’est en 1930, quand la SS mate la révolte des SA à Berlin, que Hitler lui donne comme devise « Mon honneur, c’est ma fidélité ».
Dans la période d’exercice du pouvoir nazi (Hitler Chancelier), la SS, devenue une formation autonome du parti, va comporter cinq subdivisions :
- la SS générale, Allgemeine SS, est construite sur la base du petit groupe d’origine, qui s’est grossi jusqu’à compter 250 000 hommes en 1939. Hitler, d’après sa conception fondamentale, dont j’ai déjà parlé, pensait à une milice qu’il pourrait opposer aux communistes en cas de guerre civile. C’est dire que les SS doivent être des hommes sur lesquels on peut compter en toutes circonstances. Finalement, la menace de putsch communiste étant caduque, les SS reçurent d’autres missions : assurer la sécurité des participants aux fêtes et aux congrès du Parti, protéger les diplomates étrangers, effectuer des gardes des usines et d’autres points sensibles comme les ponts ou d’autres ouvrages d’art, etc.(ceci pendant la guerre).
- la Waffen SS, la SS de combat, qui finira par avoir plusieurs divisions, chacune dotée d’un armement très efficace (des chars d’assaut etc. : on se souvient, hélas, de la division Das Reich, qui a commis le massacre d’Oradour-sur-Glane en juin 1944). Cette branche est nommée officiellement SS-VT (Verfügnungstruppe).
- les SS Totenkopf (« tête de mort »), surveillent les camps de concentration, avec le zèle que l’on sait.
- Il y eut aussi le service de sûreté, le S.D. Sicherheitsdienst, depuis 1931 (inspiré par d’autres services de ce type dans le parti et dans la SA). C’est Heydrich qui en est chargé avec l’objectif de débusquer dans le parti saboteurs et agents infiltrés. C’est donc à l’origine un service de contre espionnage dirigé vers l’intérieur du Parti, pour démasquer et châtier d’éventuels ennemis.
- Le RuSHA, l’administration raciale – évoquée ci-dessus.
- Un sixième organe sera plus tard consacré à l’économie (la SS fut aussi acteur de diverses transactions commerciales… dont certaines consistaient à monnayer auprès de certaines entreprises les esclaves enfermés dans les camps de concentration).
3) En fait, le problème de constituer une garde personnelle efficace pour protéger Hitler ne cessera pas de se poser tout au long de cette période, sauf qu’après la création et le développement de la SS, aucune solution ne sera envisagée hors de la SS.
Dès ses débuts, le parti nazi dispose d’Ordnertruppe (pluriel), une sorte de service d’ordre, composée de ce que nous appellerions aujourd’hui, en langage familier, des « gros bras », et qui se présente comme une « Division gymnastique et sportive », sans doute pour bien marquer qu’il ne s’agit pas d’un groupe paramilitaire (ce genre d’association étant interdit après la défaite de 1918). C’est la première garde d’Hitler. Elle est alors dirigée par Ulrich Graff (qui prendra lors du Putsch les balles destinées à Hitler ; il a fait rempart de son corps, réflexe sacrificiel qui rappelle celui de l’aide de camp Muiron en faveur du général Bonaparte au pont d’Arcole, en 1796…). Les Ordnertruppe sont surnommés « service d’ordre des salles ». Leur tâche consiste en effet à affronter et exclure les perturbateurs qui viennent dans les réunions pour déclencher des bagarres et s’en prendre physiquement - et très violemment - aux orateurs. Exemple : le 4 novembre 1921 éclate une rixe avec les communistes, dans laquelle Hitler se fait tirer dessus, puis riposte avec son arme. Dans cet échange de coups de feu sont blessés deux fidèles d’Hitler, Emile Maurice et Rudolph Hess. Hitler en profite pour se féliciter du courage et de la totale abnégation de ses gardes du corps qui se sont jetés à corps perdu, c’est le cas de le dire, dans la bataille, au mépris de leurs propres blessures sanglantes et jusqu’à la limite de leurs forces. Emile Maurice était le chauffeur d’Hitler - probablement aussi son rival dans l’amour d’Angela Rauball, dite Gelly, fille de la demi-sœur d’Hitler, donc sa nièce (qui finira suicidée – mais on n’a jamais su le fin mot de l’histoire : elle fut peut-être assassinée).
Les Ordnertruppe avaient un effectif de 30 membres dont Julius Schreck, Joseph Berchtold, Joseph (ou « Sepp ») Dietrich, Rudolph Hess. Ils furent les premiers à recevoir l’emblème de la tête de mort. En mars 1923, quelques mois avant la tentative du « putsch de la brasserie », les Ordnertruppe furent remplacées par un service de protection personnelle, le « corps de garde », Stabswache, qui devint lui-même, deux mois plus tard, la Stosstrupp Adolf Hitler (Stoss signifie assaut). L’auteur de cette innovation, Göring, alors à la tête de la S.A. (en remplacement de Röhm), avait pour ce faire sélectionné certains hommes de la SA. Cette troupe nouvelle prêtait serment au Führer et elle était dotée d’un uniforme dont la casquette, à nouveau, comportait la tête de mort. Ce signe, je ne l’ai pas encore précisé, devait évoquer le prestige des anciens hussards prussiens. On peut dire aussi que la tête de mort révèle un rapport typique à la mort : une mort que l’on peut donner et que l’on ne craint pas de recevoir.
Disparue avec la S.A. après le putsch, la Stabwache fut recréée en 1925. Elle était alors composée d’unités de 8 hommes et était dirigée par un ancien de la Stosstrupp, que je viens de nommer : Julius Schreck. Ce sera bientôt la Schutzstaffel, la SS. C’est en effet en 1925, lors de la refondation du Parti, une fois Hitler sorti de prison et autorisé à reprendre ses activités politiques, que sont créés les SS en tant qu’équipe (ou Kommando) chargé d’escorter le Führer, de le protéger. Ils sont alors une centaine, puis s’augmentent jusqu’à 280. Bruno Geshe (ou Geishe) en est le chef. Ce proche d’Hitler, qui restera longtemps son garde du corps personnel, est un semi-débile alcoolique, qui suscitera d’ailleurs à ce poste des sentiments de rivalité très hostiles de la part d’Himmler – qui lui enjoindra à plusieurs reprises de cesser toute consommation d’alcool. Les SS portent alors une casquette noire avec la tête de mort sur deux os croisés, et un uniforme gris. Ce sera ensuite, imposé par Himmler, l’uniforme noir dessiné par Hugo Boss (dont la marque est toujours très présente aujourd’hui y compris en France), avec des bottes noires. Les SS, encore en petit nombre et subordonnées aux SA, bien plus nombreux se donnent malgré cela comme l’élite du Parti.
La constitution d’une garde rapprochée pour Hitler ne cesse pas de se poser pour autant. En février 1932, Hitler recrute dans la SS 8 personnes chargées de veiller sur lui jour et nuit, 24 h sur 24 (ils se relaient toutes les huit heures). C’est le Begleitkommando (begleiten = accompagner). Geishe, toujours lui, le dirige. Ensuite, le 17 mars 1933, Hitler crée parmi ces SS la Leibstandarte SS, un régiment de 120 hommes dirigé cette fois par Sepp Dietrich (autre nom cité plus haut). C’est un autre ancien des corps francs, en l’occurrence le Corps Franc Oberland qui a sévi contre les « Rouges » à Berlin. Sepp Dietrich a participé aux associations d’anciens Corps Francs, et c’est là qu’il a rencontré Hitler. La Leibstandarte SS comporte un millier d’hommes, qui sont basés à la caserne de Lichterfelde, un quartier de Berlin.
Ensuite de cela, avec les policiers en civil de Bavière, Himmler crée le Führerschutzkommando, dont est nommé chef le capitaine Johan Rattenhuber. Ce kommando devient ensuite un service séparé, le Reichsicherheitsdienst, RSD, service de sécurité du Reich qui, sous la houlette d’Himmler, est chargé de déjouer les complots, donc faire des enquêtes, surveiller les endroits clés où Hitler doit apparaître, à savoir toutes sortes de bâtiments (des brasseries, etc.). Évidemment, ces enquêteurs spécialisés de la police, avec Himmler lui-même, ne voient pas d’un très bon œil la garde rapprochée et son chef Bruno Geishe. Cela dit, lorsque Hitler se déplace, toute une organisation s’active en même temps que le Begleitkommando et le RSD. Tout au long des rues où Hitler paraît, et où il y a foule pour l’applaudir, la « sécurité » place un SS tous les 3 hommes, et elle dispose en plus des tireurs sur les toits. La voiture d’Hitler (qui se tient toujours debout pour faire des saluts à la foule et montrer qu’il n’a peur de rien!) est précédé de 50 mètres par un véhicule qui déclenche le garde-à-vous, etc.
(La suite à l’automne...)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par fjf le 22 Septembre 2021 à 19:05
Séance 9
MODALITÉS DE LA GUERRE NAZIE
Après l’interruption estivale, je reviens à mes moutons (noirs!).
Je vais continuer la description des milices nazies, et ceci afin de donner le plus d’assise possible à la thèse (descriptive encore une fois), d’une politique nazie - qui est plus une guerre qu’une politique, étant entendu que cette guerre menace toute la société allemande et non pas les seuls éléments a priori accusés d’être hostiles à l’État (les Juifs avec d’autres, bien sûr).
J’en étais à l’institution la plus caractéristique de cette entreprise violente, à savoir la SS… Et pour qu’on aperçoive de quel système tentaculaire il s’est agit, et pour faire sentir l’incroyable complexité à la fois pratique et mentale (je dis « mentale » pour suggérer le fait de l’élaboration... permanente qui plus est...) qui est propre à cette sorte de folie répressive en quoi consiste d’abord le nazisme, il me faudra envisager les choses plus profondément, en prenant en compte de menus faits, qui pourraient passer pour des détails.
Avant cela, je rappelle - et je complète - la formulation de mes principes de description fondamentaux.
1) Ma première hypothèse (je viens d’y faire allusion), consiste à dire que les nazis ont instauré un état de guerre permanent, qu’ils ont donc mené une sorte de « guerre interne » (civile) dans et contre la société allemande, disons : contre la population allemande, qu’il s’agissait de modeler pour qu’elle s’approche le plus possible de l’idéal de la « race pure » et de la « communauté » constituée uniquement par une telle race…
Pour se représenter cette « guerre », il suffit, me semble-t-il, de substituer ce mot de « guerre », à celui, plus courant et politique, de « répression » - que j’utilisais moi-même ci-dessus. Pensons aux rafles dans les pays occupés : elles n’avaient pas pour but de répondre à une protestation, une agitation, etc., mais bien plutôt de mettre en œuvre des procédures des sélection et d’exclusion de groupes « ethniques » qu’on voulait séparer du reste de la population, pour ensuite les enfermer, voire les supprimer…
En Allemagne, les nazis ont pris des mesures légales qui les dispensaient d’effectuer des rafles ; mais cela revenait au même… De quelles mesures s’agissait-il ? J’en cite deux, très évidentes : d’une part celles qui privent les Juifs de la citoyenneté et leur interdisent toute union avec des Allemands (les « lois de Nuremberg » de 1935) – avant de les déporter et de les exterminer ; d’autre part celles destinées à supprimer les handicapés, malades mentaux et autres personnes déficientes (on commence par les stériliser, ensuite on les assassine).
J’ai parlé aussi (séances 6, 7, 8), en rapport avec cette guerre permanente, de la militarisation de la société, ce qui n’était que le moyen le plus simple, le plus direct, d’entrer dans le combat mortel contre les prétendus « ennemis » du Reich. Avec les nazis, l’État (ou ce qu’il en reste, car c’est désormais un groupe militaro-sectaire) est entièrement restructuré sur ce projet de guerre à l’intérieur de ses frontières, contre la population même qui relève de son administration. Rien ne le révèle mieux que la réorganisation de la police dont j’ai antérieurement parlé, réorganisation qui a plusieurs aspects, et dont le principal consiste à confier l’ensemble des forces de police à la SS et à Himmler. Le 22 février 1933, Göring, ministre de l’Intérieur de Prusse (région qui compte pour environ les 2/3 du Reich), engage 50 000 policiers dits « auxiliaires », issus de la SA et des SS. Ces effectifs auxiliaires sont armés et ont des pouvoirs très semblables à ceux de la police ordinaire, l’Ordnungspolizei (police de l’ordre) et la Krimminalpolizei (police criminelle). Au même moment, en avril 1933, en Prusse toujours, Göring leur ajoute la Geheimne Staatspolitzei, la Gestapo, avec des policiers souvent issus de la SS. Puis, en 1936, Himmler, le Reichsführer SS, devient « chef de la police allemande » et ministre de l’Intérieur du Reich. Et en 1939 est finalement crée le Reichssicherheitshauptamt, RSHA (Office central de sécurité du Reich, parfois nommé « ministère de la terreur »), avec à sa tête Heydrich, le numéro deux de la SS, qui fusionne la police de sûreté (Sipo), et le SD , dans le but de pourchasser les « ennemis du Parti et de l’État »… D’où la création antérieure des camps de concentration, primitivement destinés à enfermer les opposants politiques du régime, sociaux-démocrates et communistes avant tout.
2) Pour saisir toutes les dimensions de la guerre des nazis contre la population allemande, considérée dans sa diversité, je voudrais revenir également sur les pratiques racistes que j’ai déjà évoquées, notamment en parlant des médecins nazis (cf. cours 2020, séances 6 et 7). Je dois compléter mes exposés précédents, fort lacunaires. En fait, il ne faut pas s’arrêter seulement aux expérimentations pseudo-médicales que ces médecins pratiquèrent dans les camps de concentration. Car avant cela, mais dans le même sens, les nazis ont mis en œuvre un véritable processus d’épuration de la population allemande. Pour ce faire, ils ont pris, très tôt après leur arrivée au pouvoir, les mesures successives (il y en a eu plusieurs) auxquelles j’ai fait allusion concernant les handicapés et les malades mentaux, dont il devenait certain que la vie était « indigne d’être vécue ». Ce sont là des formulations qui arrivaient dans le discours ordinaire des médecins... Voilà comment les choses se sont passées, en gros.
a) En premier lieu, les nazis décrétèrent par une loi du 14 juillet 1933 des obligations de stérilisation. Cette loi (« pour la prévention d’une descendance héréditairement malade »), structura la manière médicale de considérer les « vies indignes d’être vécues ». Hitler se référait d’ailleurs à la situation américaine et à une préconisation (antisémite) d’Henry Ford. Il fallait de toute urgence faire barrage à la transmission des caractères biologiques défaillants, comme ceux propres aux maladies génétiques (ou supposées telles). Une liste officielle retint : la faiblesse d’esprit congénitale, la schizophrénie, la psychose maniaco-dépressive, l’épilepsie héréditaire, la chorée de Huntington, le cécité, l’alcoolisme, une difformité héréditaire… Pour faciliter les choses, alors que Wilhelm Frick annonçait que seules les personnes racialement saines pourraient bénéficier de l’argent public, les nazis mirent en place des « Tribunaux de santé héréditaire » (comportant un juge et deux médecins), assortis de cours d’appel.
Suite à cela, fut donc fixée la série des « maladies héréditaires » dont les personnes qui les portaient devaient faire l’objet d’une intervention chirurgicale. 400 000 personnes étaient visées, et à partir de janvier 1934 et les années suivantes, 200 000 à 350 000 furent effectivement traitées. Quelques chiffres pour concrétiser ce désastre de la pensée médicale : la « faiblesse mentale congénitale » concernait 200 000 personnes, la schizophrénie 80 000 personnes, la psychose maniaco-dépressive 20 000, l’épilepsie 60 000. Fritz Lenz, médecin et généticien, un des auteurs de la doctrine et du programme d’« hygiène raciale » (dans sa thèse de 1917, il se montrait certain que la race était un « critère de valeur » fondamental, que l’État se devait de servir), proposa de stériliser y compris les personnes présentant des signes légers de déficience mental. Plus rigoureux encore, un professeur de Berlin se déclara favorable à l’ablation de l’utérus des femmes déficientes mentales, sous prétexte, expliquait-il, que les femmes stériles avaient une vie sexuelle plus intense et que par conséquent elles étaient très enclines à contracter la gonorrhée, qu’elles pouvaient alors communiquer aux hommes. Dans d’autres pays on pratiqua, comme ce fut le cas aux USA depuis 1907, la vasectomie (dans un autre contexte de diffusion de l’eugénisme). Ainsi était lancée la « guerre eugénique », comme a pu dire Henry Friedlander, qui marquait aussi les multiples prolongements que les premières mesures demandaient, pour désigner les hôpitaux aptes à intervenir, pour sélectionner les juges, et surtout pour déclarer les cas à traiter impérativement et ceux à épargner (d’après Henry Friedlander, Les origines de la Shoah. De l’euthanasie à la solution finale, Paris, Calmann-Lévy-Mémorial de la Shoah, 2015 [1995], p. 51.)
Il y eut des discussions sur la méthode à suivre, mais la plupart des praticiens préférait la ligature du canal déférent chez l’homme et la ligature des trompes chez la femme. En Allemagne, dès avant la Seconde guerre, une majorité de médecins était tout à fait favorable aux pratiques eugénistes et, bien que le caractère héréditaire des maladies ciblées fût loin d’être démontré, ces médecins voyaient d’un bon œil la perspective d’endiguer la propagation de certaines maladies. C’est aussi ce qu’ils espéraient pour la cécité, le surdité, les pieds-bots ou les becs de lièvre.
A titre d’exemple, voici comment un médecin pouvait justifier la demande de stériliser un sujet – en l’occurrence un sujet affecté à la catégorie un peu lâche des déviants sociaux. Ce sujet, affirmait le médecin, est
« un mendiant ou un vagabond en pleine déchéance. Il bénéficie d’une pension d’invalide de guerre à 50 % pour tuberculose pulmonaire et intestinale. Il se montre très peu économe avec son argent. Il fume beaucoup et se saoule occasionnellement (…). Il a été condamné plusieurs fois pour résistance à l’arrestation, tapage, insultes et coups et blessures. Les services sociaux signalent que son comportement a souvent perturbé le bon fonctionnement du bureau (…) C’est un individu gravement inférieur mentalement et qui ne présente aucune valeur pour la communauté. » (Cité in R. Evans, Le Troisième Reich, t. II, op. cit., p. 575.).
Notons la référence à la valeur sociale que l’individu peut représenter pour sa « communauté ».
Les potentielles « victimes » avaient-elles des échappatoires ? Assez peu. Car les « tribunaux de santé héréditaire », au nombre de 205 (Cf. Yves Ternon, « L’aktion T4 », in Revue d’histoire de la Shoah, octobre 2013, n° 199, p. 40), étaient certainement acquis à la cause de la stérilisation, si l’on en juge à leur composition : trois membres parmi lesquels deux médecins fonctionnaires des services de santé, dont l’un était lié au parti, le troisième membre étant un juge d’instance, mais lui aussi était choisi proche du Parti. Les cours d’appel auxquelles s’adresser en cas de litige ne penchaient pas souvent en faveur des victimes.
b) Deuxième axe de la politique nazie de santé raciale : le 18 août 1939, un décret secret du ministère de l’intérieur obligea les personnels médicaux et les sage-femmes à déclarer les « nouveaux nés mal formés et autres » (idiotie, mongolisme, etc. Voir Götz Aly, Les anormaux, Paris, Flammarion, 2014 [2013], p. 103 et suiv. Voir aussi Ph. Burrin, Hitler et les Juifs. Genèse d’un génocide, Seuil, 1989 , p. 68.). Ces enfants furent ensuite regroupés dans des unités particulières, mais cette fois… c’était pour les éliminer - sans autre forme de procès. Ainsi fut conçu et exécuté le programme d’extermination des vies soi-disant inutiles, c’est-à-dire, dans le langage officiel, de toute « existence indigne d’être vécue », qu’Hitler soi-même ordonna par une lettre antidatée du 1er septembre 1939, jour de l’attaque de la Wehrmacht contre la Pologne.
Mais cet ordre ne visait plus seulement les enfants. Car les malades mentaux adultes, les schizophrènes, les épileptiques, les paralytiques incurables et les criminels aliénés étaient désormais dans le collimateur. Une exception pouvait être faite pour les individus aptes au travail (sauf s’il s’agissait de criminels ou de… Juifs). L’opération fut dirigée par Philipp Bouhler, Obergruppenführer SS et chef de la chancellerie du Führer, et Karl Brandt, Gruppenführer SS, qui était à cette époque le médecin personnel d’Hitler. Six instituts furent consacrés à la pratique de ce meurtre déguisé en euthanasie. Un dispositif de transport se chargeait d’acheminer les personnes vers les lieux de leur assassinat, qui ne leur était présenté que sous un jour hospitalier. Il s’agissait donc de liquider tous les Allemands que la communauté raciale ne pouvait compter parmi ses membres, et dont les nazis pensaient qu’ils mobilisaient en pure perte des fonds ainsi que des lits dans les hôpitaux (des lits qui seraient mieux occupés par les soldats blessés). C’est ce qui a été codé en « Aktion T4 » (code inspiré par l’adresse du bureau qui dirigeait l’opération à Berlin).
Dans cette logique de « biocratie » où les médecins détenaient un pouvoir exorbitant, les techniciens du meurtre utilisèrent plusieurs procédés, parfois se combinant entre eux. On pouvait mourir après avoir ingéré une médication létale, ou bien parce qu’on était privé d’un médicament vital ; on pouvait aussi recevoir une piqûre empoisonnée (méthode pratiquée pour les enfants). Autre possibilité : être progressivement affamé par réduction des portions alimentaires (la méthode choisie dans la France occupée par le gouvernement de Vichy pour les hôpitaux psychiatriques – j’insiste sur ce fait méconnu : voir Isabelle von Bueltzingsloewen, « Les ‘aliénés’ morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques sous l’Occupation », in Vingtième siècle, n° 76, 2002/4). Et bien sûr, la principale méthode, élaborée par le chimiste Albert Widmann, consistait en l’assassinat par gazage. La procédure fut inaugurée à la mi-janvier 1940 dans une prison désaffectée près de Berlin. A dater de ce jour, des groupes de quarante à cinquante personnes internées dans les asiles (internées parfois pour des troubles assez légers), étaient enfermées dans des chambres spéciales, hermétiquement closes, des chambres à gaz ; et elles subissaient une asphyxie par le monoxyde de carbone, un gaz qui (selon certains historiens) pouvait être livré par l’entreprise IG Farben dans des bouteilles ad hoc, mais qu’aussi bien on produisait en faisant fonctionner un moteur de voiture dont les gaz d’échappement arrivaient par un système de tuyauteries dans la pièce fermée. Les victimes mouraient dans d’atroces souffrances.
En deux ans, de l’automne 1939 à l’été 1941, dans les six centres dont j’ai parlé, il y eut un peu plus de 70 000 victimes allemandes. Mais c’est alors que des protestations issues de la hiérarchie de l’Église (laquelle exigea que les médecins catholiques ne soient pas obligés d’appliquer la loi), aboutirent à interrompre le processus, fin août 1941. D’autant que certains malades, peu atteints, savaient pertinemment ce qui les attendait et tentaient de fuir ou de se rebeller. En plus, la population environnante commençait d’être au courant. C’est ce dont nous convainc une des pièces à charge présentées au procès de Nuremberg, en 1946, à savoir une lettre de l’évêque de Limburg (c’est alors la Belgique occupée), qui s’adresse le 13 août 1941 au ministre de la justice (Franz Schlegelberger), à Berlin pour lui dire :
« Une prétendue euthanasie est pratiquée systématiquement, depuis le mois de février, dans la petite ville d’Hadamar, à huit kilomètres de Limburg. Plusieurs fois par semaine des autobus arrivent à Hadamar, contenant de nombreuses victimes. Les enfants du voisinage disent en les voyant passer : « tiens, voilà encore le corbillard » ! Puis les habitants guettent la fumée des fours crématoires, dont l’odeur est répugnante. »…(Cité par Didier Lazard, Le procès de Nuremberg, Récit d’un témoin, 1947, p. 262)...
Les assassinats reprirent toutefois en août 1942, si bien que le nombre total de victimes se monte très certainement à plus de 200 000. Entre temps, ces tueries atteignirent aussi les « Juifs inaptes au travail » dans les territoires conquis, d’abord en Pologne dès l’automne 1939, puis au printemps 1941 en URSS. Un rapport du 19 septembre 1941, émané de l’Einsatzgruppe A, annonce avoir exécuté le 22 août en Lettonie 544 malades mentaux d’un asile d’aliénés. Venant cette fois de l’Einsatzgruppe B, un autre rapport, des 12 et 13 novembre 1941, mentionne que le 18 octobre 300 Juifs aliénés d’un asile de Kiev ont été liquidés. Je traiterai plus loin de ces « équipes d’intervention », les Einsatzgruppen, « équipes mobiles de tuerie », comme a pu dire Raoul Hilberg. Au même moment, les Juifs en général subissaient diverses opérations de massacre, effectuées désormais à l’air libre. Pour les chambres à gaz, un autre système sera mis au point, plus tard, en 1942, avec des cristaux d’acide cyanhydrique (un pesticide, le funeste Zyklon B), qui ont la propriété de dégager le gaz mortel lorsqu’ils sont au contact de l’air.
c) Il y a un autre signe, très explicite et important, de la guerre intérieure nazie : c’est l’évolution du droit pendant la période hitlérienne. Je n’aborde pas maintenant cette question, donc je me contente de signaler que le droit fut entièrement réglé d’une part sur l’obéissance inconditionnelle au Führer, d’autre part sur le principe suprême, qui devait l ‘emporter sur tout autre, le « droit à la vie du peuple allemand » (dans un numéro de la La documentation photographique, de 2012, intitulé Le nazisme. Une idéologie en actes, on trouve, sous la plume de J. Chapoutot, un bon article sur « Le nouvel État pénal ». Du même on lira aussi avec profit l’ article « Le ‘peuple’, principe et fin du droit », dans Le débat, 2014, n° 178. Cette question est aussi abordée par M. Broszat dans le chapitre 10 de son livre sur L’État hitlérien, op. cit.).
C’est dans ce contexte que, par exemple, un décret du 28 février 1933 (en même temps que celui sur l’incendie du Reichstag, qui s’élevait « contre la trahison du peuple allemand ») créa la « détention de protection » (SchutzHaft), ce qui permettait d’enfermer des opposants ou autres en se dispensant d’un passage par la justice et les juges (on trouve à la même époque une ordonnance sur le « commérage délictueux » ! ...).
Remarque : sur l’ État nazi dans ces conditions
L’idée de guerre permanente suggère à l’évidence un État conçu à l’inverse de ce qu’est habituellement un État… Car, même s’il se consacre toujours, en partie, à la protection de la population, sa défense contre des menaces intérieures et extérieures, il apparaît également comme une menace mortelle potentielle pour cette population elle-même. Je renvoie à nouveau au livre de M. Broszat pour avoir une vision très complète et fine sur les organes et le fonctionnement des organes nazis dans l’État hitlérien…
Conséquence : si on considère les multiples créations d’institutions, d’organismes, d’instances diverses, puis leurs modifications, réajustements, augmentations, etc. avec toutes sortes de circulations des hommes, des chefs, etc., on peut se dire (avec F. Neumann), que les nazis ont créée à l’intérieur de l’État une situation anarchique. Cette situation serait même la forme qu’ à prise la destruction de l’ État (comme dit Th. Snyder).
Pour ma part, je verrais tout aussi bien un phénomène de parasitage de l’État et des forces que l’État a à sa disposition. Parasitage ou même phagocytage : gêner et, en s’immisçant à l’intérieur de l’organisme, puiser dans ses réserves et utiliser sa substance, donc sa force propre. Je pense notamment au domaine de l’éducation, où on voit les anciennes associations d’éducation populaires intégrées par la Jeunesse hitlérienne ; de même que les anciennes écoles de chefs sont transformées en Napola, etc. N’est-ce pas aussi le modus operandi des forces de police nazies comme la Gestapo et le service de renseignement, le SD, qui finissent toujours par prendre le pas sur l’armée, la Wehrmacht? (c’est très clair dans la France occupée)
3) Une seconde hypothèse descriptive s’associe assez directement à la précédente. Il est en effet facile de constater que le nazisme affirme simultanément la caractère haïssable des non-Allemands (non aryens etc.) qui sont dénoncés comme parasites, et, du même mouvement, symétriquement ou réciproquement dirai-je, le caractère admirable, vénérable, etc. de cette nation allemande elle-même. L’un ne va pas sans l’autre, évidemment. Je retiens donc l’attachement à un ensemble idéal, le peuple Allemand, la « communauté raciale » (Volksgemeinschaft), un ensemble auquel sont attribués, on va le voir dans le cas de la SS, une série de particularités historiques qui sont autant de gloire éternelles. Pour fixer cette idée très simple, je renvoie au discours dans lequel Himmler, le 6 octobre 1943, à Posen (Poznan), expose ceci devant les Reichsleiter et les Gauleiter :
« La force de nos soldats allemands et du peuple allemand dans son ensemble réside dans la foi et la conviction que nous avons plus de valeur que les autres, conformément à notre sang et à notre race » (Cité notamment par Henri Monneray, La persécution des Juifs dans les pays de l’Est présentée à Nuremberg, Paris, 1949, p. 68-69).
Voir de même l’expression « race des seigneurs », assez peu usitée en fait, mais qui contient toute la charge narcissique dont il est question maintenant (sur cette notion de « race des seigneurs », voir Christian Bernadac, La montée du nazisme. Le glaive et les bourreaux, Paris, éditions France-Empire, 2013, p. 128).
Je souligne donc, ce qui n’est que trop évident (donc pas assez questionné) le fait que la détestation des Juifs se rapporte assez exactement à l’hyper valorisation des Allemands et à l’idéalisation de la communauté raciale populaire, la Volksgemeinschaft, le peuple racial germanique. D’après cette croyance, l’âme allemande est un être collectif dont la pureté originelle, inexpliquée et miraculeuse, peut toujours être retrouvée et réveillée, comme si l’histoire c’est-à-dire la civilisation juive et chrétienne n’étaient jamais parvenues à altérer son être spécifique, indemne de tout mélange. Il certain que cette croyance est au sommet de l’espérance nazie. C’est pourquoi la politique - ou plutôt la guerre - nazie a eu pour unique fil conducteur la défense de la pureté contre l’impureté et la corruption juives. Bien évidemment, cette hyper-valorisation ne dispense aucun Allemand du contrôle et de la répression éventuelles (donc de la menace guerrière) : mais dans l’esprit nazi, c’est justement pour que ce peuple soit sans cesse formé et réformé de façon à s’approcher le plus possible de l’idéal de la pureté...
En réalité, toute croyance qui oppose l’histoire réelle à un idéal promeut une dualité de ce type : c’est le mal contre le Bien, le diable opposé au bon dieu, l’ange à la bête…, bref, pour ce qui m’intéresse ici à propos des nazis : la sainteté versus la souillure - je reprends ces termes de la tradition religieuse .
Pour tenter de parer à ce que les nazis redoutaient comme une catastrophe biologique, le nazisme a promu de nombreuses mesures de séparation – d’abord géographiques (regrouper les Juifs et les envoyer le plus loin possible), ensuite génocidaires (faire disparaître pour toujours le monde juif). Évincer les Juifs de la société allemande et des autres sociétés européennes fut donc le premier et dernier but de la guerre sociale nazie. Préserver la santé raciale des Allemands impliquait simplement, si l’on ose dire, d’empêcher tout rapprochement de l’existence aryenne avec l’impureté fantasmée des Juifs. La prohibition de tout échange devint un principe de vie pour le groupement agonistique allemand établi sur ses bases communautaires. En France, le SS Aloïs Brunner, lorsqu’il était responsable du camp de Drancy, portait toujours des gants pour s’éviter toute relation physique avec les Juifs internés. Il y avait là comme une loi générale : il fallait que les Allemands demeurent toujours hors d’atteinte des Juifs, qu’ils soient toujours et en toutes circonstances injoignables… C’est ainsi qu’un ordre du Sicherheitsdienst, SD, le service de sécurité du Reich (après avoir été un organe du Parti) énonce, peu après le début de l’invasion d e l’URSS à l’été 1941 :
« Le premier but principal des mesures allemandes réside dans une séparation stricte de la juiverie du reste de la population. Pour l’exécution de cette disposition, il y a, avant tout, la discrimination de la population juive par l’introduction d’un ordre de recensement… » (Henri Monneray, La persécution…, op. cit., p. 40 ; voir aussi p. 79, le document n° 11 (PS 702), du commissaire du Reich pour les territoires occupés de l’Est, où l’URSS est concernée prioritairement. Ce sont des « Directives pour la solution de la question juive », et un paragraphe entier (le 3ème) porte sur « la séparation des Juifs du reste de la population ».
Peut-on comprendre ces décisions comme effet d’une idéologie ? Oui, mais à condition de ne pas oublier deux choses. D’une part que cette idéologie est liée à des pratiques de terreur – qui apparaissent bien dans l’extrait ci-dessus. Ceci signifie plus généralement que l’appropriation des idées par un sujet quelconque ne se ramène pas à l’acquisition pure et simple d’une conviction. Et d’autre part que ce qui est actif sur les consciences, ce ne sont pas simplement des idées mais des idéaux ou un idéal, et en l’occurrence l’idéal du peuple, de la nation, de la Volksgemeinschaft. Or l’idéal, nous le savons (voir dans le cours de 2014 ce que je tente de tirer de Durkheim, dans les séances 4 et 5) produit une foi, une croyance, celle-ci étant porteuse d’obligations. On peut dire en ce sens qu’un idéal crée du sacré, ce que révèle chez les nazis l’usage de catégories traditionnelles de la sacralité, notamment les catégories du pur et de l’impur : les nazis ne cesseront pas de parler de « race pure », de « sang pur », etc. En plus, dans le contexte Allemand d’après la guerre de 14, l’idéal, et cet idéal nationaliste en particulier, est associé à un ressenti profond d’humiliation nationale, après la défaite ; c’est une très grave frustration collective. L’idéal, ici, est donc d’autant plus vecteur de foi qu’il va littéralement justifier, autoriser dirai-je même, un désir de violence et de vengeance.
A cela une conséquence. Pour saisir la face réciproque de détestation des Juifs, autrement dit ce courant de haine viscérale anti-juive, il ne faut pas seulement faire référence à des doctrines racistes et antisémites (voir H. Chamberlain, D. Eckert – par lequel Hitler termine Mein Kampf – et d’autres auteurs), il faut plutôt comprendre le rapport entre la foi nationaliste et la détestation antisémite. La foi en l’idéal vise l’Allemagne, la race aryenne qui en est l’essence, etc. Et La haine antisémite, qui est un mouvement psychique de sens contraire est en réalité solidaire de la foi nationaliste, parce qu’elle vise ce qui est censé nuire à cet idéal, l’impur, tout ce qui menacerait la pureté de la race et donc cette Allemagne glorieuse, ce peuple censément guidé par un destin historique et mondial. La théorie du « coup de poignard dans le dos », qui aurait été administré par les Juifs et les communistes pour que l’armée allemande batte en retraite en 1918, voilà un bon exemple de lien entre la haine anti-juive et la célébration de l’Allemagne et de la race germanique ou aryenne.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par fjf le 13 Octobre 2021 à 14:01
Séance 10
INSTITUTIONS ET MILICES DE LA GUERRE NAZIE (3)
Je parle du nazisme et des monstrueuses exactions commises par les troupes allemandes, les SS en premiers, certains policiers ensuite, et, finalement, les soldats de la Wehrmacht. Alors regardez cette photo…
Je ne sais plus quand ni où elle a été prise. Peut-être en Russie ou Ukraine en 1942. Peu importe : rien n’est plus horrible à voir (étant entendu que le plus horrible n’a pas été photographié : les chambres à gaz…).
Cherchez ce qui est le plus insupportable dans cette scène… (et si vous ne la trouvez pas insupportable, alors, merci de bien vouloir quitter ce Blog!). Plusieurs choses, en fait, dépassent la raison :
- les corps dans la fosse
- les soldats autour qui regardent la scène, comme au spectacle. Ils semblent tranquilles… On tue un homme et c’est tout !
- l’assassin, autre soldat, qui va tirer et faire exploser le crâne de la victime : une besogne qui ne l’empêchera pas de manger, de dormir etc.
- la victime enfin, qu’on a fait asseoir au bord de la fosse pour qu’il ait bien conscience que l’instant d’après il ne sera plus qu’un cadavre sans nom parmi les autres cadavres sans nom… Quelles sont ses pensées. Essayez, je vous en prie, de les imaginer.
Voilà ce qu’a pu écrire Vassili Grossman : « Trouverons nous en nous la force de réfléchir sur ce que ressentaient durant leurs derniers moments les hommes et les femmes qui se trouvaient dans les chambres à gaz, effroyablement entassés au point que leurs os se brisaient. Quelles images passaient devant leurs yeux ? L’enfance ? Les jours heureux ? La conscience s’obscurcit. La minute ultime de l’affreux supplice est venue »
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Après les précisions de la séance précédente, destinées à cadrer la description des pratiques nazies, revenons aux SS (et à la séance 8, lors de laquelle j’ai donné un certain nombre d’informations préliminaires sur ce sujet).
Au début de leur création en 1925, les SS sont 280 ; en 1931 ils sont 15 000 ; en 1933 ils comptent 52000 membres (contre 3 millions pour la SA). En 1939 ils seront des millions ! Voir ci-dessous...
Je n’entre pas dans le détail de la répartition des groupes SS dans les différents districts (les Gaue – Gau au singulier) d’Allemagne.
I) Données générales
En reprenant des indications déjà données séance 8 (voir aussi l’ouvrage de synthèse Le nazisme en questions…, op. cit., p. 163), on a, en 1937, 5 piliers :
1) La SS générale (Allgemeine-SS), dont les membres ont une profession mais s’entraînent régulièrement ; 250 000 hommes en 1939...
2) La Waffen-SS (SS armée…. armée contre les ennemis et surtout le bolchevisme), qui fut créée en 1940 (officiellement en mars), et parviendra à engager 5 divisions dans la guerre contre l’URSS. En mai 1940, la Waffen-SS disposait déjà de 125 000 hommes (dont une partie appartenait à la police en uniforme). Mais elle recrutait aussi des Danois, des Hollandais, des Norvégiens, des Flamands. En 1944 la Waffen-SS comptera au total 38 divisions et 900 000 hommes ; mais pas seulement des Allemands : car elle est devenue cosmopolite, au sens où elle a recruté des non allemands (mais de race nordique). Les limites fixées par le Haut commandement de la Wehrmacht, l’OKW, au recrutement des volontaires allemands, ont été dépassées à cause de démobilisations qui eurent lieu en juillet de la même année 1940. Et c’est la lutte contre le bolchevisme qui draine de nouveaux volontaires étrangers.
En mars 1940, d’après un décret d’Himmler, la Waffen-SS, qui est donc un ensemble de troupes en plus d’être une police, assure elle-même son recrutement, gère son personnel, son intendance, ses services de santé. Elle a aussi des tribunaux.
3) Les SS Totenkopf, ou SS-Totenkopfverbände, SS tête de mort, sont ceux qui surveillent et gèrent les camps de concentration. C’est un décret d’août 1938 qui stipule que la SS-Totenkopfverbände (qui ne dépend pas directement d’Hitler puisqu’elle est sous les ordres d’Himmler) est affectée à la garde des camps de concentration. L’insigne tête de mort peut se comprendre comme délivrant aux titulaires un droit de tuer… (je ne résiste pas au plaisir de rappeler que les premiers soldats à porter un tel insigne, non sur leur casquette mais sur les manches de leur vareuse, c’étaient les… « Hussards noirs » de Napoléon!).
Remarque
On admet que le 1er camp de concentration fut créé en 1933 à Dachau, près de Münich, spécialement pour enfermer les ennemis politiques des nazis ; mais, les premiers camps, ou ce qu’on appellera ensuite des « camps » auraient été créés un peu plus tôt, dès le mois mars, y compris dans certaines prisons. Voir sur ce sujet l’impressionnante somme (plus de 1000 pages) de Nicolaus Wachsmann, KZ. Une histoire des camps de concentration nazis, Paris, Gallimard, 2017 [2015], qui consacre son 1er chapitre à cette question. En 1933, année de la prise du pouvoir, environ 200 000 personnes seraient ainsi passées et parfois auraient été assassinées dans de tels camps…(selon N. Wachsmann, idem, p. 47). En mars et avril ce nombre était probablement déjà de 50 000 (des personnes placées en détention préventive… donc incarcérées sans jugement…, et arrêtées par la police, la S.A. ou la S.S. - toujours selon N. Wachsmann, idem, p. 49).
4) Les polices soumises à la SS, en particulier le service de sûreté (Sicherheitsdienst, SD), dont je parlerai plus loin, qui est un service de renseignement (c’est-à-dire d’espionnage) du Parti, à l’origine dirigé vers l’intérieur du Parti.
5) Le RuSHA, l’Office pour la race et la colonisation, destiné à garantir la pureté raciale du Volk (peuple et race), donc d’abord des SS.
6) Après 1939 sera constitué un sixième pilier, l’Office central pour l’économie et pour l’administration, dirigé par Oswald Pohl, dont dépendent les entreprises économiques de la SS, la gestion des camps de concentration et de leur main d’œuvre. Car la SS fait de nombreuses affaires très lucratives (avec par exemple les biens confisqués, les personnes réduites en esclavage et revendues comme force de travail), et elle est devenue une entreprise gigantesque.
Ce qui caractérise l’histoire courte de ces groupements de combat, c’est le fait que peu à peu, les formations armées des SS s’affranchissent du contrôle de la SS générale, l’Allgemeine SS, laquelle, de surcroît, se détache des SA. Ce processus sera achevé en 1934 lorsque Hitler fera exécuter les chefs de la S.A.
Raffinons un peu…
Ces rubriques connurent elles-mêmes diverses évolutions . Voici les principales.
C’est la Verfügungstrupp ou SS-VT qui est à l’origine de la Waffen-SS . Cette SS-VT comporte en 1938 la deuxième Panzerdivision-SS dite « Das Reich» (voir Edouard Calic, Himmler et l’empire SS, op. cit., p. 31). La SS-VT se bat notamment en Hollande et en France. Les Panzer ce sont les chars d’assaut...
La SS-VT, se présente elle aussi comme une branche du Parti nazi. C’est dire qu’elle n’appartient ni à l’armée ni à la police traditionnelle et qu’elle est placée sous les ordres du Reichsführer Himmler. Mais elle reste à la disposition personnelle du Führer, et elle bénéficie de ressources allouées par le ministère de l’Intérieur. Himmler pensait plutôt à la future armée nazie.
La SS-VT constituait donc, je le répète, une troupe distincte de l’armée officielle (ce qui doit être clair d’après ce que je viens de dire), la Wehrmacht, même si son matériel lui était fourni par le haut-commandement de la Wehrmacht, l’OKW (qui surveillait ainsi son budget). Hitler quant à lui, considérait la SS comme une police personnelle, et à ce titre, il lui commandait des missions intérieures de sécurité, exigeant par conséquent qu’elle soit moins envoyée au front. De fait, les SS-VT étaient d’abord une police auxiliaire.
Les SS Wachverbände devenus SS-Totenkopfverbände, SS-TV, commandés par Theodor Eicke, étaient quant à eux une formation à tête de mort. Cette SS-TV tête de mort, comportait 3 régiments (« Oberbayern », « Brandenburg » et « Thüringen »). D’ailleurs la première division, la SS Totenkopf-Division, fut constituée sur la base des hommes de la SS-TV auxquels s’ajoutèrent les 40 000 réservistes de l’Allgemeine SS rappelés en 1939.
Le 29 mars 1936, SS-VT et SS-TV furent déclarées « organisations au service de l’Etat » ; et en octobre fut créée une inspection de la SS-VT au sein de la SS Hauptamt (bureau central) que dirigeait le SS-Brigade-Führer Paul Hausser. C’est le 17 août 1937 qu’ un décret secret du Führer définit la fonction militaire ou combattante de ces formations. Les deux groupes, SS-TV et SS-VT, séviront en Autriche, pour l’annexion de 1938. A ce moment Hitler portera la SS-TV à 8500 hommes et lui adjoindra la Standarte « Der Führer ». Tout ceci inquiètait les militaires de la Wehrmacht qui ne voyaient pas ces miliciens plutôt policiers d’un bon œil.
II) Les SS dans l’orbite du pouvoir nazi.
Quand les nazis prennent le pouvoir, en 1933 et que Hitler a les mains libres, la SS va, autant qu’elle peut, servir l’autorité et le statut d’Hitler Chancelier – et ce sous la houlette d’Himmler, entièrement dévoué à son Führer (Himmler est à la tête des SS depuis le 6 janvier 1929, 4 ans après la création de cette milice noire, l’ « Ordre noir » comme dit Heinz Höhne dans l’ouvrage que j’ai cité séance 8, L’ordre noir. Histoire de la S.S, 1968). On peut aussi se reporter sur ce point à l’analyse de Richard J. Evans, dans Le troisième Reich, t. II, 1933-1939, Paris, Flammarion, 2009 [2005 en anglais].
D’abord sont créées dans les grandes villes des commandos SS armés, des groupes politiques d’alerte, des Politischen Bereitschaften. Ces commandos sont en lutte contre les opposants communistes notamment.
Autre création : des formations de gardes (ou d’alerte), des Wachverbände, affectées aux prisons et aux camps .
En septembre 1933, au moment du congrès annuel du parti nazi, le NSDAP, à Nuremberg (comme chaque année), la Stabswache de Berlin (Stabswache signifie « garde de l’état-major » ; il s’agit d’une structure créée par Hitler en 1923, ensuite devenue la Stosstrupp Adolf Hitler - ce qui signifie « peloton de choc)… la Stabswache de Berlin, disais-je, est désormais un SS-Sonderkommando (détachement spécial) intitulée SS-Leibstandarte Adolf Hitler (LAH). C’est une sorte de garde prétorienne spécialement consacrée à la protection du Führer et commandée par un autre personnage redoutable, Sepp Dietrich, un vieux compagnon de Hitler. Ceci signifie du reste que ces SS ne sont même plus vraiment sous le contrôle d’Himmler...
Là encore mesurons l’incroyable croissance (rapide) de ces organismes de terreur : en mai 1942, le régiment initial de la Leibstandarte SS est devenu une armée de 12 divisions ! En fait, de 1933 à jusqu’à 1939, SS-VT et LAH seront très imbriquées… (c’est ce que notent certains historiens – et je n’ai pas vérifié).
Lorsque, le 30 juin 1934, a lieu, sur décision de Hitler, conseillé par Himmler, Goebbels et Göring, la purge meurtrière des SA, avec l’exécution d’une centaine de dirigeants et de leur chef, Ernst Röhm, tous accusés, de manière fallacieuse, de complot, c’est cette LAH, qui effectue la besogne. Et c’est le SS Gruppenführer Théodor Eicke qui se charge de l’exécution de Röhm. L’événement est resté dans l’histoire sous l’appellation de « nuit des longs couteaux »… (Si bien racontée dans le film de Lucchino Visconti, Les damnés, La caduta degli dei, 1969). (Sur la SS-Leibstandarte, voir M. Broszat, L’État hitlérien.., op. cit., p. 222). C’est après la nuit des longs couteaux que les Politische Bereitschaften sont regroupés dans une structure unique de la SS, la Verfügungstrupp, SS-VT, qui va devenir une division SS combattante, la 2ème division SS, connue sous l’intitulé de Das Reich…
Pour comprendre pourquoi la LAH et les Politischen Bereitschaften sont regroupés, ce qui sert de base à une Verfügungstrupp, SS-VT, c’est-à-dire une troupe en arme à sa disposition, il faut aussi se souvenir de la création, par une loi du 16 mars 35 de la nouvelle armée, la Wehrmacht, à la place de la Reichswehr (limitée à 100 000 hommes par le traité de Versailles de 1919). Cette même loi rétablit le service militaire.
Les rivalités et les conflits entre la SS et la Wehrmacht seront nombreux à partir de ce moment, jusqu’à ce que soient reconnues les qualités des SS au combat. En effet, avec l’opération Barbarossa contre l’URSS, la Waffen-SS accomplit de nombreux faits d’arme, après quoi la Wehrmacht voit ces SS davantage comme des soldats valeureux que comme des policiers militarisés.
Tout ça est un peu difficile à démêler, j’en conviens. J’essaie de clarifier en ne retenant que l’essentiel.
Au total, on le voit, les hommes de la SS, comme ceux de la SA, constituent en 1939 une immense milice, ou, si l’on veut, une immense troupe, y compris militaire. Et sans attendre 1939 et la guerre, les SS, dès après la prise du pouvoir par les nazis en 1933, investissent l’Etat allemand et le transforment profondément – transformation qui s’apparente à une destruction de toutes ses bases démocratiques. Concernant l’investissement des structures de l’État par les milices nazies, je rappelle simplement le fait (capital) de la mainmise des polices allemandes, en 1936, le 17 juin, par Himmler et les SS… La même année, le 1er décembre, une autre loi impose dans le même sens que toutes les organisations de jeunesse soient regroupées dans la jeunesse hitlérienne. On peut dire qu’avec ces lois (parmi d’autres, antérieures et postérieures), la dictature s’affirme en créant un pouvoir d’Etat tyrannique. Notez au passage que je ne parle pas d’abord de l’emprise des nazis sur la société et sur les individus (ce que désignerait bien la notion de « totalitarisme ») ; j’essaie de décrire avant tout, je le répète, une logique de guerre – plus que de répression - contre la population.
III) Vie et mœurs dans la SS
Pour traiter cette question, il faut distinguer à peu près trois groupes de règles destinées à structurer la vie S.S., comme une vie originale au service du projet hitlérien raciste .
a) Règles de discrimination raciste des individus
Les SS sont au Sommet de l’entreprise d’épuration raciste de la société allemande et des sociétés européennes au delà. Comment comprendre cette tendance ? Essentiellement par le désir de se débarrasser des Juifs… J’en ai déjà longuement parlé. Ne pas oublier que « le » Juif est pour les nazis, un virus, un parasite. Voici par exemple ce qu’assène le Bulletin d’instruction des SS (SS-Leitheft) du 22 avril 1936, dans un texte qui décrit trois figures de juifs dont la première est « Assuérus, le déraciné au sang instable qui, souillant la race et détruisant les peuples, erre sans fin de par le monde » (les deux autres sont d’une part « Shylock, dénué d’âme, qui réduit les peuples à l’esclavage économique et les tient à la gorge en pratiquant l’usure »; et d’autre part « Judas Iscariote, le traître. » (Cité par Saul Friedländer, L’Allemagne nazie et les Juifs, t. I, op. cit., p. 201).
Parmi les organes SS, les nazis avaient d’ailleurs institué un bureau expressément chargé du contrôle dans leurs rangs de la pureté de la race, le RuSHA, Rasse und Siedlungshauptamt, Office central pour la race et le peuplement (ou : pour « la race et la colonisation » - cet organisme sera jugé après le procès des médecins nazis à Nuremberg, en 1947) Le RuSHA, dont Himmler, qui en était l’inspirateur, dirigeait le Conseil d’administration, fut créé en décembre 1931 par Walther Darré. Parmi ses attributions il y avait la sélection généalogique des SS et d’autres contrôles du même type.
Ce bureau devint ensuite une référence pour les citoyens allemands en général. Pour en avoir l’idée, on peut se rapporter au cas d’une femme nommée Anneliese Hütteman qui fut presque contrainte en 1944 de renoncer à son projet d’épouser un Obersturmbannführer SS, Arthur Liebehenschel, qui n’était autre que le commandant d’Auschwitz à ce moment. Pourquoi des difficultés alors que le futur époux avait tous les titres requis ? Parce que cette dame, dix ans auparavant, en 1935, avait entretenu une relation avec un juif, relation qui avait été consignée dans un dossier que les dirigeants SS avaient pu consulter (ce qui laisse songeur sur la bureaucratie prussienne...). Le mariage fut toutefois autorisé, par Himmler en personne, pour l’unique raison que Mme Hütteman... attendait un enfant! Les SS étaient donc placés aux premières loges si l’on peut dire, de la discrimination raciale. Ils étaient tenus de cotiser à l’association ; et s’ils étaient candidats au mariage, c’est auprès du RuSHA qu’ils devaient fournir les preuves de la pureté de leur liens héréditaires, c’est-à-dire de l’aryanité de leurs ascendants, en remontant jusqu’au début du XVIIIe siècle. Indépendamment des SS, tous les couples allemands en passe de convoler durent aussi faire établir leur degré d’aryanité et présenter sans tarder au RuSHA les pièces en rapport. Après 1939, ce même bureau fut chargé de diagnostiquer l’appartenance raciale des personnes et des groupes vivant dans les territoires occupés. C’est lui, également, qui commandita des enlèvements d’enfants dont on était sûr de la « valeur raciale ». Si besoin était, un spécialiste juridique mettait au point la falsification de l’identité des enfants. On a estimé à près de 200 000 le nombre d’enfants kidnappés en Pologne puis déplacés dans le Reich où on s’efforçait de les « germaniser ». Les enfants étaient capturés chez eux donc littéralement arrachés à leurs parents, ou bien dans des écoles, des hôpitaux, y compris dans la rue . Himmler justifia ces rapts dans son discours de Posen, le 6 octobre 1943, où il annonçait : « Nous prendrons les enfants slaves et nous les emmèneront en Allemagne ». Dans la même perspective, un ordre du 14 juin 1944, signé d’Alfred Rosenberg (le théoricien du racisme et ministre des territoires conquis à l’Est) stipule qu’on va arrêter 40 000 à 50 000 enfants en URSS de plus de 10 ans, pour les envoyer en Allemagne (d’après Didier Lazard Le procès de Nuremberg. Récit d’un témoin. Éditions Nouvelle France, Paris, 1947, p. 240).
Pour comprendre le délire passionné des nazis concernant le sang soi-disant pur des aryens, on peut penser au fait qu’en juillet 1926 les SS reçurent d’Hitler mission de conserver le fameux « drapeau du sang », le drapeau qui, lors du putsch de 1923, avait enveloppé les militants blessés ou tués par la mitraille policière de Munich. En 1926, cette cérémonie, la Blutfahne, était imaginée comme une mise en scène, l’expression n’est pas trop forte, de la pureté quasi thaumaturge du sang allemand. La scène se répétait en telle ou telle occasion (comme le congrès annuel du Parti), quand étaient organisées d’immenses réunions de partisans et de miliciens, durant lesquelles les nazis rendaient un hommage éclatant aux morts héroïques du putsch de 1923. Hitler effleurait (caressait?) les drapeaux nazis avec l’étendard reliquaire tâché de cette essence sacrée (le sang pur). Les spectateurs, dit-on, demeuraient interdits et subjugués par la solennité du rituel et le recueillement des participants. Ainsi Robert Brasillach (je le rappelle : Brasillach a été fusillé en France à la Libération), a-t-il décrit en 1941 la célébration à laquelle il avait pu assister en 1936, lors du 8ème congrès du Parti tenu comme les autres à Nuremberg (Robert Brasillach, Notre Avant-Guerre, Paris, Plon, 1941, p. 276-277). On pense, confia Brasillach, à « une sorte de transfusion mythique analogue à celle de la bénédiction de l’eau parle prêtre – si ce n’est, osons le dire, à celle de l’eucharistie »(cité par Frédéric Rouvillois, Crime et utopie. Une nouvelle enquête sur le nazisme, Paris, Flammarion, 2014, p. 33.) Les seize morts étaient donc hissés à la postérité de guerriers germaniques quasi divins, reliés aux grands ancêtres et prédécesseurs des Allemands modernes. C’est dire, contrairement à l’intuition complaisante de Brasillach, que le modèle hitlérien évoque un modèle bien davantage païen que chrétien (le modèle de l’ apothéose romaine, une sorte de déification d’un humain).
Dans cet ensemble de règles, il faut aussi ranger les règles de production raciste de la descendance allemande, telle que celle-ci était encouragée par le Lebensborn, « Fontaine (ou source) de vie », qui poursuivait à son tour un but racial concernant de près les SS. Il s’agissait de maternités, ou de crèches, les deux étant destinées à faciliter la mise au monde et l’entretien des enfant de pur sang Allemand. Les statuts permettant de faire estampiller un tel établissement comme association Lebensborn datent du 12 décembre 1935, donc peu après les lois de Nuremberg (Cf.Boris Thiolay, Lebensborn, La fabrique des enfants parfaits. Enquête sur ces Français nés dans les maternités SS, Paris, Flammarion, édition J’ai lu, 2012, p. 18). Dans ces maisons, où atterrissaient aussi les enfants kidnappés à l’Est, eurent lieu 10 000 naissances à peu près. Les jeunes filles (en particulier si elles étaient réputées allemandes de souche, comme étaient censées être les filles de la Bund Deutscher Mädel, BDM, la section féminine de la Jeunesse hitlérienne), pouvaient choisir de concevoir un enfant avec un SS quelconque, puis d’abandonner le bébé c’est-à-dire de le confier à un tel Lebensborn, qui le placerait ensuite dans une famille allemande… de souche. Concrètement, les parturientes pouvaient accoucher de manière anonyme, ce qui en outre avait l’avantage de soutenir une politique nataliste en évitant les avortements. Ensuite, la naissance n’était pas déclarée à la commune de provenance de la mère, qui n’avait plus qu’à abandonner l’enfant, ce qu’elle pouvait faire douze semaines plus tard.
On ne sera pas surpris de constater que la tendance raciste du nazisme a également inspiré un désir lancinant d’explorer, de connaître et d’affirmer le passé germanique de la communauté allemande, la Volksgemeinschaft (ce qui revenait à défendre l’idée de la filiation par le sang). C’est bien là une autre caractéristique marquante du racisme nazi, cohérente avec ce qui précède. Les SS se sont donc tournés vers le passé et l’origine de leur prétendue race, et ils ont cherché, notamment dans la réalité archéologique, des indices et des traces de cette origine raciale supposée, en quelque endroit du monde où ils auraient pu être enfouis par le temps. Dans son roman, Les Bienveillantes, Johnatan Littell a bien restitué cet intérêt passionné pour la constitution d’une pseudo rationalité savante appuyée sur des enquêtes relatives à un réel social et historique. C’est ce dont s’était fait une spécialité l’Ahnenerbe, ou « Société pour la recherche et l’enseignement sur l’héritage ancestral ». L’Ahnenerbe (terme ce qu’on traduit aussi par « héritage ancestral »), était un organisme pseudo-savant créé en 1935 au sein de la SS par Himmler, normalement secondé par un préhistorien, Hermann Wirth, ainsi que par Walther Darré, le ministre de l’alimentation et de l’agriculture de 1932 à 1942. L’Ahnenerbe, sur les résultats de laquelle Hitler montra une certain scepticisme, avait pour finalité de procéder à des fouilles archéologiques. Dans cette perspective, elle inspira (à défaut d’organiser) une fameuse expédition au Tibet - emmenée par Bruno Beger (on a vu un film récent raconter cette aventure). La recherche fut évidemment sans résultats probants, mais ceci ne dissuada pas Himmler. Après plusieurs transformations, l’Ahnenerbe se dotera de plusieurs branches, en particulier un Centre d’enseignement et de recherche sur l’Asie centrale. Même chose pour la philologie et l’histoire antique, la géologie et d’autres spécialités estimées utile à la recherche des traces les plus lointaines de l’existence de la soi-disant race aryenne et de sa contribution au mouvement de la civilisation (au singulier). Après la guerre, nombre des professeurs affectés à différents postes de cette organisations furent employés dans les universités allemandes. Sous la direction de l’Ahnenerbe, certains médecins, toujours dans le but de saisir ce qui pourtant leur échappait, l’identification des caractères biologiques propres à la race aryenne, ont en outre effectué des expériences atroces et meurtrières, sur des détenus condamnés qui leur servaient de cobayes humains, dans plusieurs camps de concentration notamment Auschwitz ou même le camp français du Struthof, près de Strasbourg (Sur les fonctions pseudo-scientifiques accomplies par les médecins nazis, voir Ernst Klee, La médecine nazie et ses victimes. Solin-Actes Sud, 1999 [1997]. On trouvera dans ce livre indispensable le détail de toutes les expérimentations meurtrières effectuées par les médecins nazis. Et spécialement sur l’Ahnenerbe, voir p.. 251-278. Sur l’activité des sbires de l’Ahnenerbe au Struthof, sous la direction d’August Hirt, voir p. 258 et suiv. L’un des procès de Nuremberg concerna 23 médecins nazis. Il se tint en 1946 et 1947 et se conclut par 7 condamnations à mort, exécutées en 1948).
b) Règles de production de la vie SS.
Lors du recrutement des SS (souvent issus de milieux bourgeois de culture et de fortune, et même de l’aristocratie, ce qui n’était pas du tout la cas des SA, bien plus « populaires »), il revenait au RuSHA, la phase de sélection raciale. Les SS devaient être de pure race nordique, mesurer au moins 1,75m (1,80 dans la LAH).
Quand ils étaient acceptés, les SS étaient engagés soit pendant 4 ans dans la troupe, soit pendant 12 ans pour les sous-officiers, soit encore pendant 25 ans pour les officiers. Ils devaient avoir accompli le service du travail (d’une durée de un an). Admis à 18 ans, le SS avait un long entraînement militaire pour apprendre « comment tuer et comment mourir » disait Hitler. L’entraînement physique était essentiel – et intense. En outre, le SS bénéficiait d’un enseignement qui était en réalité un endoctrinement, avec une sorte de catéchisme nazi, un texte comportant questions et réponses.
Remarque
J’ai souvent parlé de la S.S. comme d’une secte. Je voulais par là suggérer que le groupe est absolument fermé vis à vis du monde extérieur, et en même temps, fondamentalement hostile à ce monde. Ceci est vrai, je n’y reviens pas. Toutefois, lorsqu’on fait allusion au mode de recrutement des SS, il faut aussi constater que toutes les personnes acceptées sont en quelque sorte prédestinées à être accueillies, en vertu d’un signe majeur dont elles sont porteuses, à savoir un signe racial. Pour devenir un S.S., il fallait être aryen, ne pas avoir d’ascendants Juifs (ce que vérifiait le RuSHA dont j’ai déjà parlé), et si possible démontrer cette aryanité, cette germanité pure du sang, par des traits physiques visibles (yeux bleus, cheveux bond, haute taille, etc.). De ce point de vue, la SS se rapproche non pas tant de la secte que de la tribu… Mais je laisse cette question sans la développer pour l’instant.
L’uniforme noir (dessiné par Hugo Boss), qui devait marquer la dignité de la fonction du SS, était d’abord remis mais sans les insignes de col et avec une carte d’identité SS provisoire, la définitive étant remise le 20 avril, jour de l’anniversaire d’Hitler. L’initiation était conclue par une cérémonie avec prestation de serment ainsi formulée : « je te jure, Adolf Hitler loyauté et bravoure. Je te promets solennellement, ainsi qu’à ceux que tu m’as donnés pour chefs, obéissance jusqu’à la mort, avec l’aide de dieu ». Au terme de cette cérémonie, le SS recevait le fameux poignard (un poignard était aussi remis dans la Jeunesse hitlérienne) dont il pouvait se servir pour venger son honneur chaque fois que nécessaire. C’était là quasiment un droit d’assassiner : d’après un décret de 1935, cet usage du poignard était autorisé même si l’adversaire pouvait être repoussé par d’autres moyens... Sur le poignard, on avait gravé les symboles SS, non pas deux éclairs mais les deux runes symboles de victoire. Après cela, le jeune SS était affecté à un service où les supérieurs estimaient qu’il serait efficace : Waffen-SS, camps de concentration, Gestapo, ou bien un Einsatzgrupp en URSS.
La vie privée du SS était contrôlée dans la même perspective. On remettait par exemple une tasse en argent pour un enfant nouveau né. Sur la tombe du SS mort en service commandé était déposée une Toten Rune, une rune en bois, la rune des tués. Himmler a même décrit la meilleur manière de se suicider pour préserver l’honneur de l’unité SS d’appartenance.
Les SS avaient instauré un serment au Führer dès leur première apparition, en mars 1923, sous la forme de la Stabwache, avec quelques dizaines ou centaines d’hommes encore dépendants de la SA. En fait, sous Hitler, le serment est différent de celui qui avait cours jusque là.
Si on se rapporte au serment cité plus haut (« Je te jure, Adolf Hitler, Führer et chancelier du Reich, fidélité et vaillance. Je te promets solennellement, ainsi qu’à ceux que tu m’as donnés pour chefs, obéissance jusqu’à la mort, avec l’aide de dieu »), on voit bien la différence entre ce serment et l’ancienne pratique (par exemple dans l’armée). Le nouveau serment est entièrement dédié non pas à la Constitution de Weimar, mais à la personne d’Adolf Hitler. Par là, les nazis cherchaient à rendre indéfectible l’engagement militant, celui des SS comme d’autres, auprès de leur Führer. Les SS, qui étaient d’ailleurs soumis au Führerprinzip, le principe d’obéissance absolue aux décrets du Chef, devaient donc se dévouer jusqu’au sacrifice de leur vie ! (le 9 novembre dont il est question, c’est surtout la date anniversaire du putsch de Munich, en 1923 ; et cette correspondance, qui n’est pas fortuite, donne au serment une valeur commémorative qui en fait presque un rituel religieux – mystique en tout cas).
Remarque
L’Allemagne nazie connut une inflation (de serments ; voir la revue Histoire@Politique, n° 40, janvier-avril 2020, « Nazisme et serment de fidélité », qui contient de très pertinentes analyses et des descriptions saisissantes de l’envahissement de la société allemande par les pratiques de serment dans la période nazie). Le serment se pratiquait dans la SS, dans l’armée, dans la jeunesse hitlérienne... ; et il y eut même un pour les pasteurs… comme pour d’autres rassemblements, comme ceux de la Hitlerjugend (« je jure dévotion à Adolf Hitler... »). De même, les fonctionnaires devaient s’engager à rester fidèles au Führer (loi du 26 janvier 1936). Dans l’armée, un serment de fidélité fut instauré en 1934 (la création de la Wehrmacht est de mars 1935). Les soldats annonçaient : « Je jure devant dieu obéissance inconditionnelle à Adolf Hitler, Guide du Reich et du peuple allemand (.. .) et que je serai toujours prêt, comme un soldat courageux, à donner ma vie pour respecter ce serment. » Les membres de la SS avaient quant à eux pour devise « Mon honneur s’appelle fidélité » (Meine Ehre heisst Treue) ; et leur prestation de serment, obligatoire elle aussi en 1934 (le 2 août), était entourée d’un faste éclatant. A dater de 1936, elle avait lieu à la date anniversaire du putsch de Munich, le 9 novembre, en pleine nuit, à la lumière des torches, et simultanément dans toutes les villes concernées. A Munich, la cérémonie se déroulait à la Feldherrnhalle, devant le drapeau tâché du sang des « martyrs » du putsch de 1923.
c) Règles d’élaboration et de diffusion d’une pensée mystique destinée à imposer un roman historique national allemand. En fait, Himmler voulait faire revivre la chevalerie teutonique des temps anciens ; il voulait former une classe supérieure apte à dominer l’Europe pendant des siècles (Cf. Jacques Delarue, Histoire de la Gestapo, Nouveau monde éditions, 2012. IIème partie, chap. 2 p. 136 et suiv.).
Les SS étaient donc réunis par leurs chefs dans d’anciens châteaux, des forteresses, dans lesquels se pratiquait un rituel inspiré des Jésuites, mais où les dieux germanistes avaient pris la place du Christ. Le château de Wewelsburg, rebâti après 1934 sur ordre d’Himmler, fut ainsi choisi pour servir de monastère SS où se tenait tous les ans une réunion avec des exercices de concentration, des équivalents de prières, des discussions de la politique SS. Ce lieu avait été repéré par l’Ahnenerbe comme un endroit spécial où était concentrée une grande énergie tellurique…. Chaque salle célébrait un héros Allemand. Au centre il y avait la salle de l’Ordre (L = 45 m, l = 30m) où trônait, si l’on ose dire, une table ronde avec 13 fauteuils (comme dans la légende arthurienne), chacun au nom d’un Obergruppenführer… C’était donc l’homme Himmler avec douze apôtres ! En dessous il y avait une crypte nommée « royaume des morts », et dédiée au repos éternel des SS décédés, qui d’ailleurs pouvaient être remplacés, si leur cadavre était introuvable, par les cendres de leur blason. Voilà donc comment les SS pouvaient avoir une certaine conscience d’eux-même comme appartenant à une élite ayant toujours la ressource de tuer des ennemis sans mauvaise conscience.
Himmler, sous l’emprise d’un véritable délire métaphysique, prescrivit en outre aux SS des célébrations païennes, comme celle du solstice d’hiver - à la place de Noël, ou comme une fête de commémoration du passé germanique, au début de l’année, lors de laquelle les participants se voyaient remettre un chandelier à trois branches, symbole de renouveau. Himmler lui-même rêvait qu’il avait vécu mille ans auparavant en tant qu’Henrich 1er de Germanie (dit Henri l’oiseleur à cause de sa passion pour les faucons), le père d’Otto premier, le premier Empereur du Saint Empire romain germanique, dont l’existence remonte au... Xe siècle ! Himmler se recueillait chaque année sur sa tombe. En 1936, il fit célébrer le millénaire de la mort de cet Henri. Ceci révèle que pour lui les individus étaient une partie d’une âme collective, qu’ils incarnaient donc dans plusieurs vies. Lors de cette célébration, Himmler expliquait aux SS qu’ils avaient déjà vécu, qu’ils revivraient donc, et que cette série d’existences les vouait à accomplir une mission spéciale. Himmler aboutissait ainsi à l’idée que ses SS n’étaient autres qu’une une réincarnation des chevaliers teutoniques du Moyen âge !
Himmler voulait en outre abolir la monogamie. Le magasine des SS Die Das Schwarze Korps a même publié la thèse qu’il fallait copuler dans les cimetières où étaient inhumés des héros allemands. D’où une liste de lieux, officiellement approuvée. Dans la même perspective, on détruisit les cimetières Juifs ; sauf un, à Worms, à cause d’une superstition d’Himmler qui craignait un châtiment divin du fait qu’il y avait là du sable sacré de Jérusalem… (comme quoi l’histoire juive ne le lâchait pas!)...
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par fjf le 3 Novembre 2021 à 09:11
Séance 11
INSTITUTIONS ET MILICES DE LA GUERRE NAZIE (4)
LES POLICES POLITIQUES
J ’ai déjà dessiné les grands traits de la réorganisation nazie des polices allemandes. Je renvoie au cours de 2020, séance 4. A cette occasion, j’ai notamment traité de la Gestapo. Je n’ai donc besoin maintenant de procéder qu’à des rappels ; mais que je vais assortir de quelques remarques complémentaires, qui me permettront d’envisager la complexité pour ne pas dire la confusion régnant au sommet et à la base du pouvoir nazi. C’est un désordre que plusieurs historiens ont souligné, pour marquer que le pouvoir nazi procède à un très grand nombre de transformations qui sont autant de destructions des institutions démocratiques qui ne créent cependant aucun environnement étatique consistant, sécurisant, aidant, etc.
1) Sur la Gestapo.
La Geheime Staatspolizei, police secrète d’État, fut créée en avril 1933 par Göring, en Prusse (État ou région - Land - dont Göring était ministre et Président). C’était pour l’essentiel un service de renseignement, le policier gestapiste ordinaire étant donc un espion… mais un espion de l’intérieur et devant agir vers l’intérieur de la société allemande. Il s’agissait de surveillance et de répression des opposants, de quelque nature qu’ils fussent, adversaires politiques, ennemis du régime, etc. En d’autre termes, les gestapistes furent un groupe violent voué à l’exclusion puis à l’élimination d’ennemis raciaux, ou bien plus généralement d’ennemis sociaux. La désignation de tels ennemis est fondamentale pour comprendre la mise en place de cette instance qui fut un des piliers du régime de terreur qu’on appelle nazisme… « Police secrète d’État » : ce titre est très éloquent, il ne faut pas l’ignorer. Bien sûr, dans le collimateur de la Gestapo figurent des gens innocents de tout crime, mais qui, censés être opposants au régime, peuvent faire l’objet de très graves maltraitances, allant jusqu’à la mise à mort. Dans le Journal de Viktor Klemperer, on voit des gestapistes surgir dans la maison où il a été contraint de se loger, à Dresde, en présence d’autres familles, et ces gestapistes, ne trouvant rien de très répréhensible selon leur propre loi à se mettre sous la dent (j’ai failli écrire : « sous la matraque »!), se livrent, par pure méchanceté contre un Juif, à toutes sortes de brimades, par exemple jeter par terre et fouler au pied certaines réserves alimentaires du couple! (Voir cet exceptionnel témoignage de Viktor Klemperer, publié après la guerre, notamment le t. 2, Je veux témoigner jusqu’au bout. Journal, 1942-1945, Paris, Seuil, 2000, qui contient de nombreux récits des agissements de la Gestapo, tous plus bêtes et méchants les uns que les autres - grossièretés, insultes, gifles, coups, etc.).
La date exacte du décret qui instaure la Gestapo est le 26 avril 1933 (cf. Jacques Delarue, Histoire de la Gestapo, op. cit., p. 74). Cette date est très proche de celle de l’arrivée d’Hitler au pouvoir comme Chancelier, le 30 janvier… Remarquez cette proximité. La Gestapo sera dirigée en 1934, par Reinhard Heydrich…
a) C’est donc en 1934 que la Gestapo fut placée sous l’autorité de Himmler et secondement de Heydrich, adjoint d’Himmler (Heydrich était officier de marine, enseigne de vaisseau de 1ère classe, mais remercié pour une raison obscure). En 1942, Heydrich sera mis hors jeu parce qu’exécuté par des Résistants, à Prague, le 27 mai… En fait, il est mort une semaine plus tard des suites de ses blessures. Je rappelle en passant que la mise à mort des 2,5 millions, au moins, de Juifs polonais a été codifiée en Aktion Reinhard, donc avec le prénom d’Heydrich, pour rendre hommage à sa personne et saluer sa mémoire !
Quand Himmler devient chef (et inspecteur) de la Gestapo, Heydrich prend donc la direction de l’administration correspondante, la Geheime Staatspolizeiamt, Gestapa, direction de la police secrète d’État, qui régit toutes les polices politiques du Reich. C’est au même moment que le Parti nazi décide que le Sicherheitsdienst, SD, service de sécurité du Reich, un organe de contre-espionnage dirigé vers l’intérieur du Parti, pour en détecter et en chasser les « ennemis » infiltrés (organe dont je traiterai plus tard…), devient officiellement le service unique d’information du Parti.
En suivant le récit d’Heinz Höhne (L’ordre noir, Histoire de la SS, Casterman, 1968 [1967], p. 109), nous apprenons qu’en 1934, un an après la création de la Gestapo, Himmler et Göring se sont en quelque sorte partagé les tâches. Alors qu’Himmler et Heydrich ont mis la main sur les polices régionales, les Länderpolizeien, donc qu’ils étendent leur emprise sur les polices politiques des Länder, Göring confie la Gestapo à Himmler (c’est-à-dire aux SS). Et réciproquement, la SS accorde son soutien à Göring dans son projet d’éliminer les SA et Röhm (ce qui arrivera lors de la « nuit des longs couteaux » à la fin juin 1934).
Pour définir l’idéal sur lequel se règlent les activités de cette ou ces police(s) politique(s), je citerai deux textes. D’abord un décret du 10 février 1936, dans lequel Göring, alors ministre de l’Intérieur de la Prusse (entre autres) et responsable du « Plan de quatre ans », déclare:
« La Gestapo a la tâche de rechercher toutes les intentions qui mettent l’État en danger, et de lutter contre elles, de rassembler et d’exploiter le résultat des enquêtes, d’informer le gouvernement, de tenir les autorités au courant des constatations importantes pour elle... ».
Ensuite, plus lointain, mais très significatif, un énoncé ô combien révélateur de ce que j’appelle une pratique de l’ennemi. C’est, dans le Bulletin d’instruction des SS (SS-Leitheft) du 22 avril 1936, la formule suivante :
« Dans la SS, nous parlons des juifs parce que le juif est l’ennemi le plus dangereux du peuple allemand » (cité par S. Friedländer, L’Allemagne nazie et les Juifs, op. cit., t. I, p. 201).
Je rappelle que parler d’ennemis n’est jamais anodin, puisque les ennemis sont ceux contre lesquels il faut engager un combat à mort. Dans cette perspective, dont j’ai assez dit qu’elle est un fondement du nazisme, c’est la politique elle-même qui est dépassée, détruite, dans la mesure où est politique, par définition, une lutte pour le pouvoir qui, en même temps, renonce au meurtre. Dans le même état d’esprit agonistique furent les policiers de la Kriminalpolizei ou Kripo, du Sicherheitsdient ou SD, service de renseignement des SS, et de la Sicherpolizei ou Sipo. La Gestapo fut d’ailleurs un département de la Kripo, cette dernière étant elle-même un secteur de la Sipo…. Ceci, qui rend les choses assez entremêlées, devrait s’éclairer plus loin.
b) Pour saisir les missions de la Gestapo, représentons-nous bien les deux grandes transformations et réorganisations de la ou des police(s) allemandes auxquelles procèdent les nazis - depuis le début de leur prise du pouvoir, je le redis.
- Il y a d’abord le décret fondamental du 17 juin 1936, qui unifie les polices, et qui vaut comme loi fondamentale de la Gestapo (cf. séance 4 de 2020). A ce moment, les administrations locales des Länder sont dépassées au profit du niveau fédéral, et de ce fait, la police tombe sous la coupe de la SS. Dans ce cadre nouveau, le terrain d’action de la Gestapo c’est l’Allemagne, donc, finalement, la société toute entière… Dans un premier temps la Gestapo s’illustre à Berlin, puis elle étend son action à toutes les grandes villes en imposant des sortes de postes avancés dans des villes de moindre importance.
Cette unification des polices est le fait décisif pour comprendre le fonctionnement et l’évolution du régime.
Göring avait conçu pour la Gestapo quatre branches (je me réfère toujours à H. Höhne, L’ordre noir, op. cit.). Une branche pour l’administration et l’économie, une deuxième pour la justice, la troisième pour réglementer l’action de la police politique, et une quatrième consacrée à la police de sécurité. Mais Heydrich va refondre le tout et ne retenir que trois sous-sections. La I, pour l’administration et la justice, que va diriger Werner Best ; la II, sur la police et la sécurité, également dirigée par Best ; et la III qui organise la police politique, donc est au cœur de l’institution, où s’activent les anciens de l’équipe bavaroise d’Heydrich. Il y a dans ce dernier cas plusieurs sous catégories : l’une se consacre au « marxisme » (il s’agit d’éliminer socialistes et communistes), une deuxième porte sur l’Église et les groupes politiques de droite (donc les non nazis) ; et la troisième porte sur la défense de la race (c’est la sous-section contre les homosexuels, contre l’avortement, contre les rapports sexuels entre Juifs et non-Juifs) et plus généralement contre les courants censés être hostiles que sont la franc-maçonnerie et les sectes religieuses. Je cite ces détails pour confirmer l’idée d’une extension indéfinie de la notion des « ennemis », les personnes suspectes et à éliminer. Une note d’un commissaire criminel, Wendzio, énumère marxistes, communistes, Juifs, églises plus ou moins politisées, francs-maçons, opposants, mécontents politiques et apolitiques, réactionnaires de droites, saboteurs de l’économie, voleurs et criminels, homosexuels et avorteurs ; et la note précise que « leur influence s’exerce à l’encontre de la vigueur raciale et spirituelle du peuple allemand » (cité in Höhne, idem, p. 111). D’où les trois groupes visés par la Gestapo. Groupe A1 : les ennemis du régime à emprisonner en cas de mobilisation probable ; groupe A2 : les ennemis du régime à emprisonner en cas de mobilisation certaine ; groupe A3, non pas des ennemis, mais des gens..., à surveiller et emprisonner peut-être en temps de guerre. Les premiers ont un cavalier rouge en haut à gauche de la fiche qui leur est consacrée, les deuxièmes un cavalier bleu, les troisièmes un cavalier vert. Un deuxième cavalier à droite précise : rouge : communiste, rose : marxiste, brun : saboteur, violet : esprit critique.
N’est pas là, au total, ce qui marque la tendance des nazis à contrecarrer et supprimer toute pensée un tant soit peu déviante ?…
-Il y a ensuite, en septembre 1939, au moment où l’Allemagne envahit la Pologne, le regroupement de toutes les polices au sein d’un organisme unique, le Reichsicherheitshauptamt, RSHA, Office central de la sécurité du Reich, que va diriger le même Heydrich. (J’en traiterai plus tard, donc je n’insiste pas pour le moment). Karl Oberg, général de police SS, arrive alors à la tête des services policiers, d’après le vœu d’Himmler ; et c’est alors que la Gestapo devient l’organe central dont dépendent tous les autres services. Heydrich est en principe subordonné à Wilhelm Frick, ministre de l’Intérieur nommé par Hitler, mais il passera outre cette tutelle (Frick sera condamné à mort et exécuté par les alliés lors du procès de Nuremberg en 1946) .
La Gestapo comporte 35 hommes au début, en 1933, mais 607 en 1935, et la dépense pour entretenir ce groupe est passée de 1M à 40 M de marks . D’après Eric A. Johnson (La terreur nazie. La Gestapo, les Juifs et les Allemands « ordinaires », Paris, Albin Michel, 2001 ; un livre appuyé sur des études locales, très importantes pour apprécier la réalité objective en ce domaine), on peut penser que l’efficacité de la Gestapo, avec assez peu d’effectifs, aurait été bien plus faible sans l’apport des dénonciations effectuées auprès de ses services. En effet, précise Eric Johnson (idem, p. 32 et suiv.), si on cherche à évaluer l’emprise de la Gestapo sur la société et la population , on doit constater que cette emprise n’était pas si importante qu’on l’imagine après coup, ce qui veut dire que seul le rôle des citoyens, qui collaborent et dénoncent (et ils sont très nombreux à le faire!), peut expliquer le degré d’efficacité auquel la Gestapo est parvenue… Dans l’Allemagne nazie, la terreur n’était pas omniprésente, par conséquent il fallait bien que la Gestapo s’appuie sur une société civile qui avait toutes sortes de raisons de lui apporter son concours, y compris des inimitiés de voisinage, des récriminations à l’encontre de tel ou tel pour telle ou telle raison, presque futile parfois, et ainsi de suite. Dans un film récent diffusé sur la chaîne Histoire (sur L’ascension et la fin du IIIè Reich), dans le dernier épisode, sur la période 1943-1945, est évoqué le cas d’un chanteur en vogue qui un jour a la malencontreuse idée de faire en public une plaisanterie sur le Führer… Cette personne est ensuite dénoncée, si bien que peu de temps après la Gestapo l’arrête, et… finalement, la fait assassiner !
Dans le même ordre d’idées, il est patent que les juges et les tribunaux eux aussi ont contribué au déploiement des actions répressives. Car il va sans dire que la Justice et les juges n’intervenaient absolument pas dans les affaires de la Gestapo, qui pouvait donc sévir sans rencontrer le moindre obstacle.
Comme l’a relevé Hannah Arendt dans son étude du Système totalitaire, les personnes victimes étaient privées de tout traitement juridique : et, ne faisant l’objet d’aucun jugement, elles n’avaient donc aucun recours. Elles se perdaient dans l’ombre d’où les policiers sortaient pour les frapper…Heydrich pensait - et il avait enrôlé des juristes pour tenter de le montrer - que l’arbitraire était une forme supérieure du droit. Ceci correspondait à l’idée de W. Best d’après qui chaque ordre du Führer, en vertu du Führerprinzip, le « principe du chef », était en soi une véritable loi. Un commandement absolu. Conséquence : dans un tel système, « l’ État et l’individu ne peuvent pas être considérés comme des sujets juridiques ; l’ État n’est pas une fin en soi mais le moyen de réaliser les aspirations du peuple allemand que le Führer connaît » (dit Höhne, L’ordre noir, idem, p. 117 ). Dans ces conditions, avec ou sans raison, un condamné libéré pouvait dès sa sortie de prison être envoyé dans un camp de concentration... Heydrich devenait seigneur et maître de la vie et de la liberté des citoyens…
On peut dire que les procureurs et les juges se sont trouvé en harmonie avec la Gestapo. Johnson prend l’exemple d’un délit politique simple (après tout mineur), l’écoute de la BBC. Ce délit pouvait conduire, soit à un renvoi devant le tribunal local qui décidait acquittement ou une peine légère, soit à une comparution devant le tribunal du peuple (Volksgerichtshof), où, comme à Berlin, la peine de mort était fréquemment prononcée… Bref tout ceci révèle non pas un État tout puissant en son sommet de décision, mais des pénétrations et des interactions avec la population et avec différentes corporations (les médecins par exemple). D’où aujourd’hui des études comme celles de Christopher Browning ou de Daniel Goldhagen (qu’il faut lire!)… Pour ma part, je serais tenté, en plus, de voir dans ces interactions le cours normal d’une guerre menée contre la société, étant entendu que, comme guerre, elle recherche et obtient, si elle dure comme guerre permanente, des regards extérieurs pour accentuer sa propre vigilance, qui semble ne jamais se relâcher. C’est même cette surveillance de tous par chacun qui définit la maîtrise - ou l’espoir d’une maîtrise totale, totalitaire l’on veut… Voilà donc comment, d’après Höhne, la Gestapo parvenait à surveiller et contrôler de nombreux secteurs de la société… afin de traquer, réprimer et éliminer toute voix discordante. Ceci était d’ailleurs conforme à ce qu’énonçait W. Best, le juriste, créateur de la police politique dans le Land de Hesse, et qui, pendant la guerre, fera partie de l’administration des troupes d’occupation en France (il est mort tranquillement, longtemps après la guerre, en 1989), en affirmant :
« Toute idée politique hostile au régime doit être considéré comme une forme de maladie qui met en péril la santé de ce grand organisme qu’est le peuple ». Cité par Höhne, L’ordre noir, op. cit., p. 112).
L’envoi dans des camps de concentration fut rapidement adopté comme la pratique de base de la Gestapo… Car (lle fut habilitée à incarcérer à titre préventif tout citoyen jugé dangereux, sans limite de durée (une clause arbitraire qui, dans ce genre de régime, est essentielle pour frapper les victimes). Ce sera le cas en 1935 et 36 de 7000 « marxistes ».
Remarque
Le camp de concentration, KZ, Konzentrationslager), qui est au centre de la conception policière des nazis, n’est pas du tout fondé sur la vision rééducatrice qui est propre aux camps communistes (avec et après Staline du reste). En affirmant cela, je ne veux évidemment pas suggérer que les camps staliniens sont moins affreux et excusables ! Disons que chez les nazis, le KZ est explicitement prévu pour inspirer la terreur. Par là s’expliquent la présence d’instruments de torture dans les camps de Dachau, Buchenwald et Sachshausen. Aux prisonniers arrivants à Auschwitz, le commandant du camp Karl Fritzsch put asséner : « Oubliez vos femmes, vos enfants, votre famille ; ici vous allez crever comme des chiens ».
Pour rester maître de ce dispositif, Himmler ne cédera pas à Heydrich le contrôle des camps. La mission d’administration générale des camps sera confiée à Theodor Eicke, le meurtrier de Röhm, qui était par ailleurs commandant du camp de Dachau depuis 1933. Et ce sont les SS Totenkopfverbande, ou TV, les « associations à tête de mort », qui constituèrent la troupe chargée concrètement, au jour le jour, de la surveillance des KZ. Heydrich tentera de discréditer Eicke, sans y parvenir.
2) Sur la Sicherheitspolizei, Sipo.
La Sipo était de même complexion agonistique que la Gestapo, à laquelle elle fut très étroitement liée – quoique plus en retrait par rapport à la SS.
Avant les nazis, Sicherheitspolizei désignait l’ensemble de la police. Cet organe comportait deux branches : la Verwaltungspolizei (exemple : la police de la route) et la Vollzugspolizei : soit la police criminelle, police politique, la gendarmerie, les forces de l’ordre. Mais dans la période nazie, tout change avec le décret du 17 juin 1936 , par lequel Himmler est nommé chef suprême de toutes les polices allemandes, les dites polices sont désormais du ressort du Reich et non plus des régions. Je cite à ce propos le texte que j’ai présenté en 2020 dans la séance 4 :
« devenue nationale socialiste, la police n’a plus pour mission d’assurer un ordre établi par un régime parlementaire et constitutionnel. Elle est là 1° pour faire exécuter la volonté d’un chef unique ; 2° pour préserver le peuple allemand contre toutes les tentatives de destruction…
C’est alors qu’Himmler fait de la Sipo, confiée à Heydrich, un organisme nouveau, rassemblant la police criminelle (la Kripo) et la police secrète, la Gestapo, moyennant quoi l’opposant politique est assimilé à un criminel.
La Gestapo est sous les ordres d’Henrich Müller et la Kripo sous les ordres d’Arthur Nebe. La Sipo s’appuie logiquement sur deux instances administrative : 1) la Gestapa (Geheime Staatspolizeiamt), que j’ai évoquée ci-dessus et 2) le Landeskriminalpolizeiamt, LKPA, direction de la police criminelle, qui devient en juillet 1937 Reichskriminalpolizeiamt, RKPA. Dirigé par Arthur Nebe ce dernier organe administre la police criminelle sur tout le territoire du Reich.
La Vollzugspolizei et la Verwaltungspolizei sont de leur côté fusionnées dans une police nouvelle dite Ordnungspolizei, Orpo, dont Kurt Daluege, autre SS (Obergruppenführer ou Général), est mis à la tête. C’est toujours Himmler qui coiffe le tout. L’Orpo réunit concrètement la Schutzpolizei (Schupo, police urbaine), la gendarmerie, et la police administrative, celle des voies d’eau, la côtière, la défense passive...
Dans ce cadre, la notion d’ennemi est très étendue ; elle en devient presque incertaine. Car l’idée de « criminalité » désigne en fin de compte trois groupes de sujets : a) les criminels condamnés au moins trois fois à au moins 6 mois ; b) les « asociaux » : mendiants, vagabonds, gitans, prostituées, homos, esprits critiques, ivrognes, pervers (sexe avec des Juifs), malades mentaux ; c) « ennemis du travail », qui sont des gens ayant refusé deux fois au moins, sans raison valable ( !?) ce qu’on leur propose.
Par ailleurs, si la Sipo fusionne Kripo et Gestapo sous la houlette de Heydrich, néanmoins, les centres Kripo régionaux d’un côté, relèvent bien de la police de sûreté et reçoivent donc leurs ordres du RKPA de Nebe ; mais d’un autre côté, sur le plan administratif, ils dépendent des préfectures de police régionales c’est-à-dire de préfets qui appartiennent à la direction de l’Orpo. Du coup, Heydrich fait nommer des Inspecteurs de la sûreté chargés de surveiller les préfets de police régionaux. Conséquence (à nouveau, j’entre dans la complexité pour qu’on saisisse les interventions incessantes des nazis, qui n’ont pas forcément un plan bien arrêté et créent ainsi un incroyable enchâssement de services et de hiérarchies bureaucratiques ) : les centres régionaux de Kripo ont deux têtes, d’une part les préfets et d’autre part les inspecteurs de la sûreté. Vous voyez la complexité, qui peut engendrer de fortes tensions entre les services et les hommes, et qui confine de ce fait au désordre permanent ? C’est en réalité un phénomène typique de la gestion hitlérienne des institutions. En plus, il faudrait ajouter à cela l’hostilité qui règne entre la Gestapa, dirigée par les bavarois de Heydrich, et le RKPA d’Arthur Nebe...
Au risque (assumé) de me répéter, je redis (cf. aussi cours 2020, séance 4) : quand Himmler regroupe l’ensemble des services de police, il divise le tout en deux branches. La première est l’Orpo, l’Ordnungspolizei, qui regroupe toutes les polices en uniforme ; et puis, la seconde branche est une nouveaauté , la Sipo, Sicherheitspolizei, police de sûreté, qui récupère tous les services d’enquête en civil, donc se fonde à la fois sur la Kripo (politique criminelle – l’équivalent de notre PJ) et sur la Gestapo. Et c’est alors qu’Himmler nomme à la tête de la Sipo toujours le même, Reinhard Heydrich. Retenez surtout l’essentiel à savoir que la Sipo couvre la Gestapo, même si, dans les faits, Sipo et Gestapo sont deux polices politiques, autonomes, qui ne rendent pas de comptes à l’extérieur d’elles-mêmes.
Voici un exemple de ce qui pouvait se passer…Concrètement, à quelles types d’activité ces polices se livraient-elles ? En voici la teneur. Le 27 janvier 1937, le Landeskrimilapolizeiamt LKPA de Prusse, qui est la centrale de la police criminelle allemande, envoie à tous les services régionaux de la Kripo l’ordre de mettre en fiche les individus dangereux, qu’il faut capturer. Ensuite, le 23 février, on programme l’action correspondante, et enfin le 9 mars, sur tout le territoire, 2000 hommes sont incarcérés « à titre préventif » dans quatre camps de concentration : Sachsenhausen, Sachsenburg, Lichtenburg et Dachau. L’opération se veut non politique : il s’agit de prévention du crime. Ce faisant, il est clair que l’opération se dispense purement et simplement des tribunaux, ou du moins qu’elle n’en appelle à aucune procédure judiciaire. En réalité, l’article 42 du Code pénal du Reich autorise à procéder à de telles arrestations. C’est même ce que tente de justifier W. Best en affirmant qu’il y a une sorte d’harmonie des organes du peuple, quand la police agit et que le criminel accepte cette incarcération. Dans ce cas, le peuple… comme dit M. Broszat, c’est une sorte de potager dont on retire régulièrement les mauvaises herbes (jolie métaphore, pour dire la guerre à la société civile).
 votre commentaire
votre commentaire
-
-
Par fjf le 23 Novembre 2021 à 20:41
Séance 12
INSTITUTIONS ET MILICES DE LA GUERRE NAZIE (5)
Pour le dernier envoi de cette année, je termine le tour d’horizon par lequel je voulais définir et situer les principales instances nazies (polices, organes d’espionnage et de sécurité, milices et autres groupements agonistiques) ayant été consacrées à la guerre contre la population allemande et les groupes ou personnes inassimilables par la « communauté raciale populaire » des Allemands (la Volksgemeinschaft). Voici donc quelques points de repère d’abord sur le SD, le Sicherheitsdienst, le Service de « sécurité » (ou « sûreté ») (…) du parti nazi, ensuite sur le RSHA, le Reichssicherheitshauptamt, Office central de la sécurité du Reich. Je poursuivrai plus tard par les Einsatzgruppen, les équipes spéciales autrement nommées par Raul Hilberg les « équipes mobiles de tuerie » (dans La destruction des Juifs d’Europe…, op. cit.), ce qui nous fera entrer dans le dur le plus sordide des pratiques nazies génocidaires.
Je rappelle un élément de contexte essentiel : quand Himmler est nommé chef de la police d’État pour tout le Reich, en 1936, il fusionne la police d’État avec les SS. Les SS entrent dans la police et les fonctionnaires de police sont admis dans la SS - sauf les policiers sans qualification. Alors les camps de concentration passent sous le contrôle des SS, tandis que la Gestapo, dominée par les SS, se développe dans toute l’Allemagne (même avec des effectifs réduits).
Après l’arrivée au pouvoir d’Hitler, Himmler est devenu préfet de police à Munich et il a placé Heydrich à la tête de la section politique de cette préfecture. Puis Himmler est nommé responsable politique au ministère bavarois de l’Intérieur (toujours le Land où se trouve Munich : la Bavière. Il y a 16 Länderpolizeien en tout) et chef de la police politique. Il est alors secondé et représenté par Heydrich. A ce moment, le nombre de prisonniers envoyés à Dachau ne cesse d’augmenter ! Himmler et Heydrich vont ensuite étendre à toute l’Allemagne le système mis en place par eux en Bavière.
1) Voici maintenant l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur le SD (je rappelle par la même occasion ce que j’ai déjà eu l’occasion d’exposer, notamment en 2020, séance 4).
A) J’ai indiqué que le SD, émanation du Parti nazi, a été conçu en 1931 par Heydrich comme un service de renseignement SS. Le SD a mission fondamentale de repérer et éliminer les informateurs autrement dit les ennemis introduits dans ce Parti, ceux qui seront plus globalement définis comme les « ennemis de l’État ». Ensuite, le SD, qui aura été un des acteurs de la « Nuit des longs couteaux » (l’élimination physique des principaux chefs de la SA, le 30 juin 1934), deviendra l’« organisation politique de défense de la Gestapo ». C’est dire le lien très étroit du SD et de la Gestapo, les deux grands piliers de la terreur nazie… C’est ce qu’il faut retenir. Lors de la guerre, le SD aura surtout une activité de contre-espionnage, pour débusquer et réprimer les actes anti-nazis et les menées anti-allemandes dans tout le Reich et à l’étranger quand le problème se posera, dans les territoires occupés.
Selon S. Friedländer (L’Allemagne nazie et les Juifs…, t 1, op. cit., p. 199), pour comprendre ce phénomène policier, il faut d’abord saisir le rôle fondamental du décret du 17 juin 1936 qui place Himmler à la tête de toutes les forces de police allemandes. Pourquoi ? Parce que, je viens de le rappeler en parlant d’une « émanation du Parti nazi », ce décret fait de cette police un organe qui ne relève plus de l’autorité de l’État Très peu de temps après d’ailleurs, le 26 juin, Himmler sépare deux commandements : il y aura d’un côté la police de l’ordre (Ordnungspolizei) avec toutes les polices en uniforme, dirigée par Kurt Daluege, et d’un autre côté la police de sécurité (la Sicherheitspolizei ou Sipo) qui comprend la police criminelle ou Kripo ainsi que la Gestapo, dirigée par Heydrich . Le SD devient donc le service de sécurité de la SS. En principe les forces de police relèvent du ministre de l’Intérieur, et à ce moment Himmler est encore sous l’autorité de ce ministre, Wilhelm Frick.
Pour Heydrich la police s’étend à toutes les manifestations de la vie des gens et de la nation allemande (ce qui confirme le bien-fondé de mon hypothèse d’après laquelle les nazis inquiètent la totalité de la société allemande). La police, dans cette perspective a une sorte de dimension éducative, de prévention et de lutte contre les idées néfastes. D’où sa qualification de police... « secrète ».
Tout ceci caractérise par conséquent très bien le SD comme un service permettant de repérer et de déjouer des ennemis, d’abord les agents infiltrés dans le Parti - lesquels furent d’ailleurs les premiers à être envoyés dans le camp de Dachau dès sa création en 1933 (camp que va diriger Theodor Eicke, futur Inspecteur général des camps de concentration). Constituée dans ce sens, la police politique ne pouvait plus s’assujettir aux lois ordinaires de la cité… Au début, le SD avait aussi pour mission de recueillir des informations sur les dirigeants nazis ; ensuite, comme relevant de la SS, il devint le centre de renseignement de la Gestapo (« organisation politique de défense de la Gestapo » dit Himmler en juillet 1934). Finalement, en 1939, la SS et les différentes polices furent regroupées dans le RSHA (dont je vais très bientôt parler). C’est à ce moment que les nazis et les SS, qui contrôlaient déjà toutes les forces de police, créèrent la police de sûreté, la Sicherheitspolizei dite Sipo, en regroupant la traditionnelle Kripo (politique criminelle) avec la nouvelle Gestapo (ensuite, en 1939, avec la création du RSHA Sipo et SD fusionneront à leur tour, pour engendrer le Sipo-SD ; et alors, puisque Heydrich conservera la direction du SD, il sera donc « chef de la SIPO et du SD » (cf. J. Delarue, Histoire de la Gestapo, op. cit., p. 247).
Après l’accès au pouvoir en 1933, il devient évident que le SD n’a plus tellement besoin de s’intéresser aux autres partis (qui vont disparaître). En conséquence, le SD fonctionne comme une sorte de police d’appoint (dit H. Höhne, L’ordre noir, op. cit., p. 125). Cependant, les dirigeants du SD étant en réalité peu enclins à servir seulement de force d’appoint à la Gestapo. Or c’est ce qui va leur réussir : on verra alors les informations affluer à leur siège. L’ombre du SD sera présente un peu partout (dit H. Höhen, idem, p. 126). Bref, le 4 juillet 1934, Himmler définit le SD en tant qu’ « organisation politique de défense de la Gestapo » ; et six mois plus tard, Himmler donne pour objectif au SD de démasquer « les adversaires de l’idée nationale-socialiste », ce qui, poursuit Himmler, demande que le SD oriente l’action de la police (qui conserve le côté exécutif de la répression, par différence avec le renseignement).
Vous voyez la toile se tisser ?
Au début de son existence, le SD, comportait quelques dizaines d’hommes seulement ; mais en 1939 il aura un effectif beaucoup plus important, ayant à sa solde des milliers d’espions et des dizaines de milliers d’informateurs. Dès 1937 il comporte 3000 membres et 50 000 informateurs. Pour ce service travaillent alors de nombreux agents, tandis qu’on cherche à recruter des instituteurs, des vétérinaires et fonctionnaires à la retraite, des propriétaires terriens. On recourt aussi à des juges, des entrepreneurs, des artistes, des savants… Par exemple, en 1938, la section SD de Coblence comporte 24 bénévoles parmi lesquels 4 universitaires, 8 fonctionnaires dont 4 de police, 1 médecin, 1 instituteur, 1 vétérinaire.
J’ai aussi parlé de la structure institutionnelle du SD (cf. Serge Klarsfeld, Le calendrier de la persécution des Juifs en France, 1940-1944, Paris, éditions des FFDJF, 1993 ; ainsi que H. Höhne, L’ordre noir..., op. cit., le chapitre VII ; et aussi Fabrizio Calvi et Marc J. Masurovsky, Le festin du Reich, Le pillage de la France occupée, 1940-1945, Paris, Fayard, 2006). J’ai indiqué que l’Office central, le SD-Hauptamt, fut divisé en sections centrales, des Zentralabteilungen. La section I 3 surveillait la presse et de l’édition ; la section I 3 1 s’intéressait plus spécialement à la presse écrite ; la section I 3 2 constituait une bibliothèque relative à la franc-maçonnerie, à la sorcellerie et à la magie noire. Quant à la section II 1, elle était une officine de renseignements sur les ennemis politiques et idéologiques du Reich. Ces précisions doivent faire apparaître non pas seulement le déploiement d’une bureaucratie complexe, mais aussi, dans cette perspective, la volonté nazie de quadriller la totalité de l’espace culturel et idéologique du territoire surveillé, aussi bien Allemand qu’européen, sans rien laisser au hasard,...
En 1937 Le « docteur » Franz Six, 29 ans, professeur, est chef de la section II 1 ; ensuite il dirigera le bureau central ou II 2. A ce moment, le bureau II-1 1 est dirigé par Helmut Knochen, âgé de 27 ans, lui-même ayant sous ses ordres Herbert Hagen, âgé de 24 ans, plus particulièrement chargé de diriger le bureau II-1 1 2, dédié aux « affaires juives ». Hagen, qu’on verra en France avec ses supérieurs (en partticulier le redoutable Kurt Lischka), étudie c’est-à-dire se renseigne sur les activités des organisations juives sionistes ou assimilatrices en Allemagne ou à l’étranger. En Allemagne, à Berlin, sous les ordres de Hagen, le SD anime encore deux sous sections : l’une, dirigée par Dannecker, se charge des Juifs assimilés, et l’autre, confiée à Eichmann, est chargée d’étudier de près le sionisme (raison pour laquelle Eichmann et Hagen se rendront en Palestine en 1937 pour parfaire leur connaissance dans ces domaines). Quadrillage policier, encore une fois : surveillance et contrôle de la vie mentale des populations. A Paris, Dannecker, exécutant zélé de la pratique anti-juive, sera le maître intraitable du camp de Drancy, organisant les déportations du printemps 1942...
En France, pendant l’Occupation, je l’ai dit (cf. cours 2020 séance 4), on a la plupart du temps parlé des activités de la Gestapo ; mais en réalité, la terreur qui s’abattait sur les Résistants et les Juifs provenait aussi bien du SD…
B) A l’origine, en 1931, Hitler demanda à Himmler d’organiser dans la SS un service de renseignement, c’est-à-dire d’espionnage, donc un service chargé de la sécurité sur le modèle de ce qui existait déjà dans la SA (je redis en outre qu’en 1936, Himmler, Reichsführer, c’est-à-dire presque maréchal, est à la fois le chef des SS et le le chef de la police). C’est donc la mission confiée à Reinhard Heydrich. Ce dernier avait été officier dans la marine ; il avait déjà une compétence dans le domaine de l’espionnage et il venait d’être congédié de la marine de guerre pour une faute commise contre le code d’honneur (de quoi s’agissait-il ? Je n’ai pas trouvé la réponse à cette question...).
Heydrich a rencontré Himmler en juin 1931, et il a été intégré à l’état major SS le 5 octobre, comme Sturmführer, pour créer ce service d’information, le SD, qui devait être et sera bel et bien opérationnel sur tout le territoire. Après voir été en fonction dans la marine, Heydrich entre donc en fonction auprès d’Himmler et dans la SS le 1er octobre 1931, d’abord à un grade modeste, puis à des grades de plus en plus élevés, jusqu’à être nommé Oberführer SS, général, en mars 1933). Je rappelle également que c’est son prénom, Reinhard, qui devint le nom de code de la destruction des Juifs polonais (Aktion Reinhard), car Heydrich avait été exécuté (quoique difficilement), par deux hommes de la Résistance Tchèque, et il était mort des suites de ses blessures le 4 juin 1942, à Prague.
Pour comprendre le contexte institutionnel de ces transformations et leur évolution, il faut aussi tenir compte des conflits existant à l’intérieur de la sphère nazie, après la prise du pouvoir (je suis ici l’analyse d’H. Höhne, dans L’ordre noir…, op. cit.). A ce moment, l’élite dirigeante du Parti s’empare des postes désormais accessibles dans l’État, tandis que les petits chefs des provinces piaffent, si j’ose dire, et entrent en rivalité. C’est alors que le Parti demande au SD de déjouer les intrigues locales, moyennant quoi, en juin 1934, Rudolf Hess proclame que le SD est désormais le seul service officiel d’information du Parti nazi. En fait, dans cette période, le SD devient le lieu où se côtoient des intellectuels gagnés à la cause du national-socialisme, mais qui veulent infléchir cette politique. Contre l’esprit de la République de Weimar, ils rêvent d’un « État -dieu » auquel tous les sacrifices seraient dus et à la tête duquel régnerait un homme exceptionnel. Et ces jeunes nazis entendent bien prendre l’ascendant sur les vieux du Parti ; c’est la raison pour laquelle ils considèrent le SD comme une intéressante opportunité (et s’ils sont antisémites c’est aussi parce qu’ils sont hostiles aux trusts et aux banques - qu’ils assimilent aux Juifs). Exemple : Otto Ohlendorf, né en 1907, qui a adhéré en 1925, puis, alors qu’il est professeur à l’institut d’économie mondiale de Kiel, s’est opposé aux doctrines d’inspiration collectiviste qui ont droit de cité dans le Parti (on le trouvera à la tête d’un Einsatzgruppe lors de l’invasion de l’URSS). Après lui, à sa suite, entrent au SD des hommes comme Gunther d’Alquen, Walther Schellenberg, docteur en droit et en sciences politiques, et Hermann Behrends, docteur en droit. Avec eux Heydrich a sous la main des gens qui s’affranchissent de la tradition administrative prussienne qui règne à la Gestapo. Or, à l’inverse, Werner Best défend cette tradition, si bien qu’il s’oppose à Heydrich, moyennant quoi ce dernier trouve la solution de scinder le SD en deux, avec : 1) un axe de formation du Parti dans lequel tous les fonctionnaires de la SIPO seront intégrés, et ce sera l’outil d’intégration de toute la SIPO à la SS ; et 2) le service de renseignement, conçu comme un organe capable de s’immiscer dans tous les recoins de la société, chez le partisan comme chez l’opposant (ceci explique l’hostilité de Best quand le SD se mêlera des affaires de la Gestapo).
Pour voie une idée concrète des pratiques ordinaires des espions du SD, voici quelques exemples (toujours cités par H. Höhne). D’abord un rapport du SD n° 037 sur la région de Cologne, où est notée la situation délicate du national-socialisme à cause de l’Église catholique, qui est influente. Autre exemple, un rapport de l’Obersturmführer SS Grillenberger du 26 janvier 1938 . Ce SS a surveillé le « Retour d’Italie du paquebot Der Deutsche », et il a noté que « Le passager Frtitz Schwanebeck, né le 30 mars 1901, demeurant à Muckenberg, a manifesté par son attitude et sa tenue négligée la plus parfaite indifférence lorsque l’Hymne national a retentit ». Et encore ceci, très significatif : lors des élections de 1938, on a mis des chiffres invisibles avec des machines à écrire sans ruban sur les bulletins envoyés, et après le vote, on a donc pu faire apparaître les chiffres en passant du lait écrémé. Il était même possible d’identifier la personne à partir des numéros des listes électorales…
Bien sûr, les hommes du SD s’occupent aussi de voir si certains nazis n’auraient pas des ascendances juives...
Voir Szymon Datner, Janusz Gumkowski et Kazimierz Leszczynski, Le génocide nazi 1939-1945, éditions : WYDAWNICTWO ZACHODNIE, Warszawa – Poznan, 1962. Un livre (j’y reviendrai) qui montre l’implication du SD dans la constitution et les activités des équipes de tueurs - en Pologne dans ce cas.
L’action de propagande fut confiée à Gunther d’Alquen, l’ancien rédacteur du journal Der Angriff, à Berlin, qui avait été évincé, mais que l’on retrouve à la tête du Bulletin SS, Das Schwarze Korps, (journal des Schutzstaffeln du NSDAP, « organe de la Reichsführung SS » : 1ère parution, le 6 mars 1935, avec 40 000 exemplaires ; mais 500 000 1937, et 750 000 pendant la guerre. Cette feuille passe à l’époque pour être une sorte de journal d’opposition, si l’on peut dire, car les auteurs se consacrent à une critique de la bourgeoisie, des Juifs, de l’Église, contre lesquels ils prononcent des réquisitoires. De ce fait certaines personnalités sont accusées, par exemple, de corruption. Ce journal, qui semble avoir séduit de nombreux Allemands, avait accès a tous les dossiers du SD (mais un SS comme Ohlendorf va ensuite entrer en conflit avec cette publication et il va dénoncer des faits rapportés qu’il estime erronés, voire fallacieux…).
2) le RSHA.
Le RSHA est créé par la fusion de la Sipo et du SD (qui relève du parti nazi, je le répète). On a alors un Sipo-SD (et c’est lui qui sera actif notamment contre les Juifs dans les pays occupés). H. Höhne, toujours dans L’ordre noir, op. cit (p. 129), souligne le fait que les deux organismes, Gestapo et SD, avaient les mêmes missions et le même un désir d’expansion à tout le territoire. A cause de cette similitude, ils pouvaient donc se paralyser ; et c’est précisément la situation que le RSHA entreprenait de surmonter. Cela étant, plusieurs historiens ont remarqué que la concurrence était typique de l’organisation politique et institutionnelle nazie, parfois totalement confuse à cause de cela.
Résumons. Créé le 27 septembre 1939, donc dès le déclenchement de la guerre, le RSHA, nommé parfois « ministère de la terreur », regroupait sous la houlette de Heydrich différents service de police et d’espionnage (cf. Henri Michel, Paris allemand, Paris, Albin Michel, 1981, p. 74). Toujours sous la direction de la SS.
A nouveau, je rappelle quelques acquis sur ce sujet. (cf. la séance 11 de cette année). Associer les police et la SS pour en faire un seul organe de sécurité, c’était un but essentiel d’Himmler et Göring. Avant cela, je l’ai dit, il y a déjà eu des regroupements. Notamment, la SIPO a rassemblé la Gestapo et la Kripo ; et le service de l’Ordnungspolizei, l’Orpo, a rassemblé la Schutzpolizei ou Schupo, la gendarmerie et la police communale – le tout placé sous les ordres de Daluege, Obergruppenführer SS et général de la police.
En 1939, lors de sa création, le RSHA, qui regroupe donc tous les services de police, comporte 7 sections ou bureaux, des ämter (pluriel de Amt). Ces 7 divisions sont les suivantes : Amt I : personnel ; Amt II : administration et économie, donc qui gère les fonds, avec pour directeur Joseph Spacil ; Amt III : SD Inland, Reich und Volk Deustchen (Allemands de souche), direction Otto Ohlendorf (le revoilà) ; Amt IV : Gestapo, dirigée par Henrich Müller ; Amt V : Kripo ; Amt VI : SD Ausland (espionnage politique à l’extérieur du Reich) dirigé en 1941 par Walter Schellenberg ; Amt VII : documentation et conception du monde. Ceci vaut pour l’appareil central à Berlin - alors que dans les régions le RSHA se divise en fonction des types de secteurs auxquels il est affecté : il y en a trois : celui du Reich, celui des territoires occupés, et celui des zones envahies où œuvrent les tueurs des Einsatzgruppen.
Dans cette nouvelle structure se retrouvent les mêmes responsables SS que nous avons déjà rencontrés : dans le département VI, pour les renseignements à l’étranger, Hagen se consacre au VI-N (judaïsme et antisémitisme). Ce qui était le II-B-4, service des affaires juives de la Gestapo, devient le IV-B-4 et est le service que va diriger Eichmann et non plus Lischka et où Dannecker sera intégré de fin septembre à fin décembre. C’est dans ce cadre que Dannecker se rendra en Pologne, afin de donner corps au projet de réserve juive (c’est-à-dire de déportation des Juifs) de Nisko, près de Lublin.
Le RSHA est dirigé par Heydrich, puis Kaltenbrunner, et les fonctionnaires de l’ancienne police sont intégrés dans les SS. Comme dit au total H. Michel (Paris allemand, op. cit., p. 75), le RSHA, fur « la plus formidable concentration policière jamais instituée » En dehors, il ne reste que les unités de renseignement et de sécurité de l’armée. Certes, mais au sens d’un organe militaro-sectaire, comme je le suggère.
Une rapide et provisoire conclusion :
Qu’est-ce que je veux montrer en évoquant ces instances de guerre contre la population allemande ? Ceci que j’ai amorcé en introduction : si tout État est créateur de la citoyenneté, au contraire, l’État nazi (ce qu’il en reste, je le redis) commence par priver de citoyenneté une partie de sa population - les Juifs et bien d’autres (les socialistes, les communistes, les homosexuels, les marginaux et les « indésirables », etc. : donc des groupes désignés comme étant a priori hostiles, ennemis potentiels et actuels). Comment ceci s’opère-t-il ? Par le moyen de la répression d’une part, mais aussi par des moyens légaux, dès lors que les lois mettent en avant un critère racial indispensable pour bénéficier de la citoyenneté… (d’où les « lois de Nuremberg », de 1935). J’irai même plus loin en posant que là réside une véritable négation de toute politique démocratique, négation qui s’effectue au profit du crime. Logiquement, comme H. Arendt à pu l’établir, le nazisme ne pouvait que déboucher sur l’instauration d’un droit de tuer…
Il est vrai qu’une grande partie de la population allemande n’était pas visée… mais à la condition que les personnes concernées soient bien conformes à ce qui était attendu de l’Allemand moyen, le bon aryen, le Volkdeutsch (Allemand de souche), ou Treuedeutsch (Allemand fidèle), etc., comme il est répandu par la propagande et inculqué dans les écoles. Mais ceci n’était pas valable pour les populations des pays conquis. Comme le note I. Kershaw (La fin : Allemagne, 1944-1945, Paris, Seuil, 2012, p. 276) : avec la guerre, la répression touche les populations conquises, mais aussi, de plus en plus, à l’intérieur, les gens qui montrent les moindres signes de non conformisme. Est donc instauré un climat de terreur. Résultat (idem, p. 277) : « Le régime devenait de plus en plus dangereux pour ses propres citoyens ».
Même avant la guerre, on en a un exemple avec les jeunes gens hostiles à l’embrigadement, notamment dans la Hitlerjugend. Je pense notamment aux Swingkids, ceux qui ont montré leur opposition en se réclamant du jazz (musique américaine honnie par les nazis car jugée « décadente »). Ces jeunes gens ont adopté des styles vestimentaires, des attitudes physiques, etc., opposés à la discipline des Hitlerjugend. C’est eux qui rythmaient sur un air de swing « treuedeutsch, treuedeutsch, treuedeutsch »)… Mais… ils ont, fini par être envoyés dans des camps spéciaux comme celui de Moringen, pour « haute trahison ».
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par fjf le 23 Novembre 2021 à 20:52
Ce livre vient d'être publié par les éditions Transmettre, à Tours.
(en cliquant sur l'image, elle apparaîtra dans le sens vertical)
Avant plus ample examen, je vous demande de bien prendre en compte l'uniforme de ce jeune homme : c'est un uniforme militaire français. Michel Bucsbaum, né en France, titulaire du Certificat d'études, a été mobilisé, en tant que Français, en septembre 1940... Puis, en 1942, il a été déporté et assassiné comme tant d'autres Juifs - des Français comme lui...
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par fjf le 3 Avril 2022 à 13:08
Au sujet du livre évoqué dans le dernier envoi de 2021, une émission avec Claude Bochurberg (le 16 février 2022).
Le podcast devrait être facilement accessible (je ne parviens pas à l'envoyer ici!) en recherchant Radio Shalom et l'émission "Mémoire et vigilance" du 16 février.
Ce qui me donne l'occasion de dire ma gratitude à C. Bochurberg
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par fjf le 27 Avril 2022 à 08:16
séance 1
INSTITUTIONS ET MILICES DE LA GUERRE NAZIE
(Suite 6) Lois de la violence nazie
Avant de reprendre mon exposé, je signale un document de l’INA relatif au procès d’Auschwitz (Francfort, 1963-65) qui montre d’anciens interviews tout à fait intéressants, en particulier celui de Germaine Tillon, déportée à Ravensbrück. Intéressants justement parce qu’ils sont assez anciens maintenant. Bouleversants et très pudiques à la fois.
Au passage, soyez sensibles à la qualité du langage des personnes interviewés et de l’homme (je ne sais pas qui), qui les interroge.
https://www.youtube.com/watch?v=GYS9AMzLhyI
Aujourd’hui je voudrais développer et compléter un peu mes analyses des phénomènes de violence enclenchés, en Allemagne d’abord, par les nazis.
Je rappelle que mon projet consiste à analyser la fureur nazie, en particulier la fureur antisémite. Pour ce faire, j’ai adopté une hypothèse de description (cf. 2021 séance 12, conclusion). Cette hypothèse suggère qu’il y a de la part des nazis, en direction de la société allemande et plus largement des sociétés européennes, non pas tant une politique qu’une guerre - et en l’occurrence une guerre raciale. Cette guerre (civile) consiste dans un ensemble d’action de contrôle et de sélection d’une part, et ensuite, d’autre part, des actions d’extermination des fractions de la population que la sélection a considéré impossibles à intégrer à la « communauté raciale populaire », la Volksgemeinschaft.
1)
J’ai évoqué à la fin de l’an passé les principales instances de combat nazies, les structures agonistiques que furent la SS, la Gestapo, la Sipo, le SD, le RuSHA… Je vais bientôt en venir aux Einsatzgruppen, les « équipes spéciales » (« équipes mobiles de tuerie » disait Raoul Hilberg), qui furent les groupes de tueurs envoyés dans les territoires conquis ou en voie de l’être avec mission de liquider toute personnes susceptible (donc seulement soupçonnée) de vouloir s’opposer à l’armée allemande, à commencer, bien évidemment, par les Juifs, ainsi que les responsables politiques du parti communiste d’Union soviétique. Bilan, environ 1,5 millions de meurtres ! Depuis longtemps, on appelle ce système d’assassinats « la Shoah par balles ». L’abbé Patrick Desjeux, qui a récemment enquêté sur ces meurtres, a repris cette expression et en a fixé le sens dans la mémoire collective.
Dans un premier temps, j’ai donc voulu présenter les moyens utilisés par les nazis pour effectuer ces opérations de tri - dont je redis que ce sont des actions de guerre, puisque cherchant à éliminer les groupes concernés. Je souligne que cette guerre est menée par des instances policières et militaires, notamment la SS (qui s’associent parfois des supplétifs civils, comme purent le faire les chefs des Einsatzgruppen après qu’ait commencé l’invasion de l’Union soviétique). J’insiste en ce sens sur un fait capital, à savoir qu’en 1936 Himmler est nommé « chef de toutes les polices allemandes », si bien que lui et la SS prennent le contrôle de ces polices. Ensuite, Police criminelle et Police politique vont être réunies dans la SIPO, qui devient le moyen essentiel de la guerre menée contre la société. Autre événement significatif : le 1er septembre 1939, en même temps que commence la guerre contre la Pologne, le Sicherheitsdienst, SD (service de sécurité, primitivement consacré au renseignement à l’intérieur du Parti nazi) et la police de sûreté sont finalement regroupés dans le RSHA, le « ministère de la terreur ». Et à dater de là, sous le motif de la sûreté (ou sécurité) de l’Etat, c’est en fait la sûreté d’une grande partie des citoyens allemands qui vole en éclats. Même ceux qui, parmi ces personnes, sont et se ressentent en sécurité à un moment donné, peuvent devenir le moment d’après suspects donc menacés s’ils dévient de la ligne officielle (cf. par exemple, les personnes accusées de défaitisme : elles furent exécutées, fusillées, pendant et surtout vers la fin de la guerre)...
Après la guerre de 14, en Allemagne, l’activité politique des partis comporte une dimension d’attaque et de défense contre les autres partis. Les nationalistes contre les communistes, les sociaux-démocrates, etc., et tout cela se traduit par des combats de rue sauvages, sanglants. On peut aussi penser aux Corps francs, mobilisés lors de la révolution de 1918 et 1919 pour s’opposer aux tentatives communistes (spartakistes) de prise du pouvoir ; on peut aussi penser au putsch manqué d’Hitler à Munich en 1923, etc. A Nuremberg, en 1946, Göring évoque d’ailleurs les « troupes de combat » dont disposaient les grands partis… Le niveau de violence dans la société allemande entre 1920 et 1939 est une donnée très importante pour expliquer les passages à l’acte antisémites, et ce niveau est très haut…
Mais si le niveau de violence est très élevé dans la société allemande dès la fin de la guerre de 1914-18 , on peut toujours trouver qu’il en allait de même dans les anciennes sociétés. Voir l’exemple des collèges d’Ancien Régime dont j’ai traité jadis, où certains élèves venaient en classe armés de leur épée et prêts à dégainer, y compris contre leur maîtres… Cette éventuelle similarité est cependant assez fausse. Donc, à la question : qu’a de spécial l’époque pré-nazie et nazie ? on doit répondre : c’est une autre pratique de la violence , car il s’agit d’une violence organisée contre les pratiques démocratiques de la délibération et de l’échange d’arguments. L’organisation de cette violence est le courant pratique fondamental du nazisme qui réunit des groupes militarisés lesquels, d’après leur loi, agissent en groupe. Je parle ainsi, en accord avec M. Aycard et P. Vallaud (Allemagne, Troisième Reich, op. cit., p. 83) d’un « esprit soldatesque » qui a, parmi ses origines évidentes, la camaraderie dans les tranchées de 14-18, le Fronterlebnis, l’expérience du front. C’est sur cet esprit qu’est basé non seulement le succès des formations paramilitaires (S.A., etc.), mais aussi je l’ai assez évoqué, celui des mouvements de jeunesse.
Remarque
Un mot sur l’idée weberienne bien connue d’un monopole étatique de la violence légitime. C’est l’idée, d’une part, de la réduction maximale de la violence dans la société, et d’autre part, surtout, d’après le mot « légitime », l’idée d’un usage limitatif, par l’Etat, de la violence, pourvu que cet usage s’oppose aux actes de violence meurtrière pouvant avoir lieu dans la société. Partant de ces définitions, il est facile de constater que les nazis ont agi en sens contraire en dotant l’État d’une fonction violente et meurtrière ayant pour but, en plus, de rouvrir un circuit de violence en lieu et place de la politique.
Au cœur du nazisme, dans ce qu’il y a de plus concret, sensible, donc observable indépendamment de toute catégorie politique, il y a donc des pratiques de combat. Au risque de me répéter, je dirai que les nazis ont essentiellement le désir d’user de moyens violents avec le meurtre pour finalité. Les SA sont formés à ces pratiques (ceci figure dans l’acte d’accusation des nazis au procès de Nuremberg), c’est leur vocation. Dès l’origine du mouvement, dans les années 1920, les milices nazies ont pour tâche de tenir le haut du pavé dans les rues et les meetings, de façon brutale, sans lésiner sur les moyens violents (cf. C. Bernadac, La montée du nazisme…, op. cit., p. 104. Ceci est également mentionné par Ph. Burrin (Ressentiment…, op. cit., p. 68), qui parle d’une « radicalisation » à partir de 1939. Pour ma part, je ne pense pas qu’il faille situer ces pratiques de violences dans le seul contexte de la guerre déclenchée en 1939). Je précise à ce propos que la guerre et l’expérience de la mort de masse, la « brutalisation » comme dit G. Mosse, augmentent la familiarité avec le meurtre (le fait de tuer est dépourvu de toute culpabilité et au contraire on entoure le meurtre d’un fort sentiment de légitimité), mais ne l’expliquent pas à elles seules. Je n’en dirai pas plus sur ce point ; car c’est ce que je tente de montrer dans un essai - encore inédit- intitulé Violences et meurtres de masse. Le nazisme dans l’histoire des violences collectives). Retenez juste que la différence entre France et Allemagne doit être prise en compte de telle sorte qu’on ne néglige pas le fait que la haine des vainqueurs est retombée avec la victoire, alors que c’est l’inverse pour les vaincus, qui ne peuvent que régurgiter indéfiniment leur haine de ceux qui les ont défaits...
2)
Associé à l’action violente de ces groupes militarisés, il y a en plus le fait que cette action s’effectue sans aucun contrôle légal, ou s’effectue indépendamment d’un contrôle juridique comme celui qu’aurait pu effectuer une instance judiciaire. En réalité, les pratiques nazies de violence créent un conflit avec la justice et le droit, et l’emportent sur ces derniers. Il y a d’ailleurs pendant toute cette période des exemples nombreux et marquants de victoire du « militaire » (au sens large) sur le juridiciaire. Exemple : le jeune communiste massacré par 9 SA à coups de pied, lesquels SA, seront finalement graciés... après avoir été condamnés à mort… Ce genre de combat létal survient à l’occasion des campagnes électorales de 1932, entre la présidentielle de mars et avril, où Hitler arrive deuxième derrière Hindenburg, et la campagne du 31 juillet, les élections au Reichstag. Dans cette période, les combats de rue font des dizaines de morts (une centaine rien qu’en Prusse). Les SA et les SS, d’abord interdits, sont de nouveaux autorisés ; et en l’occurrence, si les SA inculpés sont soumis à un procès puis condamnés à mort (une loi avait été votée en ce sens), ne passant au total que quelques mois en prison, c’est Hitler qui parviendra à les faire gracier. Ainsi est progressivement instauré un véritable droit de tuer, ce qui serait, comme disait H. Arendt, le « nœud moral » du nazisme (cf. La nature du totalitarisme…, op cit., p. 73).
Bref, la justice allemande s’est peu à peu pliée aux nouvelles exigences nazies. Ceci répondait du reste à un véritable plan, comme on le constate à lire le Journal de Göbbels, qui, à la date du 18 mars 42, restitue ainsi un raisonnement du Führer : « La justice ne doit pas régir la vie de l’Etat ; elle doit servir la politique de l’Etat ». A quoi Göbbels ajoute ce commentaire assez révélateur de l’asservissement progressif de la justice au profit de la seule décision du Chef (omniscient et infaillible) :
« Pour pouvoir intervenir dans tous les secteurs de la vie civile et militaire, le Führer aimerait se faire donner des pleins pouvoirs spéciaux par le Reichstag, afin que les fauteurs de troubles sachent qu’il est couvert à tous égards par la volonté populaire. Il a donc l’intention de convoquer sous peu le Reichstag afin d’en obtenir des pouvoirs illimités lui permettant d’agir contre les saboteurs et surtout contre tous ceux qui, occupant des fonctions publiques, négligent les devoirs de leur charge. » (Le journal du docteur Goebbels, Paris, 1949, p. 118).
La violence dont je parle (à commencer par celle qu’exige le Führer de la part de ses troupes) a donc ceci de très particulier, qui pourrait par ailleurs justifier la notion de « totalitarisme », qu’elle entraîne une mise à l’écart du droit et la création d’un droit nouveau.
3)
Une autre caractéristique essentielle des pratiques nazies de violence c’est que d’un côté elles se produisent au nom du Volk, peuple et race, qui sont un support symbolique et réel de l’action violente systématique et permanente, cependant que d’un autre côté elles se dressent aussi bien devant les citoyens, quels qu’ils soient. C’est pourquoi Ernst Nolte, tenant compte de cette division essentielle, a parlé d’une guerre civile. A ce titre, on peut également parler d’un système (étatique) de terreur.
Sur le plan pratique, un tel système fonctionne quand la violence, exercée par des forces policières et militaires, ou miliciennes, devient :
1. paroxystique, donc ne connaît plus comme moyen d’agir et de parvenir à ses fins que la mise à mort des ennemis, moyennant quoi le citoyen lambda est confronté à la menace permanente d’être tué, un risque maximal pour tout un chacun.
2. de surcroît, comme suggéré à l’instant, les personnes visées en tant « ennemis », peuvent être n’importe qui : tout le monde peut entrer dans la catégorie des gens à éliminer… Alors, la violence peut atteindre toute personne sans préférence pour certaines. Nul n’est à l’abri pour toujours. Le soupçon et la suspicion s’exercent de façon très large, et une simple dénonciation, voire une simple rumeur, par exemple une lettre anonyme, peuvent déclencher les foudres prévues. Dans un système simplement autoritaire, il reste quand même l’idée que certaines catégories ne sont pas a priori soupçonnables si l’on peut dire, donc qu’il y a des frontières, même étroites, même fragiles, qui protègent des bons sujets, qui sont ici des allemands de souche, des personnes bien disposées à l’égard des nazis, des Völkisch, etc.. En revanche, dans le régime de terreur, par différence avec ce que je viens d’appeler un système simplement autoritaire, toutes ces frontières sont abaissées, et plus personne ne peut se réfugier derrière une qualité protectrice. Les proches du pouvoir y compris. Car même une toute petite déviation peut avoir des conséquences mortelles rapides (cf. I. Kershaw, La fin…, op. cit., le chapitre 6, « Le retour de la terreur »). C’est ce qui se passe à la fin de la guerre lorsque Hitler prend fameux décret qui prescrit une politique de « terre brûlée », donc qui envisage de détruire les ressources allemandes, usines, etc., fin de ne pas les abandonner aux ennemis et aussi parce que le peuple allemand n’a pas été à la hauteur du Reich de mille ans… ( ce décret ne sera pas appliqué).
En fait, parmi les sources de la terreur ainsi comprise et pratiquée, il y a le principe que la guerre est un idéal de vie, et que cet idéal se réalise concrètement dans la nouvelle guerre (cf. Kershaw, Hitler..., op. cit., p. 219) Pour Hitler, explique Kershaw, la guerre a quelque chose d’absolu, et tel est l’accomplissement de sa « mission ». C’est ce que les nazis appellent la « loi de fer » du combat entre les peuples (cf M. Broszat, L’Etat hitlérien, op. cit., p. 444 ; et p. 445 qui affirme que le nazisme revient à son « véritable élément » dans le combat, dans la guerre). On a bien là la logique de base qui soutient et oriente toute l’entreprise nazie, depuis le début, dès les années 20.
4)
Sous quel concept de la domination peut-on ranger de manière synthétique ces faits de violence ? Pour répondre à cette question, je me réfère à un discours d’Auguste Champetier de Ribes, prononcé lors du procès des principaux dirigeants nazis, à Nuremberg (procès qui s’étala sur un peu plus d’un an, de septembre1945 jusqu’en octobre 1946). Champetier de Ribes, résistant, homme politique qui fit partie des 80 députés n’ayant pas voté les pleins pouvoirs à Pétain, arriva à Nuremberg en remplacement de F. de Menthon, qui avait démissionné après que le Général De Gaulle ait quitté le pouvoir. Et voilà ce que dit Champetier de Ribes au moment de prendre la parole :
« Le crime de ces hommes est essentiellement d’avoir conçu le plus gigantesque plan d’une domination universelle et d’avoir voulu le réaliser par tous les moyens, c’est-à-dire sans doute par la violation de la parole donnée et par le déclenchement des pires des guerres d’agression, mais surtout par l’extermination méthodique, scientifique de millions d’êtres humains et notamment de certains groupes nationaux ou religieux, dont l’existence gênait l’hégémonie de la race germanique »…
Je cite ce passage parce que je voudrais régler mon analyse sur l’intuition de cet homme (certainement admirable). Ce propos m’intéresse parce qu’il fait apparaître dans le nazisme un projet de domination absolue (il dit : « une domination universelle ») d’un groupe humain sur les autres, voire sur la terre entière. Comment comprendre cela ? Disons que le nazisme aura promu un projet de domination de certains individus, membres d’un groupe (un groupe idéalisé, l’Allemagne, la race aryenne…) : 1° sur les autres individus membres de ce même groupe ; si bien que la domination met en œuvre une logique de soumission à des chefs, ce que réalise la Führerprinzip - qui entraîne dévouement illimité, loyauté envers les maîtres, et ce jusqu’au sacrifice) ; et 2° sur tous les individus membres des groupes réduits en esclavage. Mais évidemment pas au même titre, puisque seuls les seconds peuvent être visés par cet esclavagisme et les mesures de mise à mort (au profit des premiers).
Peut-on parler de subordination ? Oui, mais la domination nazie, quand elle a pour but le massacre de masses de populations, ne peut pas être confondu avec une simple situation de subordination. Dans ce cas en effet, on peut penser (voir Simmel, dans Sociologie, op. cit., chap. 3, p. 161) que le désir de domination cherche à briser la résistance intérieure de l’individu assujetti, alors que la subordination vise avant tout, et vise seulement, à empêcher la résistance extérieure. Il s’agit donc bien dans le système nazi d’annihiler la volonté des sujets, ce qui en passe par une condamnation à mort et une exécution toujours possibles, instantanée, facile, ce qui engendre chez les victimes actuelles ou potentielles un sentiment permanent de terreur. Pour atteindre cet objectif, la domination, comme domination absolue, s’appuie évidemment sur le sadisme et la cruauté des bourreaux. Car le plaisir narcissique est d’autant plus grand que la férocité et le meurtre sont courantes, faciles disais-je, et activés sous n’importe quel prétexte. D’où, aussi, une maîtrise de la vie qui engage une illimitation du pouvoir sur les individus : ce sont les stérilisations obligatoires, l’assassinat des handicapés, le quasi fabrication de bébés dans les Lebensborn… et, dans les camps, des expériences pseudo médicales sur des cobayes humains (amputations, inoculation de maladies, tests mortels, etc.) … Dans les camps d’extermination comme Auschwitz, ceci mène à la condition du « musulman » (d’après le vocabulaire des détenus), qui désigne la phase ultime de l’épuisement et de la souffrance, quand la victime n’ a plus ni volonté ni force de vivre mais n’est pas encore morte. Les médecins nazis des camps seront jugés par un procès spécial à Nuremberg (mais un procès intenté par les seuls américains cette fois).
Remarque
J’ai évité de présenter des faits subjectivement difficiles à regarder, insupportables. Il faudra quand même en aborder un peu en parlant la prochaine fois des Einsatzgruppen. De même, je ne puis renoncer tout à fait à dire un mot de la cruauté avec laquelle s sont comportés les SS dans les camps. Voici seulement deux ou trois exemples, que j’emprunte au livre de M. Aycard et P. Vallaud (p. 335 et 336), lorsque ceux-ci évoquent la découverte des camps par les armées soviétiques et les armées alliées, en 1945, quelques semaines avant l’écrasement du Reich. Arrivés à Auschwitz, les Russes découvrent des
«‘squelettes ambulants’ qui s’avancent en trébuchant, les fosses, les puits, les tranchées remplis de cadavres, les fours crématoires plein d’ossements calcinés, les douches au zyklon B ».
De même à Buchenwald lorsque, le 11 avril 1945, les américains constatent que le commandant du camp a chez lui deux têtes humaines empaillées. De même encore, lorsque le général Patton entre dans le camp d’ Ohrdruf, près de Buchenwald, et n’en ressort que pour vomir (lui qui est quand même un… dur de dur!), après quoi il forcera les habitants du village (qui prétendent n’avoir rien vu ni su) à venir regarder l’horreur en face. Est-ce cela qui a ensuite poussé le maire et son épouse à se suicider le soir même ?…
Le 15 avril, à Bergen-Belsen, les britanniques font à leur tour une macabre découverte : des abat-jour et des gants confectionnés avec de la peau humaine...
5)
Voici maintenant quelques ajouts à mes envois de la fin 2021.
a) Sur le RuSHA
Pour le recrutement des SS, Himmler se montra personnellement très attaché au respect du critère racial… C’est la raison pour laquelle il exigea que l’arbre généalogique à présenter au RuSHA par les candidats au recrutement remonte non plus jusqu’en 1850 mais jusqu’en 1750. Il souhaita même que le seuil soit fixé à 1650, quoique dans la pratique, c’est la date de 1800 qui resta seule praticable. Or cette procédure était valable également lorsque les SS désiraient se marier, car dans cette perspective, ils étaient tenus de fournir un dossier sur leur future épouse. Exemple, le 27 avril 1937, Friedrich Menneke, Hauptscharführer (adjudant), médecin qu sera intégré au programme T4 (les assassinats des personnes handicapées), fournit 41 certificats relatifs aux ancêtres de sa fiancée. La découverte et la dénonciation d’ascendances juives devenait une obsession. La femme du général Ludendorff, Mathilde von Kemnitz, fut elle-même, comme certains dirigeants nazis d’ailleurs, soupçonnée d’avoir des ancêtres Juifs.
b) Sur développement des activités anti-juives dans le cadre du SD.
Je signale comme un autre fait significatif les conférences données par un groupe de soi-disant experts de la « question juive » dans le cadre du SD. Ainsi le 1er novembre 1937, 66 membres du SD, officiers et sous-off pour la plupart furent ainsi réunis à cette fin. La sous-section du SD voulut en outre établir un grand fichier juif sur tous les juifs du Reich et aussi sur ceux estimés influents à l’étranger comme le juge de la Cour suprême américaine, Felix Frankfurter. Ce fichier fut évoqué lors de la conférence du 1er novembre 1937 par le Hauptsturmführer Erich Ehrlinger qui donnait pour but à son activité : « que la lutte intérieure contre les juifs puisse être menée avec succès… ». En 1939, un recensement permit de créer un tel répertoire qui se révélera utile pour les déportations, et qui comportait y compris les noms de demi-juifs et de quarts de juifs. Une autre collecte d’informations s’appliqua à toutes les organisations juives d’Allemagne et du monde entier ! A ce moment, les hommes du SD découvrent des complots juifs un peu partout ! Le 1er novembre, Eichmann fait une conférence sur « Le judaïsme mondial », et il énumère toute une série de complots en ce sens, jusqu’à un hospice pour juifs indigents à Paris, qui aurait fomenté un attentat (avorté) contre le chef des nazis des Sudètes. Un autre chef nazi, Konrad Henlein, chargé de débusquer et de déjouer des attentats contre le Führer, se fixe sur Nathan Landsmann, le Président de l’Alliance israélite universelle, à Paris… En 1935, Heydrich n’est pas sur cette longueur d’ondes et il se tourne plutôt vers la Palestine où on envisage des émigrations forcées, même si, pour le SD, la Palestine pouvait apparaître comme un centre pour les machinations juives à travers le monde. (En 1938 à Vienne, dans l’Autriche annexée, fut en effet créé sous l’égide du SD un Office central d’émigration juive. On y retrouve Dannecker (qui dirigera en France le camp de représailles de Drancy), avec Eichmann, et Hagen, qui sera aussi un des SS très actifs en France).
Anecdote
Vers la fin de 1936, Heydrich apprend la préparation d’un complot de Toukhatchevski contre Staline, et il envisage de faire prévenir Staline pour l’inciter à décapiter l’état major de l’armée rouge. Alors les SS préparent des faux pour faciliter cette intervention, sans tenir compte d’objections sur la véracité des informations initiales sur Tchoukatchevski et ce prétendu complot, qui pourrait n’être qu’une ruse des services secrets soviétiques. Du coup, la SS entre en action, en passant par Prague. Un émissaire soviétique reçoit les documents (faux) qu’il paye en... fausses roubles, 3 millions. Or le 11 juin 1937, l’agence Tass annonce la condamnation à mort de Toukhatchevski et de 7 autres généraux, ce qui donne lieu à une opération sanglante puisqu’en un an 35 000 officiers dont 90% des généraux de l’armée rouge sont écartés. Evidemment cette « purge » stalinienne conforte Heydrich qui prétend que le SD a décapité l’armée rouge. Mais évidemment, tout ceci est très exagéré, car en réalité Staline a décidé d’éliminer Toukhatchevski avant l’action conduite par Heydrich…
c) sur le RSHA
En septembre 1939, le RSHA est créé sur un compromis : son autorité ne sera pas reconnue officiellement. C’est une réorganisation interne de l’Empire de Heydrich qui conçoit une fusion des sections parallèles des service centraux. Le RSHA était donc un organisme très complexe qui comportait les sections suivantes, qui, au total, laissent entrevoir une action en direction de l’espionnage d’une part, de la répression et du meurtre d’autre part.
-RSHA I = administration et droit, en remplacement de la Gestapa et du SD. Cette section était à ce moment initial dirigée par le juriste Werner Best.
- La section IV était consacrée à la lutte contre les adversaires du parti, et la section V sous la tutelle de l’État, était consacrée à la lutte contre la criminalité.
- La section II s’occupait de l’idéologie, la III des affaires intérieures, la VI se chargeait, cette fois sous l’autorité du parti, de l’espionnage à l’étranger.
En mai 1940 Werner Best démissionne et s’engage dans la Wehrmacht. On le retrouvera à Paris, durant l’Occupation, parmi les chefs de l’administration des troupes d’occupation. Heydrich, l’adjoint d’Himmler et numéro 2 de la SS, a alors les mains libres.
Cela étant, cette situation de regroupement en quoi consiste techniquement le RSHA, n’évite pas des ambiguïtés, notamment des recoupements entre SD et Gestapo. Nous avons déjà constaté la création de tels désordres dans la permanente reconfiguration nazie des institutions et des pouvoirs répressifs… (je reprends ici les indications d’H. Höhne, dans L’ordre noir, op. cit., p. 128). Par exemple la section II du Gestapa voué à la surveillance des « marxistes », recoupe la section II-121 de la direction du SD qui doit s’occuper des « mouvements de gauche ». Et comme les hommes du SD rechignent à se cantonner à des tâches purement idéologiques, on va également les lancer dans l’espionnage (qui ne leur est pas tout à fait étranger), même s’il y a les services d’information de la Défense nationale (l’armée) dirigés par l’amiral Wilhelm Canaris, qui vont donc s’en trouver un peu gênés. Que se passe-t-il alors pour régler le problème ? Eh bien, le 21 décembre 1936 l’Amiral Canaris et Werner Best signent un traité définissant les compétences de la Gestapo d’après lequel les hommes de Canaris conservent les compétences en matière d’espionnage et de contre-espionnage. Or le SD va contredire cela. D’où le conflit et la rupture entre Heydrich et Canaris. Tout ça, je l’ai déjà dit, est un peu compliqué, mais… très significatif.
Dans ces conditions, un conflit entre le pôle SD-SS et la Wehrmacht est quasiment inévitable. D’autant plus que les dirigeants nazis se méfient du SD, qui ne devrait plus s’occuper des affaires internes du Parti et pourrait se tourner seulement contre les éléments hostiles extérieurs, alors que certains, au sein du SD, se veulent toujours des sortes de redresseurs de tort dans le Parti. C’est par exemple, nous dit Höhne, le cas de Reinhard Höhn, le chef de la section II-2 à la direction du SD, et de son adjoint Otto Ohlendorf, qui scrutent, à l’intérieur même du Parti, des courants « collectivistes » (« bolchevistes » disent-ils) et, sur le plan économique, des courants absolutistes (« fascistes » disent-ils). Tous, selon eux, sont insuffisants ou erronés donc gênants. Ohlendorf, qu’on retrouvera comme chef d’un des Einsatzgruppen en URSS après l’invasion de l’été 1941 devient avant cela chef d’état major de la section II-2, moyennant quoi son activité dépasse largement la sphère économique pour s’étendre à toute la vie publique allemande, la culture, les sciences, l’instruction, les coutumes, le droit… A l’actif de cet organisme, on peut aussi évoquer le chantage exercé sur des hautes personnalités homosexuelles, parmi lesquelles le ministre de l’économie, Fink, et le Général von Fritsch, commandant des forces armées de la Wehrmacht. Des affaires complexes et embrouillées dans lesquelles je n’entre pas.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par fjf le 18 Mai 2022 à 08:27
Séance 2
INSTITUTIONS ET MILICES DE LA GUERRE NAZIE
(Suite 7)
Les EINSATZGRUPPEN
Je complète aujourd’hui ma description sommaire des principales instances nazies (polices, organes d’espionnage et de sécurité, milices et autres groupements agonistiques) consacrées à la guerre contre les populations civiles, allemandes et étrangères. Concernant les institutions militaires proprement dites, je rappelle que la Wehrmacht est créée à la place de la Reichswehr par une loi du 16 mars 1935 (qui rétablit aussi le service militaire).
Je vais donc parler des Einsatzgruppen. Littéralement, les Einsatzgruppen, ce sont des « groupes d’intervention ». Mais dans les faits ce sont des équipes de tueurs, missionnées comme telles dans les pays conquis pour exterminer les Juifs et les dirigeants locaux du régime communiste, toujours soupçonnés de vouloir ou de pouvoir s’en prendre à l’armée allemande, par derrière en quelque sorte.
A ce propos, on me permettra une notation personnelle. Pour aborder ce sujet, je dirai qu’il est un des plus pénibles qui soit. J’ai fait effort dans ce blog (comme dans mes livres), pour épargner au lecteur les représentations les plus hideuses, les situations cauchemardesques que les nazis ont produites au cours de leurs avancées guerrières. Mais ma modération n’est pas toujours tenable. Ici, je me sens obligé de vous mettre sous les yeux des témoignages terribles. En outre, cette histoire me procure une impression étrange que je n’ai éprouvée dans aucun autre domaine, une impression paradoxale : plus j’en connais le fond, plus j’accumule des faits certains, assortis de notations pratiques etc., et moins je la comprends C’est bien l’inverse de ce qui se passe dans les autres domaines de l’histoire, où l’accumulation de connaissances engendre au contraire une maîtrise de plus en plus forte et fine du sujet. Ici, c’est presque l’inverse. L’accroissement et l’approfondissement de mes connaissances crée en moi une impression d’éloignement et de difficulté insurmontable : ça m’échappe. Sans doute est-ce le simple effet d’une lassitude et d’une consternation extrêmes. D’autant qu’à chaque fois que je crois être en possession d’un fait criminel absolument horrible, je me dis qu’il n’y aura pas pire, que donc je touche le fond, après quoi je ne pourrai que remonter, peut-être, et respirer à l’air libre... Or là aussi je suis contredit par le cours de mes lectures, qui me conduisent toujours à une situation encore pire… On dirait que la méchanceté nazie, le désir de faire souffrir autrui a atteint une sorte de sommet de créativité. Une génialité dans le mal.
Voici, dans la chronologie de mes découvertes, la dernière dernière en date de ces situations. Je la trouve dans le livre de M. Prazan cité ci-dessous, p. 244 « A Khmelnitski, en Ukraine , j’ai rencontré un homme qui, quand il avait douze ans, fut enfermé dans un sanatorium de Petchora où les enfants juifs étaient vidés de leur sang jusqu’à la mort pour transfuser les blessés de la Wehrmacht ».
Voilà… Je vous laisse imaginer une « opération » macabre de cet Type… Pouvons-nous songer à l’enfant qui regarde la scène et qui comprend ce qui va arriver à d’autres enfants ou bien à lui-même? Pouvons-nous saisir la pensée du médecin SS (un SS… probablement ) qui accompli ce geste en se convaincant qu’il détruit peut-être une vie….mais pour en sauver une autre bien plus importante, car… il s’agit de sa propre… race ! Eh bien quant à moi, je réponds non. Je me sens résolument incapable de mobiliser la moindre parcelle d’énergie mentale pour me représenter ces atrocités, du point de vue du témoin ou de la victime d’abord, et du bourreau ensuite.
J’en viens à mon sujet. Sans proposer une bibliographie complète et raisonnée, je puis dire simplement que je m’appuie ici sur quelques documents. D’abord des documents télévisuels, et en particulier ceux de Michaël Prazan, très riches et précis, diffusés sur A2 en avril 2009 ; et qui ont fait l’objet de 2 DVD (dont les images sont parfois pénibles à voir, difficiles à supporter…). Ensuite je m’appuie essentiellement sur les livres suivants : de Richard Rhodes (historien Américain), Extermination : la machine nazie. Einsatzgruppen, à l’Est, 1941-1943, Collection Autrement (2004 [2003]) ; de Ralf Ogorreck (historien Allemand), Les Einsatzgruppen. Les groupes d’intervention et la genèse de la ‘solution finale’, Paris Texto, 2007 [1996] ; et aussi de Michaël Prazan (à qui l’on doit les très bons documentaires dont je viens de parler), Einsatzgruppen. Les commandos de la mort nazis, Paris, Seuil, 2010. En complément, je n’oublie pas Christopher Browning qui a consacré un livre remarquable à l’un des bataillons de police chargé de ce genre de besogne en Pologne, en 1942 (Des hommes ordinaires ? Le 101é bataillon de réserve de la police allemande et la Solution finale en Pologne, Paris, Texto, 2007 [1992]. Et de manière générale, je pense qu’il ne faut pas négliger le travail capital de l’abbé Patrick Desbois, en fonction duquel a été fixée l’expression de « Shoah par balles » (même si ce phénomène, qui précède l’extermination dans les chambres à gaz, était connu depuis longtemps et n’a pas été découvert par Desbois…). Son livre : Porteur de mémoires : Sur les traces de la Shoah par balles, Paris, Michel Lafon, 2007…
On trouvera en outre des indications précises, soit en allant lire ce que le site web de Yad Vashem, à Jérusalem, a mis à notre disposition ; soit en consultant d’autres ouvrages plus généraux très importants, comme ceux de R. Hilberg, de T. Snyder ou d’E. Husson en France, etc ; ouvrages que j’ai plusieurs fois cités, avec d’autres.
1)
Disons que les Einsatzgruppen sont créés en 1938 et deviennent très opérationnels vers la fin de 1939. Ils ont alors reçu un entraînement militaire et ils sont dotés de moyens motorisés. Ils sont rattachés à la Wehrmacht. Pour saisir la formation des ces troupes criminelles, on doit donc, d’après les dates que je viens de citer, se reporter à l’annexion de l’Autriche, puis à l’envahissement de la Tchécoslovaquie (devenant la Bohème-Moravie). Ceci est bien traité par E. Husson, dans Heydrich et la solution finale, op. cit. p. 195. A l’origine de ces équipes, il y a Heydrich, le second du RSHA (les services de sécurité), et le Général de brigade Eduard Wagner, intendant général de la Wehrmacht. Que cherchaient les nazis ? Ils voulaient poster ces groupes à l’arrière du front, dans le sillage de l’armée, afin de combattre et d’éliminer préventivement les éléments hostiles ou possiblement hostiles (les « partisans » notamment) aux Allemands. Dès le 31 Juillet 1939, alors que se prépare l’invasion de la Pologne, c’est l’« entreprise Tannenberg », (Unternehmen Tannenberg) qui fixe la tâche des Einsatzgruppen : « combattre tous les ennemis du Reich et de l’Allemagne ». Remarquons ici à nouveau, ce qui m’importe au plus haut point, l’usage du mot « ennemi ». Fin août, Heydrich et Werner Best, le juriste, obtiennent le rattachement des Einsatzgruppen à la Wehrmacht, avec la perspective d’enfermer 30 000 polonais dans des camps de concentration.
Hitler, dans un discours du 22 août 1939 (cf. Arno Mayer, La « solution finale » dans l’histoire, Paris, La Découverte, 1991 [1990], p. 209, ceci se passe au au Berghof, devant les principaux chefs militaires), fait allusion aux unités SS mises en place depuis l’invasion de la Pologne au moins (je suis aussi E. Husson, Heydrich et la solution finale, op. cit., p. 196). Hitler évoque le pacte en cours de conclusion avec l’URSS et il plaide en faveur d’une attaque préventive, tenant compte de la faiblesse de la France et de l’Angleterre (précision : il s’agit du « pacte germano-soviétique » signé le 23 août 1939, auquel Staline s’est longtemps accroché, pensant qu’il avait floué les nazis alors que, comme le montre ce que je viens de dire, c’est lui, Staline, qui était tombé dans un piège).
Un moment important dans la mobilisation des équipes de tueurs, ce fut une réunion, au printemps 1941, dans la ville de Pretzsch (qui se trouve à 80 km sud-ouest de Berlin). Cette réunion préparait l’offensive en URSS, dans laquelle il fallait organiser les Einsatzgruppen, pour les rendre encore plus efficaces.
Donc, dans la perspective de ces attaques, depuis l’attaque de la Pologne, puis celle de l’URSS, les Einsatzgruppen sont créés sur la base de la SS. Cela soulève cependant des difficultés, car les militaires de la Wehrmacht ne sont pas toujours absolument favorables aux SS. Ceci crée des conflits (il y en aura de typiques dans la France occupée). C. Browning analyse de façon très claire ces sortes de tensions, qui, du reste, donnent lieu a des négociations et ce dès le 31 juillet 1939, au terme desquelles un accord est trouvé dans la perspective de « combattre les éléments anti-allemands agissant en territoire hostile derrière les troupes au combat ». A ce moment, Heydrich souhaite éviter les frictions avec la Wehrmacht, et il explique à ses commandants et officiers de liaison qu’il faut éviter de soulever des protestations. Ce qu’il attend, c’est l’arrestation de ceux qui s’opposent aux mesures prises par les autorités allemandes, ceux qui créent des troubles « et sont en mesure de le faire, de par leur position et leur notoriété ». Le 29 août, ces négociations entre la SS et l’armée, s’achèvent par une réunion entre d’un côté Heydrich et W. Best et de l’autre le général d’intendance de l’OKW, Eduard Wagner.
Cela étant, lorsque des atrocités sont commises par des Polonais contre les Allemands résidant dans le territoire polonais (c’est ce qu’on appelle le « dimanche sanglant », qui a lieu à Bydgoszcz - ou Bromberg), en même temps que des soldats polonais combattent les Allemands derrière leurs lignes, des cours martiales prononcent à la suite 200 condamnations à mort par jour, avec des exécutions rapides. Or Heydrich trouve cette vague de punitions beaucoup trop modeste, et il demande des pendaisons immédiates. A cette fin, il lance le mot d’ordre : « Pas de quartier pour les nobles, les prêtres et les Juifs ». Du coup, la Wehrmacht prend conscience des vues de Hitler et Heydrich. C’est ce qu’on constate quand, le 9 septembre, Franz Halder, chef de l’état major général de l’armée, affirme : « il est dans les intentions du Führer et de Göring de détruire et d’exterminer le peuple polonais ». L’amiral Canaris, chef de l’Abwehr s’adresse de même au maréchal Keitel, en disant : « Je sais qu’un vaste programme d’exécutions est prévu en Pologne et qu’il vise notamment la noblesse et le clergé »… (tout ceci est cité par C. Browning, dans Les origines de la solution finale..., op. cit., notamment p. 46)
2)
Voilà donc de quoi vont être chargés les Einsatzgruppen. Pour ce faire, en Pologne, ils sont composés de cinq équipes, auxquelles deux autres vont ensuite s’adjoindre. Dans chacune s’activent 4 commandos de 100 à 150 hommes. Derrière arrivent le bataillons de la police de l’Ordre, des régiments de SS « têtes de mort » (qui sont aussi, je le redis, chargés de garder les camps de concentration), puis les Waffen SS. Ils sont 20 000 hommes au total. C’est Bruno Streckenbach, commandant d’un Einsatzgruppe, qui est chargé à Pretsch, en mai 1941, de recruter des combattants pour les Einsatzgruppen.
Par ailleurs, il est aussi significatif que les dits commandos, s’estimant en nombre insuffisant, recrutèrent des très nombreux supplétifs, des lituaniens, des lettons, et des ukrainiens, 60 000 hommes au total, 60 000 assassins qui firent merveille, si j’ose dire, en différentes régions, notamment en Ukraine et Biélorussie. La plupart des tireurs ne furent donc pas tous des Allemands... (Un vieil adage yiddish disait : « Les Allemands étaient mauvais, les Polonais étaient pires ; les plus terribles étaient les Ukrainiens »…). Sans ces forces d’appoint, les opérations de meurtre n’auraient pu avoir lieu à cette phase de tueries de civils dans les villes et les villages. Et seul ce nombre de 60 000 peut expliquer qu’on soit parvenu à liquider au moins un million de personnes en quelques mois, des hommes d’abord puis de familles entières. Le crime est alors devenu génocide à proprement parler.
Lorsque le travail de tuerie est structuré, on fait fonctionner des duos par exemple pour assassiner les mères avec leurs enfants, l’un des tueurs se chargeant de la mère, l’autre de l’enfant (l’un des témoignage cités par C. Browning confirme l’adoption de cette méthode, car l’un des assassins confie qu’il laissait son binôme tuer la mère, en sorte qu’il avait ensuite moins de scrupules à tuer un enfant devenu orphelin et de ce fait voué à une vie de misère !).
Les Einsatzgruppen au sens strict sont quant à eux constitués de 3000 hommes au total, pas davantage, issus de la Gestapo, du SD, de la Kripo et de l’Orpo pour le 7ème, celui de Udo von Woyrsch. Il y a en outre 25 chefs d’Einsatzgruppen et d’Einsatzkommando. Et 15 d’entre eux possèdent un titre de Doktor, pour la plupart en droit, parfois en philosophie. Souvent les recrues sont assez jeunes.
Chaque état-major (constitué sur le modèle du RSHA) comprend 25 à 30 membres de la Kripo, de la Gestapo et du SD, avec en plus du personnel administratif (ce qui confirme que les SS et la police sont devenus un véritable – et redoutable - instrument de guerre … avant tout contre les populations civiles ). Evidemment, il n’y a jamais d’instruction écrite pour cadrer le « travail » de ces groupes. On sait juste que Best, d’après un document du 31 juillet 1939 ? du côté de l’armée, a interdit ou tenté d’interdire les exécutions spontanées. Mais lors de son procès en 1965, Lothar Beutel, le chef de l’Einsatzgruppe IV, a évoqué une réunion du 18 août, à Berlin, en présence d’Himmler, Heydrich et Best. dans laquelle il a entendu que, pour sécuriser l’arrière, « tout était permis, aussi bien les exécutions par fusillade que les arrestations ».
Parallèlement, le SS Theodor Eicke (un Obergruppenführer qui sera chef des inspecteurs des camps de concentration ; et mourra en Ukraine en 1943) a la charge d’entraîner la division SS Totenkopf (tête de mort) à perpétrer des massacres de ce type.
Christopher Browning, dans Les origines de la solution finale… (idem, p. 43 et suiv.) nous apprend qu’au début ont été formées des unités SS, nommées Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei, ce qui pourrait se traduire par : unités mobiles spéciales de la police de sécurité, et que celles-ci ont été engagées dans la conquête de la Pologne. Elles sont alors, comme je le disais plus haut, au nombre de cinq, chacune étant attachée à l’une des armées d’invasion. Ensuite s’y ajoutent deux autres groupes et un Einsatzkommando (C. Browning cite Helmut Krausnick et Hans-Heinrich Wilhelm, Die Truppe des Weltanschauungskrieges, p. 34). Je n’ai rien trouvé de spécial dans le livre de Michaël Prazan, Einsatzgruppen…, op. cit., qui commence son récit avec l’invasion de l’URSS, l’opération Barbarossa, en juin 1941.
On parle souvent de la présence d’Himmler auprès de ces assassins. C’est d’ailleurs à Minsk, en Biélorussie, en août 1941 qu’Himmler, assistant à un massacre et étant éclaboussé par la cervelle sanguinolente d’un condamné à qui l’on venait de tirer, trop maladroitement (!) une balle dans la tête, se serait trouvé mal et aurait même été proche de défaillir.
3)
Ces équipes spéciales comportent elles-mêmes les deux branches que je viens d’évoquer : d’une part les EinsatzKommando, d’autre part les Sonderkommando. D’après M. Prazan (cf. la note de la p. 17 de son ouvrage), les premiers sont affectés à des tâches de police, et les seconds à des tâches de renseignement. Que signifie cela (qui reste à étayer) ? Je suppose que les tâches de police consistent à interpeller des gens identifiés pour ensuite les mener sous bonne escorte au lieu de leur exécution. Les tâches de renseignement consistent quant à elles, sans doute, à recenser les gens que l’on se propose d’abattre…
La technique des tueries : fusillades ou mitraillages…, ou bien, de près, presque à bout portant, la balle dans la nuque (d’où, dans les deux cas, l’intitulé de « Shoah par balles »). Les exécutions peuvent durer des journées entières, et même s’étaler sur plusieurs jours, ce qui a été assez fréquent en Ukraine en 1941, comme à Babi Yar, près de Kiev, où environ 30 000 personnes ont été massacrées après avoir été entassées dans un ravin.
Tous les jours, les chefs des Einsatzgruppen envoient des rapports à Berlin où ils consignent leurs résultats, en nombre de tués. Mais ils utilisent de codes, ils parlent ainsi de « traitement spécial ». En revanche les policiers écrivent clairement « on a tué 1000 Juifs », etc… Anglais et américains captent ces communications, donc, dès l’été 1941, après l’invasion allemande de l’URSS, ils sont au courant. Ils comprennent qu’ils sont face à un meurtre de masse…, tout autre chose qu’un pogrom. Et Churchill, apprenant ce genre de chose, dit : « nous somme en présence d’un crime qui n’a pas de nom » - quoiqu’il se contentera de cette formule, nous dit-on, afin ne pas alimenter la propagande nazie selon laquelle lui et les anglais feraient la guerre dans le but principal soutenir les Juifs.
Un officier ayant agi plus tard dans le Caucase explique qu’en Pologne, il avait en poche un petit volume avec des listes (imprimés en très petits caractères sur des pages de papier très fin, afin que le tout ne prenne pas trop de place), où apparaissaient les membres actifs du PC, des intellectuels non membres, des universitaires, des enseignants, des écrivains, des journalistes, des prêtres, des fonctionnaires, des paysans riches, des industriels, des banquiers. Avec les adresses et les n° de téléphone (le sens très méthodique des Allemands se vérifiera en France!). Il y avait en plus des listes supplémentaires de parents et d’amis, avec des descriptions physiques et parfois même des photos. Les nobles sont tous condamnés à mort. D’où plus de 16 000 personnes exécutées. (Dans le livre de R. Rhodes, p. 11, un témoin raconte l’exécution de 12 scouts ! ... tous avaient été alignés contre un mur).
Sur le registre des témoignages, tous plus affreux les uns que les autres, je vous propose de suivre en premier la transcription d’un entretien de M. Prazan avec un nationaliste lituanien en 2008 (p. 344 et suiv. de son livre cité plus haut). L’homme, nommé Juozas Aleksynas, est alors âgé de 95 ans et est fort malade… Après la guerre, capturé par les Russes, il avait été détenu 10 ans, puis avait accompli 10 ans de plus dans un Goulag… en Sibérie… Mais il parle avec assez de liberté, et sans trop de culpabilité des tueries auxquelles il a participé.
Voici le script de l’entretien...
Avec la conquête de l’URSS, dès l’été 1941 et surtout en 1942, la technique des massacres s’est améliorée et les exécutions sont davantage planifiées, et perpétrées par ces équipes à des échelles nettement plus grandes. Dans les villes et les villages conquis, une administration militaire recense d’abord les Juifs, toutes les familles et chacune au complet (sont aussi visés et immédiatement fusillés les commissaires politiques et les cadres du régime soviétique), puis, les gens recensés sont convoqués par les hommes des unités mobiles (par des affiches où ils lisent qu’on va les déplacer pour les faire travailler…). Or, une fois rassemblés à l’endroit prévu et à l’heure dite, ils sont en réalité conduits à l’extérieur des villes, parfois à proximité des habitations, jusqu’à des lieux spéciaux, où ils doivent creuser des fosses (qui sont parfois créées avant leur arrivée), où on les fait ensuite descendre par centaines, entassés les uns sur les autres comme du bétail. Et là, immédiatement après, on leur ordonne de se déshabiller (voir les témoignages ci-dessous… N’est-ce pas le comble de l’horreur ; parfois ils doivent s’allonger les uns sur les autres, les vivants sur les morts, etc.), puis ils sont abattus par fusillade, avec des mitrailleuses, ou bien on leur tire une balle dans la tête, un par un, avec des fusil ou des pistolets. L’opération se répète autant de fois que nécessaire pour tuer toute une population, et cela, j’y insiste, dure souvent des journées entières. Je redis que le premier massacre de masse sur ce mode s’est produit à Babi Yar à la fin du mois de septembre 1941, où plus de 30000 personnes sont précipitées dans un ravin et mitraillées. Ces meurtres à l’air libre, au grand jour et en public ne sont pas même cachés aux habitants alentour. Ceux-ci, terrorisés, s’ils ne sont pas enrôlés comme supplétifs (parfois ils sont désireux d’être associés à ces orgies sanglantes), peuvent donc voir les malheureux que l’on traîne au supplice ; ou bien, si leurs maisons sont plus éloignées de la scène, ils entendent cependant les détonations régulières, chaque jour, du matin au soir. Dans d’autres cas et d’autres lieux, les exécuteurs utilisent non pas les armes à feu mais les gaz d’échappement de camions, renvoyé à l’intérieur des véhicules aménagés à cette fin, où ont été préalablement enfermés les personnes condamnées… (Je signale que c’est seulement depuis que l’Ukraine est séparée de l’Union soviétique que l’on a commencé de reconstituer cette sale histoire… En URSS et aujourd’hui en Russie, tout travail de mémoire dans le même sens était et est quasi impossible).
TÉMOIGNAGES : AU PROCÈS DE NUREMBERG
Henri Monneray, La persécution des Juifs dans les pays de l’Est, Présentée à Nuremberg, Paris, 1949. « Recueil de documents », p. 94-95-96-97 (« Documents et témoignages de l’accusation »)
Jean-Marc Varaut, Le procès de Nuremberg, Paris, Perrin, 2002 [1992], p. 250, 251, 252 : Déposition écrite de Hermann Graebe, directeur de la succursale ukrainienne d’une firme allemande. La scène se passe le 15 octobre 1944 ; elle montre un Einsatzkommando assisté par une milice ukrainienne.
Sur la participation de la Wehrmacht : elle est avérée. Il y même dans certains cas une répartition des tâches : les Einsatzgruppen et la police assassinent dans les villes, les soldats dans les petits villages. Ou bien un secteur est confié à tel, comme la Biélorussie est confiée au au groupe B et aux SS.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par fjf le 17 Juin 2022 à 10:10
séance 3
LA CRUAUTE NAZIE
(sur les modes opératoires de la persécution)
Saul Friedländer intitule son livre L’Allemagne nazie et les Juifs (1939-1945), Paris, Seuil, 2008, le tome 1 Les années de persécution, et le tome 2 Les années d’extermination. Est-ce que la différence ainsi introduite entre la persécution et l’extermination est toujours pertinente ? Je ne le pense pas… pour des raisons que la suite de mon propos éclairera.
Pourquoi faire référence, et centralement, à la cruauté nazie ?
Parce que je ne me satisfais pas d’une description simplement « objective » et historiographique des institutions et des pratiques nazies de la répression et de l’extermination, notamment dans les camps. En conséquence je voudrais prendre en compte et saisir la manière concrète de traiter les détenus, dans la mesure où il ne s’agit pas seulement de les évincer ou de les liquider ; il s’agit de les faire souffrir… D’après une idée (paranoïaque) de vengeance. Voilà la raison pour laquelle je place ce chapitre sous le signe de la méchanceté et plus encore de la cruauté...
Disons les choses autrement. Pour éclairer la manière dont les nazis agissent, pour saisir les buts qu’ils poursuivent, les finalités qu’ils se donnent comme aboutissement de leur politique criminelle, il faut, conformément à la méthode déjà éprouvée ici sur d’autres objets, aborder les pratiques réelles telles que les nazis les ont conduites, telles qu’ils les ont effectuées avec constance et souvent avec enthousiasme, en tout cas sans varier à travers le temps, depuis les années 1930 jusqu’à la fin de la guerre - même si certains SS ont commis de petites transgressions par exemple s’ils se sont laissé aller à une sentimentalité que leur formation promettait pourtant d’éradiquer. Je pense au cas évoqué par Michael Pollack du SS qui a noué une complicité affective avec une femme détenue (in L’expérience concentrationnaire, Essai sur le maintien de l’identité sociale, Paris, Métailié, 2000). Mais le cas le plus probable est celui représenté par Jonathan Littel dans son roman, Les bienveillantes (2006) lorsqu’il évoque l’enfant juif capturé en Russie, d’abord apprécié comme pianiste prodige, mais finalement tué sans la moindre hésitation ni la moindre émotion dès lors qu’il devient incapable de jouer après qu’un accident l’ait privé de l’usage d’une de ses mains...
Voici un autre exemple de cruauté, que je donne pour souligner le fait que la volonté donc la décision de faire du mal est rendue opérationnelle par la suppression de tout sentiment de compassion envers les Juifs. C’est un cas de meurtre commis non dans les camps mais dans le cadre de la vie sociale ordinaire, à l’école en l’occurrence, donc dans la société civile. Nous somme loin des camps et des cachots de la Gestapo (je traite de cet exemple dans mon essai - à paraître - sur la violence nazie) :
Un témoin, interrogé lors d’une enquête effectuée à Harvard en 1939 auprès d’Allemands exilés aux USA, raconte un événement qui eut lieu à Berlin après 1933 alors que les nazis avaient pris le pouvoir (mais la date exacte n’est pas précisée ; le propos que je cite est restitué dans un film de Jérôme Prieur, Ma vie dans l’Allemagne d’Hitler, Roche production, producteur Dominique Tibi, 2018. Sur cette enquête voir aussi Anna Iuso, « L’exilé et le témoin. Sur une enquête autobiographique et son oubli », in Genèse, 2005/4, n° 61, p. 5-27). À ce moment, ce témoin, nommé Reuss ; précepteur ou autre, est « installé », dit-il, dans une famille « typiquement allemande ». Or un jour, la jeune fille de la famille, âgée de 14 ans, rentre du lycée la mine défaite, visiblement troublée, si bien qu’on la questionne. Elle explique alors que des filles de la jeunesse hitlérienne (sans doute la BDM, Bund deutscher Mädel, Ligue des jeunes filles allemandes) ont fait irruption dans la cour de l’établissement et que là, apercevant la fille d’un médecin juif, Helga, elles se sont attaquées à elle, l’ont jetée à terre puis lui ont sauté dessus à pieds joints. Nous voulions porter secours à Helga, continue la jeune fille, mais notre professeur est arrivée..., elle est membre du Parti nazi depuis les débuts, et elle nous a lancé : « De quel côté vont se ranger mes petites allemandes ? ». Alors mes camarades à leur tour, l’une après l’autre, ont sauté sur Helga ; et moi… j’ai participé aussi… Jusqu’à ce qu’Helga ne pleure plus… Et maintenant elle est morte… « alors que tout le monde l’aimait ».
Dans ce récit (qui est en fait le récit d’un récit, si bien qu’il est impossible d’estimer la distance prise avec la réalité par la première narratrice), la violence est à la fois extrême et banale. Elle est extrême, autrement dit d’une cruauté sans nom, parce que l’objet en est une petite fille, qui va mourir ; mais elle est aussi banale au sens où elle est commise dans le ban et l’arrière-ban de la société allemande, à savoir dans le cercle restreint des camarades de classe de la victime, des jeunes filles voire des petites filles, de simples et faibles filles pourrait-on dire. En outre, la modalité de ce lynchage fait penser à un jeu d’enfants - sauter à pieds joints. Voilà au total ce qui nous saisit d’horreur : le meurtre est à la portée de tout un chacun, même des personnes éloignées des violences habituelles à cette époque, spécialement les violences antisémites. C’est ainsi qu’il faut commencer par parler de la cruauté des pratiques de répression nazies. Le nazisme a promu un ordre juridique inédit qui, comme l’affirmait H . Arendt, repose sur un « droit de tuer », en lieu et place du sixième commandement du Décalogue (« Tu ne tueras point »), fondateur de trois millénaires de civilisation. Tel serait même, selon H. Arendt, le « nœud moral » du nazisme (« Responsabilité personnelle et régime dictatorial » (1964), in Responsabilité et jugement, Paris, Payot, 2005 [2003], p. 73). Ce n’est pas que le meurtre ne susciterait ni protestation, ni révolte, ou bien qu’il ne soulèverait plus la frayeur ou le dégoût des citoyens ordinaires. C’est autre chose. Disons que le nazisme a rendu l’assassinat racial accessible, largement, à toute la population allemande. Tout le monde peut tuer un Juif...
1
J’ai déjà évoqué 1. la mise en œuvre des dispositifs, policiers notamment, de la persécution (j’en ai traité dans les séances précédentes) 2. l’élaboration et la réalisation de dispositifs punitifs, comme les camps (ce qui fait deux questions distinctes). Concernant l’extermination elle-même, il faut aussi rappeler qu’il y a deux modalités principales du meurtre.
a) La première, a été pratiquée notamment par les unités de tuerie associée à la Wehrmacht lors de l’invasion de l’URSS depuis juin 41, les Einsatzgruppen (dont j’ai traité dans la séance précédente – je rappelle à ce propos que la participation de l’armée , la Wehrmacht est avérée, c’est la thèse de W. Wette, contre le mythe d’une armée innocente ou éloignée de ces crimes, dans Les crimes de l’armée allemande, Perrin, 2013 [2009 ; 2002 en allemand]. J’ai dit que dans les villes et les villages conquis, l’administration militaire recense d’abord les Juifs, toutes les familles et chacune au complet, puis les gens recensés sont convoqués et sont conduits jusqu’à des lieux spéciaux où on peut les abattre par fusillade, avec des mitrailleuses. Dans d’autres cas et d’autres lieux, les exécuteurs utilisent non pas les armes à feu le mais les gaz d’échappement de camions, renvoyé à l’intérieur des véhicules aménagés à cette fin, où ont été préalablement enfermées les personnes condamnées.
En réalité, les exactions commises à l’encontre des Juifs, avec un mode opératoire variable, ont commencé dès l’invasion de la Pologne en septembre 1939. A cette époque elles ont d’ailleurs surgi comme un événement inédit, surprenant, qui a même pu susciter un mouvement de répulsion chez certains soldats Allemands. En témoigne un document (cité par Léon Poliakov dans le n° 3 des Archives de la Seconde Guerre mondiale, p. 11). Ce document, daté de février 1940, est signé du général Johannes Blaskowitz, commandant en chef des troupes allemandes présentes en Pologne, et c’est une quasi protestation contre les « excès antijuifs » des SS. Le général signale en outre que la brutalité des SS est souvent associée à une dépravation morale propre à des individus qui donnent libre cours à « leurs instincts bestiaux et pathologiques », parce qu’ils « se sentent officiellement autorisés et justifiés à commettre les pires cruautés ».
b) La seconde modalité de meurtre appartient aux camps d’extermination. Sur les camps je rappelle la référence incontournable à l’étude (très volumineuse en l’occurrence) de Nikolaus Wachsmann, KL, Une histoire des camps de concentration nazis, Paris, Gallimard, 2017 [2015]. Retenons juste pour le moment que dans les camps, qu’ils soient de concentration ou d’extermination, on pouvait traiter les victimes soit en les tuant directement, sans délai (par le gaz ou le fusil), soit en les réduisant en esclavage pour les utiliser à des travaux divers, à commencer par ceux permettant d’assurer le fonctionnement de l’appareil d’extermination. Les camps d’extermination, plus secrets que les camps de concentration « « traditionnels », étaient soigneusement retirés du monde, quoiqu’il soit difficile de savoir jusqu’à quel point les riverains pouvaient les ignorer et ignorer leurs finalités ; mais c’est un fait qu’au-delà des barbelés et des miradors, les habitants des villes et des villages concernés pouvaient continuer leur existence sinon paisible du moins sans grave menace. D’après leurs témoignages, certains prisonniers qui sortaient du camp, étroitement accompagnés et surveillés par les SS, pour effectuer divers travaux, éreintant le plus souvent, apercevaient parfois non loin de leurs baraquements des gens occupés à leurs affaires habituelles comme si de rien n’était. Et c’est pourquoi, lors de la libération des camps, il put arriver que les soldats américains convoquent les populations pour qu’elles prennent complètement conscience, sans discussion possible, de ce qui s’était passé juste à côté de chez elles. Il suffisait de faire circuler les gens parmi les masses de cadavres encore entassés pêle-mêle dans l’attente de la fosse commune, pour prendre conscience des atrocités commises presque au seuil de leurs maisons, j’y insiste…
Remarque personnelle
De ces deux procédures de persécution, je puis supposer que mes grands-parents ont subi la seconde, l’assassinat dès l’arrivée au camp. Et comme je ne peux pas me représenter cette horreur autrement qu’avec la certitude qu’ils l’ont subie, eux, alors je dois me défendre contre l’image, même vague, de l’infernale descente vers la mort. Et pour endiguer cette pensée, je n’ai trouvé d’autre ressource que d’espérer, sans pouvoir tout à fait m’en convaincre, qu’ils ont succombé avant cela, pendant le transport, et qu’ils n’ont eu ainsi à affronter qu’une seule mort, au lieu des mille morts de la sortie brutale hors du train, de la sélection sur la rampe (le quai de la voie de garage), de la marche sous les ordres hurlés et les coups, de la nudité puis de l’asphyxie ou bien de la fusillade sous le ciel polonais. Une seule mort, advenue peu à peu dans la fatigue du voyage, voilà tout ce que je voudrais croire… Qu’ils aient doucement pris congé de la faim, de la soif et de la peur, et de leurs frères humains tout à côté, c’est la seule idée que je m’efforce de retenir. Une idée qui représenterait leur délivrance, comme une bénédiction au sein de leur sort tragique. Pour Rifca et Gustave, mes grands parents, Rifca Bucsbaum, née Sahna, et Gustave (ou Ghidali) Bucsbaum, son époux depuis 1914. Car ils sont encore là, qui me regardent et me sourient sur les photographies prises dans leur jardin, à Bures sur Yvette. Pour toujours, Rifca est assise sous le tendre feuillage du cerisier, avec sa pelote de laine dans une main et dans l’autre ses aiguilles, tandis que Gustave, juste à côté, debout, les yeux mi-clos, accueille la vie toute frémissante et bourdonnante de la faune ailée qui visite ses rosiers.
2
Cruauté dans les camps
Le camp de concentration, KL ou KZ, Konzentrationlager, existe en Allemagne depuis l’accession des nazis au pouvoir. Le camp de Dachau ouvre en 1933, immédiatement après la prise du pouvoir par Hitler et les nazis. Il y aura ensuite, des centaines de camp dans toute l’Europe conquise et nazifiée. A l’origine on y procède à l’emprisonnement des opposants politiques, du moins des personnes qui, pour une raison ou une autre, sont apparues subversives ou « indésirables ». Les victimes ne sont donc pas forcément des militants avérés, actifs ou activistes, comme par exemple des gens surpris ou signalés et dénoncés à la Gestapo pour avoir diffusé une propagande ou même tenu des propos jugés douteux à l’égard du régime. Dans le camp, ces individus sont alors livrés à l’arbitraire. Parfois a été mise en œuvre une procédure de justice, après un délit dûment constaté ou imputé, mais ce n’est pas forcément le cas, bien sûr.
Les centres de mise à mort résultent souvent d’une transformation des camps de concentration créés plus à l’Est, en Pologne surtout. Ce sont en quelque sorte des camps de concentration convertis en centre de mise à mort (parallèlement, la structure de base, le KZ, devient elle-même un camp de travail forcé à mesure que l’effort de guerre réclame de la main d’œuvre en quantité, et la moins coûteuse possible).
La double fonction (camp de travail où l’on meurt en quelques semaines ; et camp d’extermination où l’on meurt dès l’arrivée du convoi) caractérise le camp d’ Auschwitz depuis 1941. Ce camp a été construit à partir de 1940, mais ensuite, en octobre 1941, sur ordre d’Himmler, on a commencé de construire à trois kilomètres ce qui est devenu le camp principal, le camp source, le Stammlager, 250 baraques pouvant accueillir chacune un millier de détenus. La présence des femmes dans les convois se solda d’abord par des bâtiments réservés à elle, puis par un camp spécial. Auschwitz comportait en outre le camp intitulé Auschwitz III, installé sur le village proche de Monowitz, construit à côté d’une usine chimique d’I.-G. Farben (la « Buna »), elle-même récente et destinée à la fabrication de caoutchouc. Le complexe d’Auschwitz a finalement occupé 40 km², un territoire immense, pouvant contenir jusqu’à 200 000 personnes. A la libération de ce camp, en janvier 1945, le chiffre de tués dépasse très probablement le million. Guère plus de 50 000 personnes sont retrouvées vivantes par les Russes.
Pour la double fonction, KZ et camp d’extermination, à part Auschwitz, on peut également citer Maidanek. Les premiers convois de Juifs, slovaques et français en l’occurrence, arrivent à Auschwitz en mars 42. Mais les premiers arrivants sont plus anciens ; ils sont entrés le jour où les troupes allemandes, victorieuses de l’armée française, prirent possession de Paris : le 14 juin 1940 (Je m’appuie sur le livre d’une ancien détenu, Hermann Langbein, Hommes et femmes à Auschwitz, Paris, éd. 10-18, 1975, p. 20). Les Juifs commencèrent d’être massacrés là-bas en janvier 1942. D’autres camps furent directement conçus et construits pour exterminer les populations : Treblinka, Sobibor, Belsen et Chelmno, dans le cadre du génocide des Juifs polonais (l’Aktion Reinhard qui fit plus de deux millions de victimes). Dans le complexe d’Auschwitz, les chambres à gaz ont d’abord été aménagées dans d’anciennes maisons paysannes (communément appelées la « maison rouge » et la « maison blanche »), ensuite quatre autres furent construites en même temps que quatre crématoires associés. Ces chambres à gaz pouvaient contenir jusqu’à 1000 personnes (Chiffres donnés par H. Langbein, idem, p. 23).
Revenons sur les deux manières d’envisager les « camps de la mort .
a) Première manière : ce sont des camps créés pour l’exécution rapide (et neutre émotionnellement pour les SS) des déportés, le plus grand nombre des personnes déportées, qui sont donc assassinées dès leur arrivée, par le moyen du gazage dans ces locaux spéciaux, construits pour cette fin auxquels on a donné des apparences de salles de douche. En réalité, les SS et leurs sbires, au moment de pousser les gens à l’intérieur de la salle où ils allaient les tuer, n’avaient déjà plus besoin de créer une telle illusion rassurante pour que la file des condamnés, à qui on avait d’abord imposé de se mettre entièrement nus, s’avancent, transis en hiver, mais en bon ordre, sauf quelques uns dans la foule qui commençaient de comprendre certains propos qu’ils avaient entendus sans leur accorder vraiment de crédit. A cette étape de l’exécution, les SS (et leurs supplétifs Ukrainiens et Lettons, comme à Treblinka), avaient déjà accompli leur besogne, ils étaient déjà venus à bout de toute résistance éventuelle des condamnés. Mais à peine les portes closes, les hommes les femmes, les enfants, les vieillards, précipités là par familles entières parfois, les gens affaiblis et d’autres encore vigoureux, constataient qu’au lieu de l’eau attendue, un gaz, le « Zyklon B », jeté depuis le toit dans les conduits des sortes de cheminées (et jetés sous forme de granulés qui se transformaient au contact de l’air), commençait d’envahir tout l’espace en s’étendant et montant depuis le sol, et les faisait à l’instant suffoquer, défaillir, et atrocement souffrir. D’abord s’effondraient en gémissant les enfants et les personnes incapables de réagir. C’est alors que tous ceux qui n’avaient pas encore respiré le poison prenaient plus encore conscience de la situation et, dans une absolue terreur, cherchaient un moyen d’y échapper et criaient, suppliaient, griffaient les murs, s’arrachaient les cheveux, se tordaient ou s’effondraient d’épouvante et de douleur. L’opération ne durait que quelques minutes. Très vite, le silence revenait, on n’entendait plus le moindre murmure, rien n’était audible, pas de cris ni de plaintes, nul souffle de vie ne s’échappait d’aucune poitrine. Alors, les fonctionnaires du crime rouvraient les portes et pouvaient contempler leur œuvre : les tas de cadavres, les corps comme empilés les uns sur les autres, les personnes plus fortes et les plus grandes s’étant débattues en un ultime réflexe de défense, et ayant tenté d’échapper à l’inexorable expansion du gaz mortel en montant sur les corps déjà inertes de ceux qui avaient succombé les premiers.
Que voyaient et comment vivaient les bourreaux ? Un médecin d’Auschwitz, le Dr Kremer, a écrit ceci dans son Journal, à la date du 2 septembre 1942 (cité par Léon Poliakov dans le n° 3 des Archives de la Seconde Guerre mondiale, p. 11): « Ce matin, à trois heures, j’ai assisté pour la première fois à une action spéciale. En comparaison, l’enfer de Dante me paraît une comédie. Ce n’est pas pour rien qu’Auschwitz est appelé un camp d’extermination ». Plus tard, le 12 septembre, après d’autres journées de ce type, entrecoupées de ripailles savoureuses (soupe de tomate, poulet, petits fours une fois, tarte aux pommes à volonté, café et bière une autre fois, ou encore cuisse de lièvre et pudding…), le Dr. Krmer note : « Inoculation contre le virus. A la suite de quoi, état fébrile dans la soirée ; j’ai néanmoins assisté à une action spéciale dans la nuit (1600 Hollandais). Scènes terribles près de la dernière baraque. C’était la dixième action spéciale. » Dans le même texte, p. 17, Poliakov signale que les exécuteurs avaient besoin de s’enivrer avant d’affronter et après avoir accompli l’ « action spéciale ».
A Auschwitz, lorsque l’afflux de personnes convoyées dépassait trop les capacités de la chambre à gaz, la fraction des déportés en surnombre était entraînée plus loin, à l’écart, dans un endroit boisé où avait été creusée une immense fosse pour entretenir une fournaise à ciel ouvert. Là ils étaient tués d’une balle dans la nuque puis immédiatement précipités dans les flammes. Ces victimes, en s’approchant du lieu fatal, en apercevant les rangées de SS armés, en entendant les détonations et les cris de leurs prédécesseurs dans la colonne, prenaient conscience plus vite encore du sort qui les attendait. Ici, la cruauté tient d’abord à l’absence de compassion, ce qui suppose un sentiment de toute puissance.
Combien y eut-il d’exécuteurs, de bourreaux assassins en tout genre, dans toutes les situations où les SS purent déployer leur capacité d’action meurtrière ? Il y a dispute à ce sujet… Sans doute plusieurs centaines de milliers. Mais, je l’ai précisé : pas toujours des Allemands. J’ai dit que Les Einsatzgruppen sont quatre groupes de 2 ou 3000 membres chaque, avec leurs 60 000 supplétifs locaux.
b) Seconde manière d’envisager les camp d’extermination : c’est une institution qui, pour atteindre à un bon niveau de régularité et d’efficacité dans la tuerie de masse, se fait aider par des milliers de personnes. La plupart, détenues elles aussi, sont rabaissées au niveau de l’esclave dont la vie est négligeable et qui seront donc traitées, là encore, avec le plus grand mépris donc la plus grande cruauté. Les convois sont fréquents à partir de 1942 et la masse de gens à tuer est considérable, donc les sélections commencent. La première étant du 4 juillet 1942. H. Langbein (idem, p. 23), note qu’en mars 1942, il y a, pour les déportés admis dans les baraquements du camp (c’est-à-dire provisoirement dispensés de la mort par gazage, puisqu’ils doivent contribuer à l’élimination de leurs semblables), 27 000 matricules. La numérotation est nouvelle et à l’origine elle n’est pas inscrite sur le bras des détenus mais en plus gros sur leur poitrine. En bref, le projet pragmatique des SS consiste à garder vivante quelques temps, trois mois tout au plus, la partie des condamnés qui leur fournira la main d’œuvre d’appoint indispensable, l’autre partie, bien plus importante, devant être immédiatement asphyxiée dans une chambre à gaz. On dispose sur ce point de plusieurs récits de rescapés, qui racontent comment, à la descente du train, de nombreux déportés sont désignés pour le supplice final, et dirigés vers des camions qui les conduisent vers les salles de torture en leur faisant croire que les véhicules sont là pour leur épargner une fatigante marche à pied…
Après le mise en place du système de sélection et de marquage, le nombre des numéros matricules va passer à 35 000. Sont alors imposées aux personnes désignées des centaines de tâches, allant de l’administration, avec la paperasserie à tenir, mais aussi les constructions et tout ce qu’elles comportent de maçonnerie, plomberie, menuiserie etc., l’entretien, et les services liés directement au modus operandi des exécutions et à leur caractère d’industrie du meurtre. Certaines tâches et fonctions sont des postes privilégiés, par la sécurité qu’ils procurent et un niveau meilleur ou moins mauvais d’alimentation, de vêture, et même d’hébergement (exemple une pièce spéciale pour le responsable ou la responsable du « bloc »). Il faut avant tout dresser des listes, effectuer des dénombrements, procéder à des comptages quotidiens, etc. Logiquement, à Dachau, les déportés affectés à ces travaux sont des détenus politiques. A Auschwitz, ce sont souvent des détenus de droit commun, réputés impitoyables. D’où la concurrence, parfois haineuse, entre détenus, pour bénéficier de ces avantages. D’autres tâches, la plupart à vrai dire, sont misérables et pénibles au point d’être mortelles.
On ne peut pas ici s’épargner le constat que les plus horribles de ces fonctions sont effectuées par les Sonderkommando (équipes spéciales), des détenus chargés d’extraire les cadavres de la chambre à gaz. Ces détenus, lorsqu’ils entraient dans le local toute juste redevenu silencieux (en portant éventuellement eux-mêmes des masques à gaz pour ne pas respirer les dernières émanations toxiques), ils devaient séparer les corps amoncelés, projeter sur cet amas de chair inerte un jet d’eau puissant permettant d’évacuer l’immondice écoulé des corps à l’approche de la mort.
Remarque
Le lecteur qui ne découvre pas sans malaise de tels détails horribles aura peut-être recours, ainsi que moi, souvent, comme dans une autre conduite de défense, plus maniaque celle-là, à Baudelaire et son poème Elévation, dans Les fleurs du mal, qui nous offre la solution suivante : « Envole-toi bien loi de ces miasmes morbides, / Va te purifier dans l’air supérieur »… à condition toutefois, qu’on admette contrairement à la fameuse prédiction d’Adorno, que la poésie a encore un rôle à jouer dans nos existences après Auschwitz.
Une fois les corps séparés les uns des autres, les détenus de l’équipe spéciale les transportaient au crématoire pour l’incinération. Plusieurs milliers de cadavres par jour, à une certaine époque, étaient réduits en cendres, si bien que les hautes cheminées ne cessaient d’exhaler leur épaisse fumée ; c’est d’ailleurs la première chose, la fumée, et son odeur pestilentielle caractéristique, que remarquent les arrivants, en s’étonnant toujours, dans une première angoisse encore informulée, de l’odeur nauséabonde qui en émane.
Ne croyons pas que les nazis restaient totalement indifférents à leurs victimes. Il est connu qu’ils en prenaient soin : mais comme une matière fongible. D’où cette manifestation supérieure de la cruauté, qui concerne non les vivants mais les morts. Ne rien laisser perdre. Les hommes des Sonderkommando étaient contraints d’arracher de la bouche des cadavres encore tièdes les dents en or, de même qu’ils devaient conserver les cheveux des femmes en vue de certaines fabrications textile. Les cendres humaines elles-mêmes pouvaient être utilisées comme engrais dans les champs cultivés, ou comme isolants sous les planchers des bâtiments, etc.
(à suivre)
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par fjf le 20 Juillet 2022 à 07:27
Séance 4
LA CRUAUTE NAZIE
(suite)
Je vais poursuivre la description de la vie concentrationnaire en insistant sur le traitement cruel infligé aux détenus par les SS et leurs sbires. Ce point de vue, annoncé lors de la séance précédente, me conduira aussi à analyser le mode d’organisation qui s’est révélé propice à la mise en œuvre de ce traitement.
Je ne reviens pas sur le cas des médecins nazis dans les camps, déjà abordé en 2020 séance 7 à propos de Mengele. Je rappelle juste que ces médecins, loin de soigner les Juifs, pratiquaient sur eux y compris sur les enfants (Mengele en a tué beaucoup, en particulier des jumeaux), d’horribles expérimentations, qui n’avaient aucun souci des personnes, de leurs souffrances, de leur vie, et se sont donc très souvent révélées mortelles.
1
Je considère donc la catégorie très majoritaire de ces détenus totalement et définitivement vaincus et utilisés comme esclaves – et dont les SS n’économisent pas les forces et la vie (ils les font périr en quelques semaines, au lieu de les exterminer immédiatement à la descente du train, dès l’arrivée). On peut dire que ces détenus sont maltraités de manière systématique, avec acharnement, je dirai même avec une sorte de sérieux professionnel qui fait penser à la fois à une bonne dose de folie et à la tradition bureaucratique prussienne. Sur ces manières de faire, nous disposons de nombreux témoignages, toujours terribles, de rescapés. Je m’arrête un instant au récit français de Claudine Cardon-Hamet sur le convoi « politique » du 6 juillet 1942, comportant de nombreux hommes non-juifs. Le livre de C. Cardon-Hamet, fondé sur des témoignages de rescapés, est intitulé Triangles rouges à Auschwitz. Le convoi politique du 6 juillet 1942, Paris, éditions Autrement, 2005). C. Cardon-Hamet nous apprend que, peu après la sélection (qui se pratique alors depuis peu de temps à l’été 1942), l’entrée dans le Block se fait sous les coups de trique assénés par deux détenus plus anciens qui sont chargés de frapper tous les arrivants l’un après l’autre, ceci dans le but de leur faire découvrir le sort et la vie que le camp leur réserve désormais. Il ne s’agit donc pas seulement de mauvais traitements mais de tortures, lesquelles, en outre, sont pratiquées avec la plus grande brutalité possible. En parlant de torture, on est loin de ce qu’on imaginerait peut-être, à savoir le raffinement et le calme apparent des supplices chinois. Au contraire, à Auschwitz, comme dans les autres camps d’extermination, les ordres et les convocations sont souvent communiqués sur le mode de la colère explosive, avec un flot d’insultes et un déluge de coups. Primo Lévi, évoque lui aussi des coups administrés en permanence. Dans Si c’est un homme (op. cit., 27), il explique ainsi : « Il nous a fallu bien des jours et bon nombre de gifles et de coups de poing pour nous habituer à montrer rapidement notre numéro ». Des coups reçus sur le dos et sur la tête à tout bout de champ, c’est aussi ce que décrit Maurice Cling (Un enfant à Auschwitz, Paris, éditions de l’Atelier, 2008), à propos des départs pour le travail, et du commencement chaque jour de telle ou telle activité. Il ne s’agit donc pas simplement d’obtenir l’obéissance inconditionnelle des détenus. Le SS cherche en réalité à anéantir toute volonté, en sorte que le détenu ne sera plus rien d’autre qu’un corps souffrant, un organisme qui ne connaîtra plus rien d’autre que la souffrance (ni plaisir, ni repos), donc qui ne pourra avoir d’autre existence ni d’autre conscience que celle de la souffrance et de la peur… dans l’attente de la mort.
2
A Auschwitz, comme dans les autres camps, qu’ils soient d’extermination ou de concentration, la brutalité, on le sait, est par ailleurs déléguée par les SS aux détenus institués à diverses fonctions, en premier lieu les kapos (« capos »), qui jouissent de certains privilèges car ils sont mieux nourris, et pas concernés par les sélections donc l’envoi dans une chambre à gaz… si toutefois ils exécutent correctement les fonctions de surveillance et de maltraitance qu’on leur commande – d’où leur tendance à s’activer avec la plus grande dureté possible. Les kapos sont les rouages très bien huilés de la domination absolue voulue par les SS , et souvent ils sont recrutés dans des groupes de détenus criminels. Ce sont alors des prisonniers de droit commun (voleurs, trafiquants, proxénètes…). Ils peuvent être aussi des étrangers de toute provenance ayant commis telle ou telle infraction, ou bien des « asociaux » (les femmes prostituées), et dans tous les cas des non juifs. M. Cling parle de Polonais. Les asociaux sont en général réputés pour faire preuve d’une très grande violence sadique. Tous ces statuts se traduisent en outre par des insignes qui les rendent facilement reconnaissables (triangle de telle ou telle couleur : vert pour les criminels, rouge pour les détenus dits politiques, noir pour les asociaux, étoile rose pour les homosexuels, etc.), ou des particularités de vêture. Selon M. Cling (idem, p. 84), à Auschwitz, les kapos et les Unterkapos (sous-chefs) portent un brassard jaune et un bonnet noir pincé à l’avant.
La bureaucratie prussienne excelle dans ses manières rigoureuses d’administrer le monde et de le recréer indéfiniment, en le soumettant à une passion classificatoire. On en trouve la confirmation dans une inscription rapportée par M. Cling (idem, p. 76) , inscrite au mur de la salle de douches (Waschraum ) du Block 2, dont la traduction est : « Il n’y a qu’un chemin vers la liberté. Ses bornes s’appellent obéissance, zèle, honnêteté, ordre, propreté, tempérance, vérité, esprit de sacrifice et amour de la Patrie »).
Le matin, très tôt, le départ pour le travail met le détenu (le Häftling) en rapport avec différents dispositifs de contrainte… tandis qu’un orchestre fait défiler les kommando en cadence, avec le kapo qui marque la cadence.. (Voir notamment, parmi bien d’autres témoignages, M. Cling, idem, p. 84 et C. Cardon-Hamet, Triangles rouges…, op. cit., p. 24). Un témoignage parle des valses de Vienne, de L’Auberge du cheval blanc, de La marche des gladiateurs. P. Lévi (Si c’est un homme, op. cit., p. 54) évoque une « danse de ces hommes morts » qui ne lésine pas sur la grosse caisse, les cymbales et toutes sortes d’instruments. Margareta Glas (citée in Michael Pollack, L’expérience concentrationnaire. Essai sur le maintien de l’identité sociale, Paris, Métailié, 1990, p. 62), parle d’une détenue qui dirige l’orchestre du camp des femmes, Alma Rosé, une viennoise, excellente violoniste qui n’est autre qu’une nièce de Gustav Mahler, mais que sa sensibilité artistique rend incapable de s’adapter à la vie, et qui, malgré sa position assez privilégiée dans l’orchestre, ne pourra supporter longtemps « de voir tout cela ».
3
Les chefferies sont aussi nombreuses qu’importantes dans les camps. Elles relèvent de la vision SS selon laquelle l’ordre et la discipline sont d’autant mieux assurés que les détenus sont mis dans des positions hyper concurrentielles, donc entrent en conflit les uns avec les autres (d’autant que le concurrence est dans ce cas vitale). Comme je l’ai laissé entendre, les kapos sont eux-mêmes pris dans une hiérarchie qui comprend des Oberkapos et des Unterkapos, ce qui représente des sortes de grades en rapport avec l’importance numérique du groupe qui est sous leur pouvoir. Les groupes en question sont eux-mêmes identifiés par le bâtiment où ils résident, un block dans lequel, logiquement, fonctionnent là aussi des hiérarchies de surveillance et de commandement. Dans chaque block est nommé un dirigeant, c’est le Blockälteste (ou Blockältester - un doyen en quelque sorte), avec, au dessus d’eux un Lagerälteste, qu’on peut donc considérer comme le doyen du camp. Il y a aussi un responsable de l’administration de la chambrée, le Stubendienst, placé sous l’autorité du Blockältester. Au dessus de tous, trône et règne l’autorité des SS (lesquels, on le voit, se débarrassent le plus possible de toutes les tâches ignobles!) avec un Lagerführer, un Blockführer, un Kommandoführer (pour les équipes de travail).
Quant aux équipes de travail auxquelles je viens de faire allusion, elles doivent atteindre tel ou tel objectif matériel, selon les nécessités fixées par les SS, ce qui fait aussi varier les participants. D’après P. Lévi (Si c’est un homme, op. cit., p. 36), à Auschwitz, entre 1942 et 1944, travaillaient en permanence 200 kommando environ. Toutefois, là encore, des distinctions existaient qui ménageaient pour les détenus la possibilité de trouver un refuge, c’est-à-dire une équipe affectée à un travail moins pénible, par exemple à l’intérieur des bâtiments (pour éviter le froid en hiver). Parmi les travaux les moins éreintants donc désirés pour la sécurité et même un certain réconfort qu’ils procuraient, il y avait les activités consacrées à un secteur du camp nommé par les prisonniers le « Canada » (décrit par exemple par M. Cling, Un enfant…, op. cit., p. 99 et suiv.). Là, on s’occupait de trier les bagages et toutes les affaires dont les arrivants avaient été contraints de laisser derrière eux à l’entrée dans le camp, dès la descente du train. C’était, dit M. Cling, « la caverne d’Ali Baba » (idem, p. 100) où les détenus pouvait améliorer leur maigre pitance en volant du sucre, des pruneaux, des noix, des confitures, etc. On pouvait, explique encore M. Cling, « nous empiffrer de tout ». C’est dire que l’accès à ce stock inépuisable donnait aussi la possibilité d’organiser toutes sortes d’échanges, des trocs donc aussi des trafics. L’une des femmes, citée plus haut, Margareta Glas, dont les souvenirs ont été recueillis par M. Pollak (L’expérience concentrationnaire, op. cit., p. 57), signale qu’à son arrivée dans le kommando chargé de traiter cette masse énorme d’objets de toutes sortes, elle a découvert « avec stupéfaction cette richesse », dans laquelle elle put même trouver du rouge à lèvres, qui représentait pour elle, précise-t-elle, « le signe de la liberté » .
Remarque : sur Margarita Glas
Margareta Glas, juive autrichienne qui vivait à Prague avec son mari, Schorschi, fut déportée, après jugement, à Theresienstadt d’abord puis à Auschwitz où elle arriva le 7 mai 43, pour avoir entretenu une liaison avec l’un de ses amis aryen (ce qu’elle nia). Elle était accusée d’avoir contrevenu aux lois de Nuremberg sur la « pureté de la race ». Son pseudo délit était qualifié de « honte raciale », et cela aboutit à la ranger dans la catégorie des personnes internées pour la sécurité de l’Etat. Or, dans les divers camps où elle fut emprisonnée, elle montra des capacités d’adaptation exceptionnelles. Déjà, dès son incarcération initiale, après son arrestation, à la prison de la Gestapo, elle s’efforça de surmonter les barrières des langues en apprenant assez de Tchèque et de Polonais pour comprendre et se faire comprendre des autres détenues. A Theresienstadt, elle sut mettre en avant ses connaissances en cosmétique, jusqu’à proposer à la femme du Commandant un traitement approprié à l’état de son visage… Il s’agissait de massage et d’application d’un masque. Rapidement, cette audace, payante pour elle, fut admirée de ses semblables. A Auschwitz, elle contracta la typhoïde, mais put échapper au « bloc des morts » (ceux que leur état désastreux conduisait à la chambre à gaz, ce qu’on lui annonçait déjà ! ), et, internée à l’infirmerie, le Revier, elle fit là encore valoir ses compétences de chimiste, ce qui lui vaut d’être engagée comme infirmière. A nouveau, c’est la cosmétique qui lui valut un statut privilégié parce qu’elle put prodiguer des soins aux personnes placées au dessus d’elle. Dans ce contexte, elle noua en outre une relation amicale intense, une relation d’amour dit-elle à plusieurs reprises, avec l’« ainée du Revier », c’est-à-dire la détenue chef ou doyenne de l’infirmerie, Orli Wald-Reichert, une allemande détenue politique (communiste en l’occurrence, et qui avait d’abord été emprisonnée à Ravensbrück), soit la catégorie supérieure des détenues. Le double statut de Margareta, juive et politique, lui permit de jouer sur plusieurs registres, et de solliciter la solidarité que certaines détenues communistes pouvaient éprouver envers d’autres détenues (ce ne fut pas toujours le cas, mais son récit y insiste). Dans ce cas elle sut entretenir une « amitié durable ». Il faut dire que Margareta était aidée par sa beauté et une réelle capacité de séduction, au point qu’on la surnomma « Dolly », en référence à une figure hollywoodienne. Margareta, parvient d’ailleurs à établir des contacts positifs y compris avec des médecins SS, comme un nommé Werner Rohde, dont on nous dit qu’il s’est épris d’une juive slovaque employée comme médecin chef au Revier, Ena Weiss. Comme Margareta et Ena étaient amies, le SS traita Margareta avec quelques précautions, et alla même jusqu’à répondre à une de ses demandes concernant son mari dans le camp des hommes. En l’occurrence, le SS accepta d’octroyer à Schorschi une place dans le kommando chargé d’entretenir à l’extérieur les jardins de légumes et de fleurs en vue de recherches botaniques. « Une planque ». Notons l’extraordinaire bizarrerie de ce SS amoureux… ! Il avait entre les mains la vie des détenus ; il pouvait sans hésiter envoyer à la mort toute personne qu’il lui plaisait d’éliminer. A-t-il montré en même temps « des côtés très humains » comme le laissa entendre Margareta ? (in M. Pollak, idem, p. 56). Laissons cette affirmation au conditionnel, puisque il ne pourrait s’agir que d’une émotion du type de celle que pouvait éprouver Hitler en caressant ses chiens. En d’autres termes, non pas vraiment un sentiment humain, mais un intérêt très précaire pour des humains qui ne sont en réalité pour lui que des objets animés !
4
Dans le camp (dans tous les camps, je le répète), les kapos, qui se servent de matraques (les armes à feu étant bien sûr réservées aux maîtres, les SS), sont d’autant plus impitoyables avec leurs compagnons que leur vie dépend de cet exercice même. D’après le récit d’un SS, Richard Böck, au procès d’Auschwitz, à Francfort (tenu du 20 décembre 1963 au 20 août 1965), récit cité par Hermann Langbein, un détenu autrichien politique auteur d’un livre classique, écrit dans les années 1960 (Hommes et femmes à Auschwitz, Arthème Fayard, 1975, coll 10-18, p. 11-12), le détenu qui faiblissait au travail était frappé par les kapos..., et si les kapos ne frappaient pas assez fort, le SS qui les surprenait en flagrant délit de mollesse ou de ce qu’il pouvait prendre pour un début de compassion, les frappait à leur tour. Dans ce cas, le kapo « recevait des coups de poing dans la figure ou des coups de botte s’il ne tapait pas assez. » Même constat dans le récit de la prénommée Ruth (in M. Pollak, L’expérience concentrationnaire…, op. cit., p. 103) : cette personne raconte qu’un jour, alors qu’elle est au travail, elle reçoit une volée de coups, parce que la femme kapo qui surveille le groupe, voyant le SS approcher, veut montrer son zèle (moyennant quoi, la même kapo voudra ensuite se faire pardonner sous prétexte qu’elle souhaitait en réalité frapper quelqu’un d’autre, si bien que, le soir venu, elle offrira à la victime une gamelle de pommes de terre et d’oignons frits). En plus de cela, les kapos punis après avoir été pris, comme je le disais, en flagrant délit de faiblesse, pouvaient perdre leur statut et leurs privilèges et être remis parmi les autres dans le groupe d’où on les avait sortis pour qu’ils s’en fassent les bourreaux, et où il était clair qu’une vengeance mortelle ne tarderait pas à se déchaîner contre eux.
Robert Antelme, dans L’espèce humaine (Gallimard, 1974 [1957], p. 134 ), va plus loin encore en relatant les événements auxquels il a assisté dans le camp de Ganderscheim - annexé à Buchenwald. Selon lui, il s’avère que les kapos provoquaient du désordre dans la mesure où une discipline un peu fautive leur donnait des occasions et des motifs de frapper et, par conséquent, de démontrer leur zèle, leur application à la tâche : « Il fallait avant tout qu’ils frappent pour vivre et avoir la situation qu’ils voulaient occuper ». C. Cardon-Hamet, à un moment de sa reconstitution (Triangles rouges…, op. cit., p. 32) raconte que, toujours à l’arrivée au camp, lorsque le Blockältester du block 19 se présente, il entreprend de démontrer illico son infernal pouvoir de vie et de mort et, pour ce faire, il choisit et appelle l’un des détenus, le plus jeune en l’occurrence, nommé Matheron, en annonçant à tous les autres : « Je vais vous montrer comment on tue un homme ». Après quoi, avec l’énergie d’un dément en crise, il s’acharne sur le jeune homme pendant dix minutes, à en suffoquer, suant, éructant, pour enfin achever sa victime à coups de bâtons, sous le regard des autres, terrifiés, impuissants. Dans un autre récit, du camp des femmes d’Auschwitz-Birkenau, on parle d’une kapo, détenue de droit commun parce que meurtrière de son mari, qui se fait fort de tuer chaque jour une détenue (Voir M. Pollak, L’univers concentrationnaire…, op. cit., p. 102).
5
L’essentiel pour nous est de comprendre l’administration concentrationnaire de la cruauté. En fait, tout, dans le camp, était ordonné au principe hiérarchique foncièrement répressif et malfaisant, à cette chefferie qui exigeait l’obéissance de tous, mais… étant entendu que la position du supérieur donnait non pas seulement la faculté mais surtout le quasi devoir de traiter les détenus de la manière la plus violente et brutale possible. L’autorité conférée s’exerçait comme pure puissance accomplie dans une violence nécessaire.
De manière générale, je l’ai dit, les détenus, quel que fût leur travail, étaient traités (maltraités!) de telle sorte qu’ils seraient au bout de quelques semaines ou de quelques mois, entre trois et six, exténués, délabrés ou trop malades, donc, inutilisables.
Les malades étaient adressés à l’infirmerie, le Revier, pour y être examinés. Certains pouvaient se rétablir si cela ne demandait pas beaucoup de soins. Mais que se passait-il après examen pour ceux qui ne séjourneraient pas ? Soit ils étaient renvoyés au travail, soit ils étaient trop faibles et de ce fait condamnés à mort, par le gazage ou bien par une piqûre de phénol dans le cœur Les injonctions intracardiaques mortelles, pratiquées notamment par les médecins SS, étaient en effet nombreuses en 1942 (voir H. Langbein, Hommes et femmes à Auschwitz, op. cit., p. 30).
Les malades ou les détenus absolument exténués, en bout de course, sont nommés « musulmans » (peut-être à cause du fait que, à genoux, ou même assis, ils ne pouvaient s’empêcher de tomber en avant, comme dans une posture de prière islamique). D’après P. Lévi (Si c’est un homme, op. cit., p. 94) ce sont « les faibles, les inadaptés, ceux qui étaient voués à la sélection ». Disons que le « musulman » n’a plus aucune capacité de réagir à ce qu’on lui inflige, et devant l’imminence de la mort qu’on lui annonce du fait même qu’il vient de subir la sélection au Revier, et qu’on le conduit à telle ou telle antichambre, un block spécial, etc., donc tout ce qui lui fait connaître sa fin proche, il ne livre plus la moindre expression, il ne dit rien, reste comme indifférent, insensible à son propre sort. Dans le recueil de Michaël Pollack (L’expérience concentrationnaire…, op. cit., , p. 65), Margareta Glas, détenue dans le camp des femmes d’Auschwitz, livre une description affreuse de ces femmes qui, aux limites de la vie, « restaient debout dans un coin… au fond assez indifférentes… (…) alors qu’elles étaient encore capables de marcher »… Voilà le triomphe du SS (et pour nous un point d’horreur à peine représentable) : la destruction parfaite de la volonté. Les musulmans, ce sont les gens qui vivent encore alors que rien de la vie ne subsiste en eux, car même la vie animale est sur le point de s’éteindre en eux, si bien qu’il devient facile de les tuer : on peut le faire d’un geste routinier, presque en pensant à autre choses, à ses plaisirs du jour, à sa famille au chaud et bien nourrie.... Par opposition, tout le monde connaît et ne peut oublier les images des survivants à la libération des camps… Le corps desséché, les membres grêles, le dos voûté, la poitrine creuse, la peau jaunâtre ou grisâtre, le visage livide et les yeux, enfoncés dans les orbites, inexpressifs étrangement.
P. Lévi ajoute (Si c’est un homme, op. cit., p. 96) que, pour ne pas devenir musulman, il faut être l’inverse, un Organisator, Kombinator, Prominent (fonctionnaire du camp)… Voilà la réalité insensée. « Organiser », évoqué par tous les récits sur les camps, est un terme emblématique, qui signifie se procurer quelque chose pour survivre, même un quignon de pain, un cachet d’aspirine, un bien rare et précieux dont on est théoriquement privé et qui peut être vital. Margareta Glas, lorsqu’elle est employée comme infirmière au Revier, s’y trouve en sécurité – relative, comme toujours. Or elle est un beau jour sollicitée par une kapo chargée de garder les réserves de vêtements. Cette dernière, que M. Glas déteste et qui se nomme Marie Schmid, dispose de masses énormes de choses diverses récupérées dans les valises des déportés, à l’arrivée des convois ou après le déshabillage avant l’entrée dans la chambre à gaz … Or cette kapo demande à M. Glas des massages et des soins pour son visage, en échange de quoi, propose-t-elle, elle la rémunérerait abondamment en vêtements, que M. Glas pourrait ensuite échanger contre de la nourriture ou d’autres biens. Finalement, M. Glas accepte le deal, et c’est ainsi qu’elle parvient à « organiser » les produits dont elle se sert pour confectionner les crèmes et les cosmétiques qui sont son outil de travail, et qu’elle destine à une clientèle (il faut bien l’appeler ainsi), qui s’étend des déportés aux SS eux-mêmes.
Dans le camp par conséquent, pour avoir une chance de survivre, il faut très vite s’adapter à la folie du milieu concentrationnaire, et avoir tout de suite la ressource de ruser avec l’environnement, c’est-à-dire non seulement avec la cohorte des supérieurs de tous poils dans cette hiérarchie complexe dont j’ai parlé, mais aussi avec les codétenus, puisque la rivalité entre eux est très vive, ne serait-ce que pour occuper une place bénéfique dans une file d’attente, ou bien quand on cherche à s’emparer de la moindre miette de pain moisie ou à s’approprier pour le travail de toute une journée l’outil le moins abîmé. En d’autre termes, puisque le monde concentrationnaire fonctionne comme un programme mortel à plus ou moins brève échéance, il faut comprendre qu’on ne pourra vivre en conformité pure et simple avec lui, étant donné la discipline, l’entrelacs de règles, de rituels et d’interdits enchevêtrés.
6
Les blocks 19 et 20 d’Auschwitz, sont décrits par C. Cardon-Hamet (Triangles rouges..., op. cit., p. 31 ). Ils mesurent 45 m de long sur 20 de large et comportent, sur toute la surface, des niches avec des constructions ou plutôt des assemblages qui ressemblent à des lits et qui sont constitués de planches élevées sur trois étages. Ils occupent ainsi plusieurs rangées, ces rangées étant séparées par des travées. Les box en question font 1,80 m de façade, 2 m de profondeur et 80 cm de hauteur. Ce sont les niches dans lesquelles les détenus doivent se glisser pour dormir, parfois à deux comme dans le récit de M. Cling (Un enfant..., op. cit., p. 75), où il est avec son frère Willy. M. Cling raconte également la pénible douche glacée forcée dans la Waschraum du block 2 (mais tous les block n’ont pas forcément accès à une telle salle de douches). Quant aux latrines, elles sont aussi alignées dans une vaste salle. Ce sont des des « feuillées » de 20 m de long sur environ 2 m de large, et, pour s’asseoir sur la barre de bois qui se trouve à environ 50 cm au dessus du sol, il faut d’abord patauger dans les excréments. Là aussi les kapos ne sont pas en reste car dans la posture requise, on peut encore prendre des coups et tomber dans la fosse, en arrière de la barre sur laquelle on a tenté de prendre place...
Revenons aux équipes de travail, les kommando. Sur ce plan, il y a différents statuts et divers travaux. Certains de ces travaux réservent davantage de sécurité, occasionnent moins de souffrance. On en a l’exemple dans le récit de P. Lévi, quand celui-ci est employé à des travaux en rapport avec ses compétences de chimiste. Mais je ne puis passer sous silence celle de ces équipes qui fut peut-être la plus éprouvante, le Sonderkommando (équipe spéciale), chargé de nettoyer les chambres à gaz immédiatement après l’ouverture des portes qui faisait suite au gazage des gens entassés là. Le Sonderkommando devait s’activer sur les cadavres notamment pour récupérer les dents en or. Il faut savoir que ces équipes étaient périodiquement renouvelées après que tous les membres d’une équipe précédente aient été tués, ceci afin qu’il n’y ait pas de mémoire des actes commandés aux détenus. Très peu des détenus concernés ont donc survécu (une exception, Shlomo Venezia, qui raconte son horrible expérience dans un ouvrage qui a pour titre : Sonderkommando. Dans l’enfer des chambres à gaz, Paris, Albin Michel, 2007) .
Dans le camp il y a des règles pour chaque situation, des règles explicites ou implicites qu’il faut donc tout le temps respecter. Pour les déplacements, des règles définissent les endroits où il faut se tenir et ceux où on ne doit surtout pas se tenir ; pour le dortoir, il y a des règles qui prescrivent quand et comment dormir, quand et comment accéder aux lavabos ou aux latrines, quand porter ou ôter son bonnet – qu’il faut prendre et taper contre sa cuisse en chœur quand un SS surgit dans la pièce (ce peut en outre être un exercice pendant la marche vers le lieu du travail). Certaines règles disent comment au dehors porter sa veste (bien boutonnée, sans relever le col) ; ou bien qu’il ne faut surtout pas regarder un SS dans les yeux (M. Cling, Un enfant…, op . cit., p. 79), et qu’au contraire il faut fixer le sol à un mètre à droite. P. Lévi (Si c’est un homme, op. cit., p. 34-35), parle dans le même sens des manières de faire son lit, de nettoyer ses sabots, ses vêtements, de les raccommoder, de se livrer le soir à l’inspection des poux, etc., etc. A chaque acte est donc associé un risque de faute, débouchant sur une menace de punition d’autant plus angoissante que les peines sont imprévisibles et que même une vétille peut coûter la vie. M. Cling (Un enfant…, op. cit., p. 109) raconte qu’un détenu, Adolphe, fort mal en point, demanda un jour à un SS la permission de boire. La permission fut acceptée ; mais quand l’homme revint avec un seau rempli d’eau glacée, le SS lui ordonna d’en boire la totalité, et il accompagna de coups violents les supplications que le détenu exprima après quelques gorgées…
C. Cardon-Hamet raconte (Triangles rouges…, op. cit., p. 28) la première distribution de soupe aux détenus du convoi n° 6 en juillet 1942 (les « politiques » partis de Drancy). Elle explique qu’un SS oblige les déportés à boire ou laper cette infâme soupe dans une cuvette, sans ciller, et qu’il se réjouit de voir le breuvage bouillant brûler le gosier des détenus. Dans le même ordre d’idée, on a de nombreux récits de meurtres que les SS commettent simplement…. pour se distraire. C’est ainsi que, lors de la construction de bâtiments, les échelles sur lesquelles travaillent les détenus sont bousculées, moyennant quoi les détenus chutent et se brisent les os sur le sol… après quoi les SS, constatant l’incapacité des personnes diminuées par l’accident, leur tirent une balle dans la tête… Un autre cas de facétie morbide, qui porte donc la cruauté à son comble, est rapporté par M. Cling (Un enfant…, op. cit., p. 127), qui a vu des détenus menés à la potence après une tentative d’évasion, et qu’on contraignait à s’avancer vers le lieu de leur exécution, en passant devant leurs semblables (alignés pour la circonstance et ayant obligation de regarder), avec au cou une pancarte où était inscrit : « Coucou, nous revoilà ». L’un des récits consignés par M. Pollak (L’expérience concentrationnaire…, op. cit., p. 103), relate un tour joué par les SS aux détenues : ils mettaient de l’huile de ricin dans leur soupe, après quoi, « celles qui avaient fait dans leur culotte étaient bonnes pour le gaz ».
La cruauté et le sadisme se donnent également libre cours le matin (de très bonne heure), lorsque le SS qui a en charge tel ou tel Kommando apprécie de démarrer la journée, avant le travail proprement dit, par des exercices les plus fatigants et éprouvants possibles. Il fait aligner le groupe qu’il dirige sur trois rangs et commande divers mouvements qu’il faut effectuer à toute vitesse, par exemple s’accroupir et se relever sans arrêt. Bien évidemment, certains détenus n’ont pas récupéré la fatigue de la veille et des jours précédents, si bien que, dans l’état d’épuisement où ils se trouvent, ils ne parviennent plus à se relever après seulement deux ou trois de ces flexions. De ce fait, le SS et le kapo les frappent durement. Comprenons bien : ce n’est pas une punition qui aurait pour justification une prétendue mauvaise volonté. C’est bien plutôt une torture qui vise à ajouter de la souffrance à la souffrance. Comme si la fatigue était une occasion d’augmenter la fatigue, et la souffrance un bon motif d’accroître la souffrance. Dans cette perspective, quand les détenus travaillent, la surveillance des SS s’exerce sans autoriser le moindre relâchement. M. Cling (Un enfant…, op. cit., p. 87), décrit une tâche à laquelle il était assigné et qui consistait à charger des wagonnets de terre puis à les pousser dans une descente jusqu’à l’endroit où ils devaient être déversés. Or, s’il arrivait que l’un des détenus occupé à pousser le très lourd wagonnet saute sur le tas accumulé pour se reposer en se laissant porter quelques instants, il recevait immédiatement une volée de coups, après quoi le SS exigeait qu’une seule personne au lieu de deux s’occupe de la charge, ce qui obligeait le prisonnier restant à fournir davantage d’efforts sans avoir jamais la possibilité de s’interrompre un seul instant.
7
Pour avoir une chance de survivre sous le coup de cette domination absolue d’autant plus jouissive pour le SS que la souffrance infligée par lui pouvait être illimitée, le détenu devait donc toujours, en exprimant la plus grande humilité voire en montrant son indignité fondamentale, donner des gages de servitude absolue, en adoptant notamment les postures prescrites dans chaque situation, tout au long de la journée.
Il reste cependant que tout accepter et tenter d’endurer les souffrances sans mot dire, sans rechigner, sans protester, c’était du même coup, comme dit Primo Lévi, risquer de chuter inexorablement dans la totale déréliction, jusqu’à devenir un « musulman », celui qui a de lui-même renoncé au statut de simple vivant. Dans ce régime d’arbitraire total, tout peut s’effondrer à la moindre faute, volontaire ou involontaire, grave ou légère…
Quand Orli déprimée, tente de mettre fin à ses jours, son amie proche Margareta est accusée d’avoir fourni les substances toxiques, et le Haupsturmführer du camp la condamne à subir une intervention chirurgicale à titre d’observation scientifique. On l’ampute d’un sein pour étudier une malformation. C’est ce que lui annonce la détenue allemande qui dirige la pharmacie du Revier où Margareta travaille : « Je regrette de te dire qu’ils viendront dans une heure pour t’emmener à Auschwitz [par différence avec le camp des femmes] et pour t’opérer ». Opérée et recousue sans anesthésie le 6 août 1943 (M. Pollak, L’expérience concentrationnaire..., op. cit., p. 61), Maragareta se rétablit néanmoins… démontrant à nouveau une étonnante capacité de résistance au mal… C’est alors qu’un autre femme amie, Ena Weiss, vient la voir et lui explique « - Voilà, Dolly, la fin approche. Tu as encore un vœu ? - Oui, dites bonjour à Orli, rien d’autre »…. Est-ce que cela ne dit pas cette chose absolument fondamentale, la conquête de la dureté et de l’insensibilité à laquelle il fallait parvenir, y compris à l’égard de personnes aimées, y compris, aussi, à l’égard de soi-même, pour continuer à vivre ? Mettre en sommeil et peut-être parfois détruire tout possibilité de commisération, donc entraver toutes les ressources morales, du moins lorsque ces ressources mènent à dépenser son énergie vitale pour une autre fin que sa propre conservation. D’un côté, on pouvait faire preuve de solidarité (comme quand Margareta intercède auprès d’un SS pour qu’on épargne le gazage à une autre femme...). Mais d’un autre côté, il fallait à tout prix se déshumaniser… volontairement et positivement, sans attendre de l’être négativement et contre son gré par les SS… Margareta Glas parle elle-même de cette indifférence comme d’une habitude qu’il fallait prendre au plus vite dès les débuts de la vie dans le camp, même si, ajoute-t-elle, cette « protection contre le désespoir » ne réduisait « en rien les besoins affectifs et sexuels » (M. Pollak, idem, p. 66). Margareta parle d’ailleurs de contacts avec des hommes ; et elle-même aura une liaison qui la conduira à un avortement - qu’elle dit ne pas s’expliquer. Curieux mélange de désirs, peut-être même d’amour véritable - on ne sait- et de sécheresse de l’âme… Ceci nous permet de comprendre l’anecdote suivante qui concerne cette fois sa relation amoureuse, si intense et érotisée avec Orli : elle lui demande une nuit de se coucher auprès d’elle, ce que l’autre accepte. Et voilà ce qu’elle en retire :
« … cette nuit-là, le ciel était tout rouge et je ne sais pas si c’était le feu que faisaient les SS qui brûlaient des enfants juifs ou si le commando spécial brûlait tous les cadavres. Malgré tout cela, je n’étais pas malheureuse, bien au contraire. Pendant cette nuit-là, j’ai été très heureuse parce que je pouvais être avec Orli. Et le je lui ai souvent dit : ‘Tu es l’être que j’aime le plus au monde, homme ou femme’ » (cité par M. Pollak, idem, p. 70).
8
S’il y a dans le camp des statuts… sinon privilégiés du moins peu exposés aux flétrissures habituelles, il n’est pas possible d’en tirer un argument qui contredirait la logique essentielle qui consiste avant tout à martyriser les Juifs… Moyennant quoi le Häftling, s’il a (encore) la volonté de vivre et de survivre, cherche à acquérir les habiletés censées le prémunir contre certains risques pour quelques jours ou même seulement quelques heures au-delà desquelles il lui faudra encore trouver de quoi se prolonger. Ainsi M. Cling (Un enfant…, op. cit., p. 113) évoque-t-il la place qu’il doit calculer dans la file d’attente pour recevoir dans sa gamelle un peu de bouillon au moment où la louche sera plongée au fond de la marmite et ramènera quelques morceaux de légume ; ou bien, sur le même mode (idem, p. 115) lorsqu’il est affecté à un kommando où l’on creuse la terre dans une carrière, le choix d’une position de départ apte à lui procurer avant les autres un outil (pelle ou pioche) non ébréché, avec un manche lisse qui ne lui blessera pas les mains, donc un outil qui ne lui compliquera pas la tâche en lui demandant un surcroît d’efforts. Voilà donc la condition du détenu, qui ne sera jamais indifférent à l’ambiance permanente de mort, qui ne sera donc jamais vraiment adapté au camp (ce que suggère M. Pollak dans L’expérience concentrationnaire…, op. cit., p. 265), donc qui doit tout observer, rester en permanence sur le qui-vive, demeurer toujours vigilant, se donner à chaque instant, comme si sa vie en dépendait (et en fait, elle en dépend) la capacité suprême de conquérir une parcelle, si infime et brève soit-elle, de subsistance donc de sécurité. P. Lévi, à la fin de son autre récit, sur la libération et le trajet de retour, si long et compliqué (il mit 35 jours pour regagner Turin) se rappelle qu’il a « mis des mois à perdre l’habitude de marcher le regard au sol comme pour chercher quelque chose à manger ou à vite empocher pour l’échanger contre du pain ». D’où la formule étonnante d’Imre Kertész, (Etre sans destin, Paris, coll. 10-18, 2002 [1975], p. 342): retour de Buchenwald, il a une conversation dans un autobus avec un quidam qui lui donne le billet que le contrôleur lui reproche de ne pas avoir, et ensuite, une fois descendu, sur un banc, quand son interlocuteur qui le questionne, cherche à imaginer un camp de concentration, il répond : « un endroit où on ne peut pas s’ennuyer ».
Dans un livre remarquable, Max Picard donnait le hurlement comme un signe primordial du nazisme (sans qu’on puisse distinguer les hurlements des bourreaux et les supplications des victimes - L’homme du néant, 1947, p. 19). M. Picard emploie d’ailleurs plus loin dans son texte l’expression caractéristique : « Hitler le hurleur » (idem, p. 147)… Primo Lévi relate la même chose (Si c’est un homme, op. cit., p. 18) après avoir entendu les ordres vociférés par les SS à l’ouverture des porte du wagon de déportation, devant la rampe du quai du camp. M. Cling à son tour (Un enfant…, op. cit., p. 69) parle d’ « aboiements barbares naturels aux Allemands quand ils commandent, et qui semblent libérer une hargne séculaire ». Et Viktor Klemperer, après avoir entendu Hitler crier devant des foules en extase en 1933 parlait lui aussi de « véritables hurlements, ceux d’un prêtre » (Mes soldats de papier. Journal, 1933-1941, Paris, Seuil, 2000 [1995], p. 22 – texte du 10 mars 1933).
Max Picard compare aussi la cruauté des Huns à celle des nazis, cette dernière étant selon lui bien plus grande parce qu’effet d’un calcul, ce qui en fait une cruauté à l’échelle non plus de l’homme mais de ce qui est hors de l’homme… au point que le nazi commet des atrocités comme « en passant » (je disais : de façon routinière, presque professionnelle), au sens où il peut perpétrer ses crimes en pensant à autre chose… : tel est ce phénomène majeur constaté par Max Picard et qu’il nomme la discontinuité… (des pensées criminelles qui peuvent très bien succéder à des émotions humaines, esthétiques par exemple, sans que le sujet aperçoive la moindre incohérence, la moindre contradiction)...
(à suivre)
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique